GEORGE SAND
A NOHANT
QUELQUES OUVRAGES...
Le plus récent :

Michelle Perrot, George Sand à Nohant, une maison d'artiste, Seuil, 2018
et
• George Sand l'insoumise, Le Monde hors-série, 2018.
• Anne Muratori-Philip, La Maison de George Sand à Nohant, Editions du patrimoine, 2012
• Sylvie Delaigue-Moins, Les hôtes de George Sand à Nohant, éd. Christian Pirot, 2008
• Sylvie Delaigue-Moins, Chopin chez George Sand, sept été à Nohant, éd. Christian Pirot, 2005
• Pierre de Boisdeffre, George Sand à Nohant, sa vie, sa maison, ses voyages, ses demeures, é. Christian Pirot, 2000
• Anne-Marie de Brem, La Maison de George Sand à Nohant, Editions du patrimoine, 1999
• Nicole Patureau, Nohant, éd. Ouest-France, 1995
VISITER LE DOMAINE DE NOHANT
LA FAMILLE DE GEORGE SAND
GEORGE SAND À NOHANT DE 1808 À SA MORT
NOHANT APRÈS LA MORT DE GEORGE SAND
LA MAISON
LE JARDIN ET LE PARC
LE CIMETIÈRE
QUELQUES TÉMOIGNAGES D'EDMOND PLAUCHUT
QUELQUES TÉMOIGNAGES DE VISITEURS CÉLÈBRES
QUELQUES TEXTES DE GEORGE SAND SUR NOHANT
QUELQUES MOMENTS DE BONHEUR DE GEORGE SAND À NOHANT
LA VALLÉE NOIRE ET LES ROMANS DE GEORGE SAND
VISITER LE DOMAINE DE NOHANT
Le domaine de George Sand à Nohant a été conservé et il faut s'en réjouir. Certes la maison a été victime de cette "contamination muséale" que dénonçait déjà Julien Gracq à propos d'autres maisons d'écrivains. Certes l'adjonction, dans les communs, d'un salon de thé, d'une boutique-librairie, d'un auditorium sont aujourd'hui autant d'obstacles à une communion véritable avec l'esprit de la dame de Nohant. Et le visiteur du jardin trop bien refait se souvient des protestations de George Sand lorsque la dame de Bérenger du Gua s'avisa de "mettre la cognée dans le petit bois et la pioche dans les allées".
C'est que George Sand n'aimait pas que l'on touche à sa maison. En 1824, quand son mari Casimir voulut mettre un peu d'ordre dans le domaine, elle en fit une maladie : "Nohant était amélioré, mais bouleversé; la maison avait changé d’habitudes, le jardin avait changé d’aspect. Il y avait plus d’ordre, les appartements étaient mieux tenus, les allées plus droites, l’enclos plus vaste. C’était mieux, à coup sûr. Pourtant, quand cette transformation fut opérée, quand je ne retrouvai plus les coins sombres et abandonnés où j’avais promené mes jeux d’enfant et les rêveries de mon adolescence, je me troublai, et sans réflexion, sans conscience d’aucun mal présent, je me sentis écrasée d’un nouveau dégoût de la vie qui prit encore un caractère maladif."
Nohant tel que nous le voyons aujourd'hui n'est plus exactement le Nohant qu'aima George Sand.
Cette constatation avait déjà été faite par romancière américaine EDITH WHARTON qui a visité Nohant en 1906 et 1907. Pour elle, la maison de George Sand ne reflète pas réellement ce qu'elle a été et la vie qu'elle y a menée.
"La maison a une allure bien plus digne et décente, bien plus consciente des convenances et contraintes sociales, que ne le laisseraient entendre les premières années de la vie qui y a été menée. Quand on se remémore la foule de personnages divers qui ont franchi le seuil de cette tranquille maison, les enfants naturels des deux côtés, vivant en harmonie les uns avec les autres et avec les enfants légitimes, les domestiques trop intimes, les paysans camarades de jeu, les compagnons de beuverie, quand on considère ces bringues de minuit présidées par le tonitruant Hippolyte Chatiron et le sombre picoleur Dudevant, tandis que leurs femmes restaient à l'étage, écœurées mais apparemment tolérantes, on s'attend que la maison porte, même extérieurement, des marques de cette période noire et dépravée; ou, lorsque que l'étrange défilé qui continuait de se produire dans la maison se composait d'une compagnie tout aussi extravagante et mal assortie d'anciens prêtres, de naturalistes, de journalistes, de saintsimoniens, adeptes de toutes sortes de marottes religieuses, politiques et littéraires. Au lieu de cela, on découvre l'image d'une aisance aristocratique, une sobre demeure, consciente à tous égards de sa situation dans l'échelle sociale, de ses obligations envers l'église et les maisonnettes placées sous son aile, de ses droits sur les arpents qui l'entourent. On peut alors se laisser aller à imaginer qu'une vieille maison ainsi caractérisée par sa banalité même, par sa conformité, a dû exercer, sur un esprit aussi sensible que celui de George Sand sien, une influence imperceptible mais persistante."
(Motor-Flight through France (1908) traduit sous le titre "La France en automobile").
L'historien DANIEL HALÉVY, dans son livre Visites aux paysans du Centre (1935) dira à peu près la même chose. Il a été frappé par l'air de solide bourgeoisie et l'ordre qui règne dans la maison, en particulier dans la cuisine avec ses cuivres bien astiqués et sa longue table. Selon lui, la maison ne porte pas la marque de la George Sand femme libérée et bohème mais suggère une George Sand embourgeoisée, celle qu'on a appelée la "bonne dame de Nohant".
De fait, la maison est trop calme, trop bien rangée, le jardin trop bien refait, la cour des communs (qu'Edith Wharton a vue peuplée de vaches et de poules) est trop propre ; de plus, le salon de thé, la boutique et l'auditorium n'arrangent rien. Il faut un gros effort d'imagination pour remettre dans tout cela la vie, le mouvement, le désordre que la maison connaissait quand George Sand y était. Heureusement, il nous reste les textes. Grâce à eux nous pouvons toujours essayer d'entrer en communion avec cette demeure.
Et ces textes ne manquent pas :
– L'Histoire de ma vie (2 tomes Pléiade),
– la Correspondance : 27 volumes publiés, 20.000 lettres (même si elle a détruit ses lettres à Musset, à Chopin), 2000 correspondants différents et non des moindres (Balzac, Sainte-Beuve, Dumas, Delacroix, Renan, Flaubert…),
– des Agendas détaillés jour par jour à partir de 1852, à l'initiative de Manceau
– les témoignages des familiers de George Sand (comme le livre d'Edmond Plauchut, Autour de Nohant) ainsi que les témoignages de ceux qui ont été reçus à Nohant.
LA FAMILLE DE GEORGE SAND
Le visiteur de Nohant doit se familiariser avec la famille de George Sand, dont les portraits sont présents dans plusieurs pièces : ses grands-parents Dupin de Francueil, ses parents Maurice et Sophie Dupin, son mari Casimir Dudevant, ses deux enfants Maurice et Solange, ses deux petites-filles Aurore et Gabrielle (qui avaient 10 et 8 ans quand elle mourut).
LES ASCENDANTS
Du côté paternel, elle descendait d'une illustre lignée où l'on trouve des comtes, des ducs, des électeurs et plusieurs familles royales d'Europe. Son arrière-arrière-grand-père était Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, puis roi de Pologne.
Auguste II le Fort (roi de Pologne de 1733 à 1763)
eut de sa maîtresse, la comtesse Aurore de Koenigsmark (1670-1728), un fils :
|
Maurice comte de Saxe (1696-1750), maréchal de France et soudard brutal
(il reçut Chambord en récompense de sa victoire à Fontenoy)
d'une de ses maîtresses, Marie Rainteau (1730-1775), fille de limonadier, "dame d'opéra", il eut une fille:
|
Marie-Aurore de Saxe (1748-1821)
qui épousa en secondes noces, en 1777, à 30 ans, le fils du financier propriétaire de Chenonceaux
Louis-Claude Dupin de Francueil (1715-1776), fermier-général, amant de Mme d'Épinay; ils eurent un fils:
|
Maurice Dupin (né en 1778)
d'une servante, Catherine Chatiron, il eut d'abord un fils Hippolyte Chatiron (1799-1848)
puis il épousa, à l'insu de sa mère, la fille d'un modeste oiseleur des quais de Paris,
Sophie-Victoire Delaborde (1773-1837), qui attendait un enfant de lui; c'était :
|
Amantine-Aurore-Lucile Dupin, dite plus tard "George Sand" (1804-1876)
qui épousa en 1822 Casimir Dudevant (1795-1871), fils illégitime d'un chef de brigade et de sa servante.
LES DESCENDANTS
| "George Sand" et Casimir Dudevant eurent deux enfants (officiellement, car le père de Solange était sans doute Stéphane Ajasson de Grandsagne) : | ||
| 1- Maurice Dudevant (1823-1889) épouse en 1862 Lina Calamatta (1842-1901); ils ont deux filles : | ||
= Aurore Dudevant (1866-1961) ; elle épouse en 1889 Frédéric Lauth, artiste peintre (1865-1922) ; sans enfants.
|
||
| = Gabrielle Dudevant (1868-1909) ; épouse en 1890 un Italien, Roméo Palazzi (1853-1932) ; sans enfants | ||
|
||
| 2- Solange Dudevant (1828-1899) épouse en 1847 Jean-Baptiste-Auguste Clésinger (1814-1883) sculpteur et artiste-peintre ; ils ont, en 1848 et 1849, deux filles mortes très jeunes (Aurore et Gabrielle) | ||
GEORGE SAND À NOHANT
La grand-mère de George Sand s'installe à Nohant
Le grand-père de George Sand, Louis-Claude Dupin de Francueil, était né à Châteauroux en 1715. Il fut représentant du fermier-général en Berry et, à ce titre, habitait à Châteauroux, au Château-Raoul. Il mourut en 1788. Sa veuve (Marie-Aurore de Saxe) – apparentée à la famille royale par la mère de Louis XVI, Marie-Josèphe de Saxe – inquiétée et même emprisonnée pendant la Révolution, quitta Paris et chercha un coin tranquille en Berry : elle trouva Nohant.
Nohant était un ancien château féodal élevé en 1393. Charles de Villelume reconstruisit le château entre 1450 et 1452, en l'entourant de fossés et de fortifications. Aux générations suivantes, le château se transmit au gré des successions, des ventes ou donations. En 1767, la terre et la maison avaient été achetées par Pierre Philippe Pearron, comte de Serennes et gouverneur de Vierzon. Il fit démolir les remparts du château et fit bâtir l'actuelle propriété à l'emplacement de la forteresse féodale. On raconte qu'au moment où il faisait installer la lourde porte du cachot qu'il y avait prévu, il remarqua l'air menaçant des paysans qui assistaient à la scène : il comprit que des ennuis l'attendaient et il quitta la France.
La propriété était donc à vendre : une grande maison de maître datant de 1770, des communs, une ferme attenante (avec deux tours rondes, restes de l'ancienne forteresse) et un parc de cinq hectares.
En 1793, Marie-Aurore Dupin achète la propriété de Nohant pour 230.000 livres. Elle fait abattre les murs au midi, combler les fossés, planter un bois et crée un potager. Elle agrandit le domaine par l'acquisition de nouvelles terres et fermes. En 1802, elle fait construire un escalier intérieur en pierre en remplacement de l'ancien. En 1808, les fossés sont comblés et les vieux murs qui entourent le château sont démolis.
EDMOND PLAUCHUT – Madame Dupin avait fait cette acquisition dès que, sauvée de l'échafaud par le 9 thermidor elle put se retirer en Berry, dont son second mari avait été, depuis son retour d'Alsace, l'un des plus brillants fermiers-généraux. Elle fit combler les fossés dont M. de Serennes avait entouré le château, puis elle en exhaussa le sol de façon qu'il formât terrasse du côté du couchant. Quatre murailles grises, d'aspect rébarbatif, entouraient de toute part l'habitation ; elle fit jeter par terre le pan faisant face au midi, et dès lors, de ses fenêtres ouvrant dans cette direction, il lui fut possible d'embrasser d'un coup d'œil les collines boisées d'où se détachent les toitures rouges du village de Laleuf et les coteaux derrière lesquels s'élèvent les belles ruines du donjon de Sarzay. Afin d'égayer la retraite où elle comptait finir les jours d'une existence bien tourmentée déjà, madame Dupin, grande dame dans ses goûts et ses actions, car elle avait été élevée par la dauphine Marie-Josèphe, créa un parc, un verger, des serres et un jardin ; elle traça des allées soigneusement sablées et des charmilles ; elle planta à profusion des tilleuls, des peupliers, des marronniers, des ormes, dont les cimes élevées et massives donnent aujourd'hui à Nohant le caractère de résidence seigneuriale qu'il n'eut jamais au temps de la féodalité.
1808-1821 – L'adolescence d'Aurore Dupin à Nohant
Début août 1808, Maurice Dupin, lieutenant-colonel de hussards, bel officier de 30 ans, aide de camp de Murat, son épouse Sophie-Victoire, leur fils de quelques mois et leur fille Aurore, qui a 4 ans, arrivent épuisés à Nohant venant de Madrid : "Je repris mes sens en entrant dans la cour. Ce n'était pas aussi beau, à coup sûr, que le palais de Madrid, mais cela me fit le même effet, tant la grande maison est imposante pour des enfants élevés dans le petites chambres". (Histoire de ma vie, II,14) La fillette se retrouve dans la chambre de sa grand-mère Marie-Aurore de Saxe : "Ce lit et cette chambre, encore frais à cette époque, me firent l'effet d'un paradis. Les murs étaient tendus de toile de Perse à grands ramages; tous les meubles étaient du temps de Louis XV." (Histoire de ma vie, II, 14)
Ce premier séjour est marqué par la mort de son petit frère le 8 septembre et surtout par la mort accidentelle de son père, le 16 septembre 1808 (il est tombé de cheval sur la route de La Châtre). Alors que la petite Aurore, fille de militaire, aurait dû connaître une vie d'errance à travers l'Europe, elle passa son adolescence dans ce coin perdu du Berry. En effet, le 28 janvier 1809, Marie-Aurore de Saxe parvient à convaincre la mère d'Aurore de lui céder la tutelle sur la petite fille, en échange d'une rente à vie.
Elle avait 11 ans lorsque, en août 1815, la vie de Nohant se trouva animée par le passage du général Colbert :

Au château de Nohant en 1815, Madame Aurore Dupin de Francueil,
en compagnie de sa petite-fille Aurore Dupin,
reçoit le général Louis Pierre Alphonse de Colbert
(tableau d'Alphonse Lalauze).
Histoire de ma vie, III, 7, éd. Pléiade 786 sq : "Un spectacle imposant et plein d'émotions vint m'arracher au sentiment de ma propre existence pendant une partie de l'été que ma mère passa avec moi en 1815. Ce fut le passage et le licenciement de l'armée de la Loire. […] J'étais donc comme désillusionnée de l'Empire et comme résignée à la Restauration, lorsque, par un ardent soleil d'été, nous vîmes reluire sur tous les versants de la vallée Noire les glorieuses armes de Waterloo. Ce fut un régiment de lanciers décimé par ce grand désastre qui le premier vint occuper nos campagnes. Le général Colbert établit à Nohant son quartier général. Le général Subervic occupa le château d'Ars, situé à une demi-lieue. Tous les jours, ces généraux, leurs aides de camp et une douzaine d'officiers principaux dînaient ou déjeunaient chez nous. Le général Subervic était alors un joli garçon très galant avec les dames, enjoué, et même taquin avec les enfants. […] On voyait au premier mot de ma grand-mère, et rien qu'à son grand air et à son costume suranné, qu'elle appartenait au parti royaliste. On supposait même chez elle plus d'attachement à ce parti qu'il n'en existait réellement au fond de sa pensée. Mais elle était fille du maréchal de Saxe, elle avait eu un brave fils au service, elle était pleine de grâces hospitalières et de délicates attentions pour ces brigands de la Loire en qui elle ne pouvait voir autre chose que de vaillants et généreux hommes, les frères d'armes de son fils (quelques-uns même l'avaient connu, et je crois que le général Colbert était du nombre) ; en outre, ma grand-mère inspirait le respect, et un respect tendre, à quiconque avait un bon sentiment dans l'âme. Ces officiers qu'elle recevait si bien s'abstenaient donc de dire devant elle un seul mot qui pût blesser les opinions qu'elle était censée avoir ; comme, de son côté, elle s'abstenait de prononcer une parole, de rappeler un fait qui pût aigrir leur respectacle infortune. Voilà pourquoi je vis ces officiers pendant plusieurs jours sans qu'aucune émotion nouvelle changeât la disposition de mon esprit ; mais un jour que nous étions par exception en petit comité à dîner, Deschartres, qui ne savait pas retenir sa langue, excita un peu le général Colbert. Alphonse Colbert, descendant du grand Colbert, était un homme d'environ quarante ans, un peu replet et sanguin. Il avait des manières excellentes, des talents agréables ; il chantait des romances champêtres en s'accompagnant au piano ; il était plein de petits soins pour ma grand-mère qui le trouvait charmant, et ma mère disait tout bas que, pour un militaire, elle le trouvait trop à l'eau de rose."
C'est François Deschartres, le régisseur du domaine de Nohant, qui prend en main l'éducation de la fillette : ancien professeur, il a de solides connaissances en science et en médecine.
EDMOND PLAUCHUT – Le pédagogue Deschartres, toujours vêtu de sa même veste chamois, de ses grandes guêtres marron, de sa casquette à soufflet, était dans le ravissement en voyant combien, en trois ans, son élève s'était fortifiée. Il ne se décidait pas à la traiter comme autrefois et l'appelait "Mademoiselle". Pour elle seule, l'omnicompétent Deschartres, qui "comme du fumier regardait tout le monde", abandonnait son air rogue. Entêté, pédant, bourré de grec et de latin, s'il faisait souvent le bien, c'était toujours en grognant. Avec ça, excellent musicien et habile chirurgien. Un paysan se brisait-il les côtes en tombant du haut d'un arbre ou d'une charrette à foin, le bonhomme, avec une grande patience, remettait le blessé sur pied ; mais malheur à celui-ci lorsque, pour témoigner de sa gratitude, il apportait à son sauveur des poulets, un lièvre saisi au collet ou des oiseaux pris à la pipée. Deschartres le bourrait de coups de poings, le mettait à la porte en lui jetant volaille et gibier à la tête, en le traitant de malappris et de butor !
Les compagnons de jeux d'Aurore ont été Hippolyte Chatiron (un enfant que Maurice Dupin a eu d'une servante) et Ursule Godignon, la fille d'un chapelier de La Châtre, nièce d'une femme de chambre. Ensemble ils vagabondaient dans le parc et dans les champs, faisaient le "ravage" avec les garnements du pays ou allaient ramasser, les jours de neige, les alouettes prises au piège de la "saulnée".
Quand elle eut 14 ans, sa grand-mère décida de l'envoyer au couvent à Paris, de janvier 1818 à mai 1820.
A son retour, son demi-frère Hippolyte (qui, en 1816, s'était enrôlé au 3e hussard) l'initia à l'équitation sur sa jument Colette. Alors, pour chasser et monter à cheval, elle s'habillait en homme, en redingote, comme le faisaient les autres demoiselles de la région. Elle explorait la région et faisait des croquis. Elle s'imprégnait aussides légendes fantastiques qui s'attachaient aux fontaines, aux étangs, aux pierres enchantées
Mais Deschartres crut bon de la préparer à gérer le domaine, qui devait lui revenir au décès de sa grand-mère. De fait, celle-ci mourut le 26 décembre 1821 et Aurore, à 18 ans, hérita de Nohant et de ses trois fermes.
1822-1836 – Aurore Dudevant la mal mariée
Sa mère, Sophie-Victoire, qui n'aimait pas la campagne, emmena l'adolescente à Paris. C'est alors que, pour échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle ne s'entendait pas, Aurore épousa François Dudevant, dit Casimir, un homme de 27 ans.
Comme ce Casimir n'avait pas de biens personnels, et comme il ne lui déplaisait pas de jouer au propriétaire, le jeune ménage, après quelques tâtonnements, s'installa à Nohant. Là, Casimir voulut tout régenter. Il fit partir le vieux Deschartres, il transforma le domaine, harcela les fermiers.
Leur couple est un échec. Aurore voyage beaucoup : Paris, Bordeaux, Périgueux; Italie avec Musset (1833-1834). Aurore se console avec ses deux enfants, Maurice (1823), puis Solange (1828). Désormais, elle et Casimir font chambre à part. Le enfants dorment dans la chambre de la grand-mère et Aurore s'installe dans le petit boudoir attenant, où elle dort, elle, dans un hamac.
Lasse de son mari, de ses beuveries, de ses coucheries avec les servantes, en 1831 elle lui réclame une pension lui permettant d'aller vivre à Paris deux fois trois mois par an. Elle est décidée, sur les conseils de Henri de Latouche, le directeur du Figaro, de vivre en écrivant des romans. En effet, elle a trouvé un chevalier-servant en la personne de Jules Sandeau, un étudiant en droit qui passait ses vacances à La Châtre chez son père. Ils écrivent ensemble un premier roman, Rose et Blanche, signé J. Sand. Elle écrit seule le deuxième, Indiana, et prend le pseudonyme de George Sand. Désormais, ses romans lui rapporteront beaucoup plus que les fermes du domaine.
Quand elle est à Nohant, elle parcourt le Berry à cheval, herborisant avec son ami "le Malgache". Son roman Valentine contient des pages nostalgiques sur la Vallée-Noire, et un autre roman André se déroule près de La Châtre.
Casimir, qui est devenu maire de Nohant, fait tout pour dissuader son épouse d'y revenir. Illui rend la vie impossible, jusqu'à ce qu'un nouvel amant de la dame, l'avocat Michel de Bourges, obtienne en 1836 la séparation de époux et la restitution de Nohant à Aurore Dupin, que l'on appellera désormais "George Sand".
1836-1848 – Amis et amants hôtes de George Sand
Nohant était désormais pour elle seule. Et conserver un lien avec cette maison presque natal lui parut alors essentiel :
Je n'avais pourtant pas conquis la moindre aisance. J'entrais, au contraire, je ne pouvais pas me le dissimuler, dans de grands embarras, par suite d'un mode de gestion qu'à plusieurs égards il me fallait changer, et de dettes qu'on laissait à ma charge sans compensation immédiate. Mais j'avais la maison de mes souvenirs pour abriter les futurs souvenirs de mes enfans. A-t-on bien raison de tenir tant à ces demeures pleines d'images douces et cruelles, histoire de votre propre vie, écrite sur tous les murs en caractères mystérieux et indélébiles, qui, à chaque ébranlement de l'âme, vous entourent d'émotions profondes ou de puériles superstitions ? Je ne sais ; mais nous sommes tous ainsi faits. La vie est si courte que nous avons besoin, pour la prendre au sérieux, d'en tripler la notion en nous-mêmes, c'est-à-dire de rattacher notre existence par la pensée à l'existence des parents qui nous ont précédés et à celle des enfants qui nous survivront. (HV, chap. 5)
Elle remet donc Nohant en état selon ses goûts, fait revenir son fils de pension et reçoit amis et amants, dont Félicien Mallefille qui devient le précepteur des deux enfants.
– Franz Litz et Marie d'Agoult viennent à Nohant passer l'été 1837 (GS invite son amie à parcourir le Berry à cheval et elles organisent toutes deux de belles soirées musicales dans le parc).

Maurice Sand : "Maman bien étonnée d'entendre Liszt"
(coll. Musée de la Musique-Philarmonie de Paris)
– Balzac, qui séjournait près d’Issoudun, à Frapesle, chez Zulma Carraud, vint passer trois jours en février 1838 à Nohant chez "la lionne du Berry". Il en rapporta l’idée de son roman Béatrix (1839), dans lequel Félicité des Touches est George Sand, le compositeur Conti Franz Liszt et Beatrix de Rochefide Marie d’Agoult. il aime entendre le petit Maurice de 15 ans inventer des histoires extraordinaires à propos de petits personnages qu'il dessine et découpe (est-ce là qu'est née l'idée de la future Comédie humaine ?)
«J’ai abordé le château de Nohant le samedi gras, vers les sept heures et demie du soir et j’ai trouvé le camarade George Sand dans sa robe de chambre, fumant un cigare après le dîner, au coin du feu dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles jaunes ornées d’effilés, des bas coquets et un pantalon rouge. Voilà pour le moral. Au physique, elle avait doublé son menton comme un chanoine. Elle n’a pas un seul cheveu blanc malgré ses effroyables malheurs : son teint bistre n’a pas varié ; ses beaux yeux sont tout aussi éclatants, elle a l’air tout aussi bête quand elle pense, car, comme je lui ai écrit après l’avoir bien étudiée, toute sa physionomie est dans l’oeil… Elle se couche à six heures du matin et se lève à midi ; moi, je me couche à six heures du soir et je me lève à midi… Elle est excellente mère, adorée de ses enfants ; mais elle met sa fille Solange en petit garçon et ce n’est pas bien… Je n’ai pas été à Nohant impunément. J’en ai rapporté un énorme vice : elle m’a fait fumer.»
Solange s'est souvenue de ce personnage qu'elle vit alors qu'elle avait dix ans : "Il arrivait en robe de chambre de dominicain, froc de laine blanche, où ses chairs abondantes et d'une propreté approximative nageait à cru et sans retenue."
– En avril 1838, le peintre Auguste Charpentier vient faire son portrait et découvre « la vie intérieure et journalière que l'on passe dans le château de Nohant ».
– En 1842, la cantatrice Pauline Viardot et son mari Louis, directeur du Théâtre des Italiens, y séjournent en septembre.
– En 1842, Eugène Delacroix vint à Nohant les étés 1842, 1843, 1846. G. Sand l'avait rencontré en 1834 alors qu'elle était venue poser dans son atelier pour qu'il fasse son portrait en vue d'une gravure que demandait son éditeur François Bulloz
« Eugène Delacroix fut un de mes premiers amis dans le monde des artistes, et j'ai le bonheur de le compter toujours parmi mes vieux amis. […] Pour moi, il est le premier maître de ce temps-ci, et, relativement à ceux du passé, il restera un des premiers dans l'histoire de la peinture. […] Je n'ai point à faire l'historique de nos relations ; elle est dans ce seul mot, amitié sans nuages. Cela est bien rare et bien doux, et entre nous cela est d'une vérité absolue. Je ne sais si Delacroix a des imperfections de caractère. J'ai vécu près de lui dans l'intimité de la campagne et dans la fréquence des relations suivies, sans jamais apercevoir en lui une seule tache, si petite qu'elle fût. Et pourtant nul n'est plus liant, plus naïf et plus abandonné dans l'amitié. Son commerce a tant de charmes qu'après de lui on se trouve soi-même être sans défauts, tant il est facile d'être dévoué à qui le mérite si bien. Je lui dois en outre, bien certainement, les meilleures heures de purs délices que j'aie goûtées en tant qu'artiste. Si d'autres grandes intelligences m'ont initiée à leurs découvertes et à leurs ravissements dans la sphère d'un idéal commun, je peux dire qu'aucune individualité d'artiste ne m'a été aussi plus sympathique et, si je puis parler ainsi, plus intelligible dans son expansion vivifiante. » (Histoire de ma vie, V,5)

Sous-bois à Nohant, aquarelle de Delacroix
En 1842, Delacroix donne des leçons de dessin à Maurice dans un atelier qu'on a aménagé pour lui dans les communs. Un jour, il vit la fermière assise sur un tronc d'arbre près de sa petite-fille à laquelle elle apprenait à lire; cette scène lui inspira son tableau L'Éducation de la Vierge, peint sur du tissu à jupon, une domestique et sa filleule ayant pris la pose; le tableau fut copié par Maurice pour l'église de Nohant (cette copie est au musée de La Châtre).

– L'hôte le plus important, c'est Frédéric Chopin. Les deux artistes se rencontrèrent pour la première fois à Paris dans l'automne 1836, avec Liszt et Marie d'Agoult. De ce premier contact, Chopin dit le soir même à son ami Hiller : "Qu'elle est antipathique, cette Sand ! Est-ce bien une femme ? J'arrive à en douter". Par la suite, Chopin et Sand se fréquentèrent à Paris. George Sand hésita longtemps avant de se lancer dans une relation avec le pianiste. Au début de leur relation, Chopin était âgé de vingt-huit ans, George avait trente-quatre ans. Chopin, vu son état de santé, avait grand besoin de soins. En novembre 1838, ils partent séjourner à Majorque, dans les îles Baléares, avec les deux enfants de George Sand, Solange et Maurice. Après un début de séjour très agréable dans une villa, Frédéric est atteint d'une bronchite à l'arrivée de l'hiver et les médecins s'aperçoivent qu'il est tuberculeux ; ils doivent quitter la villa et se réfugient dans de mauvaises conditions au monastère de Valldemossa, dans un trois pièces avec un jardin. Chopin continue à composer, mais sa santé se dégrade malgré les soins et le dévouement de Sand. Ils rentrent en France avant la date prévue et séjournent un moment à Marseille; en mai, ils vont passer quelques jours à Gênes, puis rentrent à Nohant. Là, la mauvaise santé de Chopin (qui ne s'adapte pas au climat, ne supporte pas la nourriture du pays) oblige George à lui faire la cuisine, à le soigner. Le rôle maternel de la romancière se dessine peu à peu dans cette retraite. De 1839 à 1846, ils séjournent souvent à Nohant. C'est une période heureuse pour Chopin qui y compose quelques-unes de ses plus belles œuvres.
Delacroix apprécia beaucoup la vie à Nohant et ses rencontres avec Chopin. Il écrit à G. Sand, le 30 mai 1842 : "Dites à mon cher petit Chopin que la partie que j'aime c'est la flânerie dans des allées en parlant de musique et le soir sur un canapé à en entendre quand le Dieu descend sur ses doigts divins. Vous et les vôtres, vous voir et vous entendre, végéter près de vous, c'est mon rêve."
Mais la cohabitation des enfants de George et de Chopin est difficile: Maurice, qui a 23 ans, lui reproche de lui voler sa mère, Solange, à 18 ans, songe à conquérir pour elle le musicien; puis elle se fiance à un gentlihomme sans fortune, Fernand de Preaulx, qui est reçu à Nohant. L'atmosphère devient pesante. Chopin ne participe plus aux promenades dans la campagne.

Delacroix: George Sand et Chopin (1838)
Ce tableau, inachevé, a été coupé en deux :
"George Sand" est à Copenhague et "Chopin" au Louvre
– Survient alors le sculpteur Auguste Clésinger, grossier, cynique et couvert de dettes. Il convoite Solange pour son argent et finit par l'épouser à Nohant, en mai 1847. Lui et Solange poussent alors George Sand à hypothéquer Nohant; mais elle a la sagesse de refuser. Alors on se dispute, on se frappe même; et Solange et son mari quittent Nohant. Chopin, qui a pris le parti de Solange, ne reviendra plus.
Alexandre Manceau et le théâtre de Nohant
La révolution de 1848 marque une rupture dans la vie de George Sand. Manquant cruellement d'argent, elle est condamnée à écrire pour vivre, enchaînant romans aux romans. La mort de Chopin, d'Hippolyte Chatiron et de l'actrice Marie Dorval la font sombrer dans la dépression. Alors, pour la distraire, Maurice décide de reprendre l'habitude de monter des pièces de théâtre et il imagine aussi un théâtre de marionnettes. Pour jouer du "vrai théâtre" on abat une cloison et on aménage une salle d'une cinquantaine de places; c'est là que George Sand fera l'essai des pièces qu'elle écrit. Pour les marionnettes, tout le monde se met au travail et c'est George Sand qui coud les costumes des petites poupées.
Depuis décembre 1849 est installé à Nohant le graveur Alexandre Manceau, devenu le nouvel amant de la maîtresse de maison. Il grave les dessins de Maurice, l'aide pour le théâtre et les marionnettes, recopie les manuscrits de George, gère toute la maison. Pour Maurice, en 1852-1853, elle fait installer dns le grenier un grand atelier et un cabinet de curiosités (minéraux, collections de papillons...).
En 1852, Solange vient à Nohant avec sa fille Jeanne-Gabrielle, dite Nini, âgée de cinq ans. George Sand se prit de passion pour elle et la garda quelque mois à Nohant. Puis Clésinger vint la lui reprendre et la fillette mourra en janvier 1855.
En 1857, Manceau achète une modeste maison à Gargilesse : il y feront de courts séjours jusqu'en 1863.
En 1862, Maurice épouse Lina Calamatta, la fille du graveur Luigi Calamatta. Elle s'intègre bien à la famille, joue sur le théâtre. Elle met au monde un garçon, qui mourra un an plus tard.
L'été 1863 séjournent à Nohant Alexandre Dumas fils, Théophile Gautier et le peintre Charles Marchal (un nouvel amant). Maurice oblige Manceau, tuberculeux, à quitter Nohant. George Sand va avec lui à Palaiseau pour l'accompagner jusqu'à sa mort (août 1865).
La "bonne dame de Nohant"
Après 1865, c'est Maurice qui gère le domaine de 224 ha avec trois fermes, Launières, La Porte et La Chicoterie. En une douzaine d'années sa mère avait fait progresser le revenu de 5800 francs à 9400 francs, mais la gestion de Casimir s'était révélée déplorable, la laissant endettée de 70.000 francs. Pour elle, désormais, publier fut une nécessité : en 1847 le domaine lui rapportait 7.800 francs et ses livres en moyenne 25.000 francs.
En janvier 1866, Lina mit au monde une petite fille, qu'on appella Aurore, puis deux ans plus tard une petite Gabrielle. Et leur grand-mère se fit nounou, garde-malade, éducatrice. Maurice et Lina Calamatta voulurent transformer Nohant en ferme modèle; mais la guerre de 1870 vient interrompre leur projet.
On a dit que Flaubert pensa à George Sand et à son fils lorsqu'il écrivit Bouvard et Pécuchet. Comme les deux héros de Flaubert ils se sont dispersés dans des projets successifs : cultiver un jardin, faire prospérer une ferme, collectionner des plantes, des minéraux, des fossiles...
Dans la dernière année de sa vie, George Sand ne quitte plus Nohant. Elle souffre de rhumatismes et écrit plus difficilement un dernier roman, Albine Fiori. Elle s'efforce de goûter des plaisirs simples. Pour le carnaval, elle amuse ses deux petites-filles en se déguisant en Turc et en Pierrot. Le 30 mai, elle écrit à son neveu : "Ne t'inquiète pas. J'en ai vu bien d'autres et puis j'ai fait mon temps..."
Le 8 juin 1876, à 72 ans, elle meurt doucement.
NOHANT APRÈS LA MORT DE GEORGE SAND
Maurice Dudevant-Sand (1823-1889) devient l'unique propriétaire de Nohant, suivant le testament de sa mère, au détriment de sa sœur Solange Sand (1828-1899).
Après le décès de Maurice à Nohant en 1889, le domaine appartient à sa veuve, Lina Calamatta (1842-1901), puis à la seconde fille du couple, Gabrielle Dudevant-Sand (1868-1909). La parfaite entente entre les deux petites-filles de George Sand, Aurore et Gabrielle, permet en effet le partage des biens. Gabrielle, très attachée à la terre de Nohant, obtient le château (qu'elle tente en vain de léguer à l'Académie française). Mais elle meurt à l'âge de 41 ans, le 27 juin 1909 à Nohant.
L'ensemble du domaine revient à Aurore Dudevant-Sand (1866-1961), l'épouse de Frédéric Lauth, artiste-peintre. Aurore ouvre Nohant à la visite, assure la sauvegarde des manuscrits, des portraits, des souvenirs. Presque tout le domaine a été vendu et, en 1924, il se réduit à 11 hectares. Sans postérité, elle fait donation du domaine à l'État en 1952, tout en en conservant la jouissance jusqu'à sa mort. Veuve depuis 36 ans, âgée de 92 ans, sans descendance, Aurore adopte en 1958 un homme de 47 ans, l'architecte Georges-André Smeets (1911-1970) qui prend le nom de Georges Smeets-Dudevant-Sand. Celui-ci épouse Christiane Étave (née en 1927)celle-ci, sous le nom de Christiane Sand, se consacre, après la mort d'Aurore († 1961) au classement des archives familiales, organise expositions, conférences, gère la maison de Gargilesse, le musée de La Châtre et publie quelques ouvrages (A la table de George Sand en 1988 et Le jardin romantique de George Sand en 1997).

google maps

wiki-ManfredHeyde
VISITE DE LA MAISON DE NOHANT
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
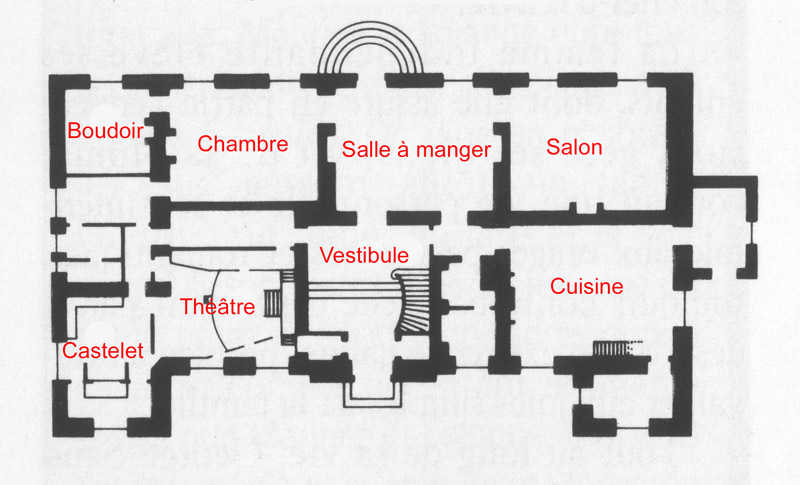
sud
..est + ouest
nord
LE VESTIBULE ET LA CAGE D'ESCALIER
La cage d'escalier a été établie en 1802 par Marie-Aurore Dupin de Francueil; elle a été décorée de nuages bleus et roses sans doute par Maurice Sand. Dans le vestibule est exposé un tableau de Vicente Santaolaria représentant Aurore Lauth-Sand, dernière occupante de la maison, vers 1938.

jn-1976
LE PETIT THEATRE ET LE CASTELET (à gauche du vestibule)
Entre 1846 et 1863, avec une interruption en 1847-1848, ont fait du théâtre, d'abord dans le salon, sur une scène très improvisée :
– George Sand (elle joua par exemple le rôle du « grand chef des Ennuques »)
– Maurice et son ami Eugène Lambert,
– Solange et son fiancé de l'époque, Fernand de Preaulx,
– Augustine Brault, sa fille adoptive.
Les représentations reprirent et s'intensifièrent avec l'arrivée d'Alexandre Manceau (en 1849), qui s'imposa comme metteur en scène, mettant à l'amende ceux qui arrivaient retard aux répétitions (voir une caricature au musée de La Châtre).
L'emplacement actuel avait d'abord été la chambre de Casimir Dudevant. Puis Chopin, qui avait pris le goût du théâtre, y avait installé en 1849 un plancher sur tréteaux. En 1850-1851, George Sand décida d'abattre un mur pour faire un vrai théâtre avec scène, coulisses, décors, rideau de scène et une salle pour 40 à 50 spectateurs. Elle écrit à sa nièce : « J'ai fait des dépenses formidables à Nohant: un calorifère pour chauffer toute la maison, une fourneau économique à la cuisine, un appareil pour les bains et, finalement, ce que je ménage comme une belle surprise à Maurice, une arcade qui enlève la cheminée du théâtre et qui place le public dans le billard, à la distance nécessaire pour les effets et les illusions de la scène. »
« On avait dans le billard un théâtre qu'on appelait le grand théâtre pour le distinguer du théâtre portatif dit des petits acteurs, c'est-à-dire les marionnettes. Manceau vint, vit et critiqua. En effet les coulisses étaient trop étroites, les loques trop baissées, les changements de décors longs et fatigants. On a tout bouleversé et Lambert recommence courageusement toute la peinture des toiles, tandis que le père Bonnin refait toute la charpente ». [GS à Emmanuel Arago, 12 janvier 1850]
« Nous menons une vie de cabotins. Nohant n'est plus Nohant, c'est un théâtre ; mes enfants ne sont plus des enfants, ce sont des artistes dramatiques ; je ne suis plus Mme Sand, je suis un premier rôle marqué. » [GS à Pauline Viardot, octobre 1851]
Le castelet pour théâtre de marionnettes a été installé par Maurice Sand dans la partie réservée aux spectateurs vers 1854; il servit pendant près de 40 ans. La date de 1847, qui y figure, est celle à laquelle Maurice commença à jouer avec des marionnettes, fabriquées par lui, habillées par sa mère. « C'est en 1847 que, pour la première fois, avec l'aide de son ami Eugène Lambert, son ami et camarade à l'atelier d'Eugène Delacroix, et sans autre public que Victor Borie et moi, Maurice installa une baraque de marionnettes dans notre vieux salon. Le théâtre de Nohant, peint, machiné, sculpté, éclairé, composé et récité par Maurice tout seul, offre un ensemble et une homogénéité qu'on réaliserait difficilement ailleurs et qui n'a certainement pas encore son pendant au monde. » [Dernières pages] Maurice fabriquait des marionnettes en bois de tilleul, qui étaient habillées par GS (Balandard, Coquembois, la comtesse de Bonbricoulant, le capitaine Vachard…)
Les saisons théâtrales commençaient vers la fin du mois d'août et se terminaient en novembre, parfois plus tard. Des invitations étaient envoyées ; des affiches conviaient les invités. Sur le théâtre de Nohant on improvisait à partir de canevas ou de scénarios plus construits, écrits par Maurice, par Duvernet, ou par George Sand elle-même. La troupe était composée de la famille, des amis locaux et des amis de passage, parfois comédiens professionnels. Une domestique, Marie Caillaud, née en 1840, fut enrôlée par Maurice (plus tard, en 1868, il lui a fait un enfant). Lambert, Manceau, Maurice opéraient dans les coulisses et Maurice était le spécialiste des bruitages (un vieux tourneroche imitait parfaitement le bruit de la pluie tombant sur un toit). Ce théâtre a servi à GS pour préparer les pièces qu'elle faisait jouer à Paris.
Le théâtre de Nohant a fonctionné régulièrement jusqu'en septembre 1863, date à laquelle il ferma définitivement en raison du départ de Manceau et George Sand pour Palaiseau.
Dans Le Château des Désertes, GS a romancé le théâtre de Nohant : « Durant plusieurs hivers consécutifs, étant retirée à la campagne avec mes enfants et quelques amis de leur âge, nous avions imaginé de jouer la comédie sur scénario et sans spectateurs, non pour nous instruire en quoique ce soit, mais pour nous amuser. Cet amusement devint une passion pour les enfants, et peu à peu une sorte d'exercice littéraire qui ne fut point inutile au développement intellectuel de plusieurs d'entre eux. Une sorte de mystère que nous ne cherchions pas, mais qui résultait naturellement de ce petit vacarme prolongé assez avant dans les nuits, au milieu d'une campagne déserte, lorsque la neige ou le brouillard nous enveloppaient au dehors, et que nos serviteurs même, n'aidant ni à nos changements de décor, ni à nos soupers, quittaient de bonne heure la maison où nous restions seuls ; le tonnerre, les coups de pistolet, les roulements du tambour, les cris du drame et la musique du ballet, tout cela avait quelque chose de fantastique, et les rares passants qui en saisirent de loin quelque chose n'hésitèrent pas à nous croire fous ou ensorcelés. » [Le Château des Désertes, notice de 1853]
EDMOND PLAUCHUT sur le théâtre de Nohant :
– Pendant les dernières années de sa vie, son plus grand et unique bonheur a été de se voir entourée de sa famille, et son plus agréable passe-temps lui fut donné par le théâtre de marionnettes que dirigeait son fils. Les jours de représentation annoncés par des affiches d'une amusante rédaction, on faisait toilette comme pour une soirée d'opéra ; on y apportait une grande attention, un grand fond de gaieté, l'une et l'autre justifiées par le charme des saynètes que Maurice Sand composait expressément pour sa mère. Toujours modeste, j'ai entendu celle-ci dire à quelqu'un qui sortait d'une représentation : "On ne saura jamais ce que je dois au théâtre de mon fils." Quel que soit le sens de ses paroles, elle quittait ce spectacle toujours rieuse et reposée.
– Des paysans, qui à l'heure de minuit passaient non loin des haies et qui s'en revenaient un peu ivres d'une foire des environs, prétendaient que le château et le bois étaient hantés par des esprits et que "ça y revenait". Il s'en échappait à "nuitée", disaient-ils, des cris furieux et des plaintes, des voix qui riaient, qui chantaient, puis des coups de feu, le son d'un tambour battant la charge, des bruits de batailles et des instruments de musique jouant, le diable seul savait pour qui. Les paysans de ce temps-là ne savaient pas encore ce qu'était un théâtre ; ils ignoraient que tous les soirs, ou plutôt chaque nuit, on jouait la comédie ou le drame au château, et que c'étaient des voix d'artistes, des soli de piano ou de violon qui, par les fenêtres ouvertes, se répandaient dans la campagne silencieuse.


jn-1976
LA CUISINE (à droite du vestibule)
On y voit un four à pâtisserie, une grosse table de chêne autour de laquelle une dizaine de domestiques prenaient leurs repas (des clochettes sont reliées aux différentes pièces de la maison), des poteries à trous pour griller les châtaignes, un potager permettant de garder les plats chauds, un "fourneau économique" et un calorifère installés par G. Sand en 1851.
Georges Sand écrit en 1850 à son amie Eugénie Duvernet: "Je te dirai entre nous que j'ai écrit à Pinson pour qu'il cherche une place à mon petit singe de cuisinier. Il a la cervelle trop légère et met un désordre dans les heures des repas des domestiques qui rend tout le service de la maison impossible. Il sait très bien faire la cuisine quand il veut s'en donner la peine. Sous les yeux de maîtres et d'autres domestiques qui le surveilleraient et le dirigeraient, il arriverait à être un très bon sujet. Il sait faire les sucreries, les bonbons, tout ce qu'on veut, et cela épargne bien de l'ennui à une maîtresse de maison. Mais c'est un enfant fou, dissipé, flâneur, absurde, un véritable enfant qui, livré à lui-même dans une maison d'artistes qui ne surveillent rien, qui se lèvent à midi, qui ne savent pas se faire servir et qui n'ont vraiment pas le temps de diriger le ménage, se lance comme un poulain désenfargé." [= desentravé]

jn-1976
LA SALLE A MANGER
Elle est décorée de boiseries peintes en gris et est éclairée par un lustre en verre de Murano (allusion à l'aventure vénitienne de G. Sand). Dressoirs rustiques, chaises Louis XVI. Sur le mur, une fontaine murale en faïence et six des douze gravures réalisées par Maurice Sand pour illustrer les Légendes rustiques de sa mère. Sur la table, des assiettes en porcelaine de Creil-Montereau à décor de fraisier et des verres en cristal jaune et bleu offerts par Frédéric Chopin. Les cartons désignant les convives ont été installés par Aurore Sand pour un dîner imaginaire auquel assistent George Sand (qui préside à l'anglaise), Tourgueniev, Flaubert, Dumas fils, Maurice Sand…
C'est là, en 1849, que se déroula un dîner pour l'anniversaire de la révolution de 1848 : "Nous avons eu aussi notre fête pour l'anniversaire de la Révolution. Toute la famille Fleury est venue dîner avec nous, avec Périgois et Angèle, Jules Néraud et Planet. Nous allions être treize à table, lorsque le judicieux Borie et le prudent Sylvain Bernardet s'en sont avisés et on a couru chercher le père Aulard pour faire le 14ème. Par les soins de l'ingénieux Lambert, un vase de fleurs a occupé le milieu de la table et, au milieu des jacynthes et des narcisses fraîchement écloses, s'élevait entre deux drapeaux tricolores un petit bonnet qui n'était pas blanc du tout. Cet insigne séditieux a mis tout le monde en joie, même le père Néraud, et, après le dîner, on a trouvé le théâtre dressé au salon. Maurice et Lambert nous ont donné une repréentation de marionnettes, avec prologue improvisé pour la circonstance. Cela a eu un succès prodigieux." (lettre à CharlesDuvernet)
Comment 14 convives ont-ils pu tenir autour de cette table ?

jn-1976
LE GRAND SALON
Il est décoré de papiers peints bleutés à motifs fleuris, pourvu d'une cheminée et de fauteuils Louis XVI. C'est là que George Sand réunissait ses amis. Le cartonnier à archives est celui de Dupin de Francueil, qui fut fermier général.
Des portraits de famille sur les murs : George Sand à 34 ans (au début de sa liaison avec Chopin) - le maréchal de Saxe (son arrière-grand-père) - Aurore de Koenigsmarck (dont Pierre Benoît fera l’héroïne de son roman Koenigsmark en 1917) - les deux grands parents Dupin de Francueil - Maurice, le père (mais il n’y a pas de portrait de sa mère, Sophie-Victoire Delaborde) - Maurice, Lina et leurs filles Aurore et Gabrielle.
Le petit piano droit a été acheté en 1849 par l'entremise de la cantatrice Pauline Viardot (il n'a pas été utilisé par Frédéric Chopin). George Sand lui a écrit à cette occasion: "Mon petit piano est délicieux. Pourquoi n'y avez-vous pas fourré un petit bout de votre voix pour me chanter le Mozart que je lis des yeux en pendant à vous?"
La table faite par le menuisier Pierre Bonnin avec le bois d'un merisier du jardin : "C'est une grande, une vilaine table. C'est Pierre Bonnin, le menuisier du village, qui l'a faite, il y a tantôt vingt ans. Il l'a faite avec un vieux merisier du jardin. Elle est longue, elle est ovale : il y a place pour beaucoup de monde. Elle a des pieds à mourir de rire ; des pieds qui ne pouvaient sortir que du cerveau de Pierre Bonnin, grand inventeur de formes incommodes et inusitées. Enfin c'est une table qui ne paie pas de mine, mais c'est une solide, une fidèle, une honnête table. Elle n'a jamais voulu tourner ; elle ne parle pas, elle n'écrit pas, elle n'en pense peut-être pas moins… Si c'est un être, c'est un être passif, une bête de somme. Elle a prêté son dos patient à tant de choses ! Écritures folles ou ingénieuses, dessins charmants ou caricatures échevelées, peinture à l'aquarelle ou à la colle, maquettes de tout genre, études de fleurs d'après nature, à la lampe, croquis de chic ou souvenirs de la promenade du matin, préparations entomologiques, cartonnage, copie de musique, prose épistolaire de l'un, vers burlesques de l'autre, amas de laines et de soies de toutes couleurs pour la broderie, appliques de décors pour un théâtre de marionnettes, costumes ad hoc, parties d'échecs ou de piquet, que sais-je ? tout ce que l'on peut faire à la campagne, en famille, à travers la causerie, durant les longues veillées de l'automne et de l'hiver." [Autour de la table]

jn-1976
EDMOND PLAUCHUT – "A droite, est le salon ; il a toujours eu grand air avec son plafond élevé d'où descendait un beau lustre de Venise, ses larges fenêtres ouvrant sur le parc, ses vieux meubles Louis XVI, ses tapisseries disparaissant sous des appliques dorées d'un grand style, sous des tableaux dont les plus remarqués étaient des esquisses de Delacroix et un portrait au pastel du maréchal de Saxe par Latour. Sur la cheminée, des fleurs et des branchages renouvelés souvent, deux vases en porcelaine blanche, très vieux chine ; dans les angles, deux pianos de Pleyel ; l'un fort ancien, très simple, fut souvent touché par Chopin quand, malade, il vint à Nohant, dans l'espoir d'y guérir la phtisie qui le minait dès l'enfance et dont il devait bientôt mourir ; l'autre, très grand, de fabrication récente, sur lequel chanta madame Pauline Viardot et où ses filles, Marianne et Claudie, très jeunes, piochèrent leurs premières gammes."
LA CHAMBRE DE MARIE-AURORE DE SAXE
Boiseries Louis XVI tirant sur le Louis-Philippe - Bergères médaillon - Lit à la polonaise - Commode en marqueterie attribuée à Jacques Bircklé, ébéliste de la Cour.
- Ce fut la chambre de Mme Dupin de Francueil (née Marie-Aurore de Saxe) où elle mourut (le 26 décembre 1821)
- Ensuite la chambre des jeunes époux Dudevant, Aurore et Casimir, de 1822 à 1828 (jusqu'à la naissance de Solange, dont Casimir ne pouvait être le père!)
- Puis la chambre d'Aurore, puis celle de Maurice, puis celle de Solange
- Elle servit ensuite de chambre d'amis (pour Liszt et Marie d'Agoult* en 1837, pour Solange et son mari le sculpteur Clésinger, pour Delacroix, Pauline Viardot...)
* George Sand a écrit dans son Journal intime : "La chambre d'Arabella est au rez-de-chaussée sous la mienne. Là est le beau piano de Franz, au-dessous de la fenêtre d'où le rideau de verdure des tilleuls m'apparaît, la fenêtre d'où partent es sons que l'Univers voudrait entendre et qui ne font de jaloux ici que les rossignols. Quand Franz joue du piano, je suis soulagée. Toutes mes peines se poétisent, tous mes instincts s'exaltent. Il fait surtout vibrer la note généreuse." (éd. Pléiade II, 980)

jn-1976
LE BOUDOIR
Décor Louis XVI de Péarron de Serennes, constructeur de la maison (voir les initiales au-dessus des portes) - Harpe de Mme Dupin de Francueil et meuble hollandais - Après la naissance de sa fille Solange en 1828, elle s'y installe la nuit pour veiller sur sa fille qui dort dans la chambre voisine et pour écrire; c'est là qu'elle écrivit Indiana et Valentine, "le nez dans la petite armoire qui me servait de bureau" (Hist, IV,14).
"Ce petit boudoir était si petit qu'avec mes livres, mes herbiers, mes papillons et mes cailloux, il n'y avait pas de place pour un lit. J'y suppléais par un hamac. Je faisais mon bureau d'une armoire qui s'ouvrait en manière de secrétaire et qu'un cricri, que l'habitude de me voir avait apprivoisé, occupa longtemps avec moi. Il y vivait de mes pains à cacheter, que j'avais soin de choisir blancs, dans la crainte qu'il ne s'empoisonnât. Un soir, ne l'entendant plus remuer et ne le voyant pas venir, je le cherchai partout. Je ne trouvai de mon ami que les deux pattes de derrière entre la croisée et la boiserie. Il ne m'avait pas dit qu'il avait l'habitude de sortir. La servante l'avait écrasé en fermant la fenêtre." (Hist. IV,12)
On voit les anneaux d'accrochage du hamac - Elle mesurait la taille de ses enfants par des encoches sur le chambranle - C'est par la porte-fenêtre qu'entra Jules Sandeau deux nuits de l'automne 1831 ["Il était là, dans mon cabinet, dans mes bras, heureux, battu, embrassé, mordu, criant, pleurant, riant. C'était une rage de joie comme jamais, je crois, nous ne l'avions éprouvée…"]
Plus tard, à partir de 1867, George Sand se fera aménager une véritable chambre et un bureau au premier étage.
A L’ETAGE
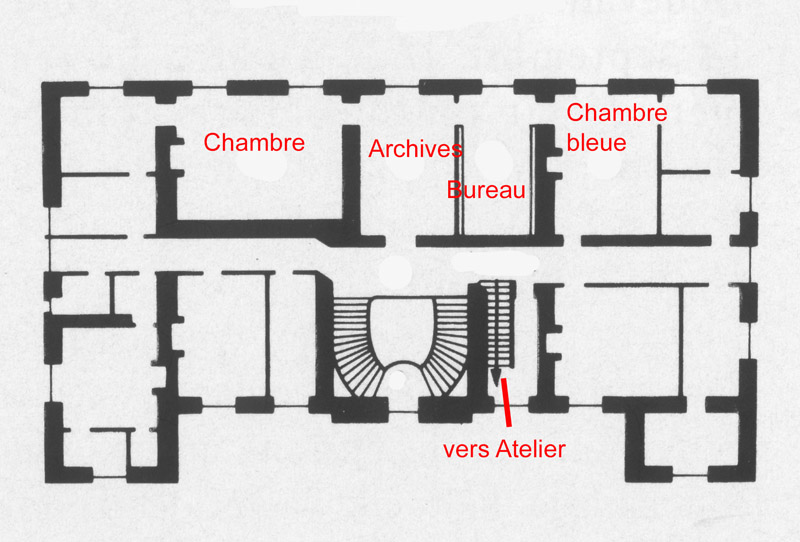
sud
..est + ouest
nord
PIÈCES DIVERSES
Dans la partie nord, de gauche à droite : un cabinet de toilette, la chambre de Lina Dudevant-Sand et celle d'Edmond Planchut, l'ami de la famille. De part et d'autre du grand escalier, deux petites chambres: à droite, la chambre dite « des Papillons », une petite chambre et la chambre dite « Tour du Nord ».
Dans la partie sud, le cabinet de toilette de Gabrielle Sand et une ancienne garde-robe. On y a installé des vitirines présentant des objets antiques offert par le grand-père de Lina Calamatta. Lingerie et garde-robe (avec deux portraits de Gabrielle).
LA CHAMBRE AU SUD-OUEST (dite "chambre bleue")

jn-1976
Cette chambre a été celle d'Alexandre Manceau de 1852 à 1864
George Sand l'occupe pendant dix ans, de 1867 à sa mort en 1876 (c'est là qu'elle est morte). "Je me suis tapissée en bleu tendre, parsemé de médaillons blancs où dansent de petits personnages mythologiques." (lettre de janvier 1867). Elle y avait placé des portraits de Maurice de Saxe, de sa grand-mère, de son père, de Maurice et Soloange (par Pauline Viardot) et des photos de ses petites-filles Aurore et Gabrielle.
Cette chambre est occupée par Aurore Lauth-Sand jusqu'en 1909.
LA CHAMBRE AU NORD-EST
Ce fut longtemps la chambre de Jean-François Deschartres, le précepteur des deux enfants. Maurice s'y installe en 1846 jusqu'à son mariage. Puis elle devient la chambre de son épouse Lina.

jn-1976
LA CHAMBRE AU SUD-EST
C'est la chambre d'Aurore avant son mariage. Elle la retrouve en 1837 quand Casimir et elle font chambre à part.
"Il est sept heures du matin. Je ne suis pas encore couchée. Le temps est magnifique aujourd'hui. La couleur renaît avec le soleil, la verdure enveloppée dans les brouillards éclate ce matin, comme si elle était née cette nuit. Les rossignols chantent à gorge déployée. L'horizon est pur, l'air est doux, les parfums montent..." (lettre à Michel de Bourges, mai 1837)
Elle la quitte en 1867 pour la "chambre bleue". Ses petites-filles y couchent avec leur nourrice.
Puis Gabrielle l'occupe de 1892 à 1909. La décoration actuelle à thèmes japonais a été ajoutée par Gabrielle Sand, passionnée par l'Extrême-Orient. Les papiers peints à motifs représentant des oiseaux échassiers et le mobilier en bambou sont de style Art déco. Ils ont été restaurés en 1998.
La chambre est ensuite occupée par Aurore Lauth-Sand de 1909 jusqu'à sa mort en 1961.

wiki-Eunostos
LE BUREAU ET LE CABINET D'ARCHIVES
Les deux pièces occupées par le bureau de George Sand et par un cabinet d'archives ont été aménagées sur l'emplacement de la chambre de Frédéric Chopin entre 1839 et 1846, pendant sa liaison avec la romancière (on voit dans le couloir les portes capitonnées, que George Sand a fait poser pour que Chopin puisse travailler sans être dérangé par les bruits de la maison).
Chopin selon GS : "Sa création était spontanée, miraculeuse. Il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano soudaine, complète, sublime, ou elle se chantait dans sa tête pendant une promenade, et il avait hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Mais alors commençait le labeur le plus navrant auquel j'aie jamais assisté. C'était une suite d'efforts, d'irrésolutions et d'impatiences pour ressaisir certains détails du thème de son audition : ce qu'il avait conçu tout d'une pièce, il l'analysait trop en voulant l'écrire, et son regret de ne pas le retrouver net, selon lui, le jetait dans une sorte de désespoir. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant et changeant cent fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait six semaines sur une page pour en revenir à l'écrire telle qu'il l'avait tracée du premier jet." [Histoire de ma vie]
Après sa rupture avec Chopin, George Sand a fait ajouter une cloison pour former deux pièces :"Je t'avertis que la maison d'ici est sens dessus dessous, parce qu'on me fait une bibliothèque et un cabinet de travail. Ne compte pas sur toutes tes aises et moque-toi-z-en d'avance" (lettre à Solange de 1861)
Cabinet d'archives avec une série de placards, une petite table, un canapé, des chaises et un bureau, avec une bibliothèque et un meuble abritant ses collections liées aux sciences naturelles (fossiles, minéraux...)


jn-1976
AU GRENIER
L'ATELIER DE MAURICE SAND
L'atelier a été aménagé en 1852, avec deux grandes fenêtres qui défigurent le bâtiment à l'extérieur. Maurice en a fait un "cabinet de curiosités" avec ses collections de papillons, de minéraux, de coquillages et de coraux...
On y voit la suite des illustrations des Légendes rustiques (Les Trois hommes de pierre, Le Lupeux, le Moine des Étangs-Brisses)
EDMOND PLAUCHUT – Au-dessus des chambres formant l'unique étage du château, s'étendent de vastes greniers bourrés jadis de décors, de costumes militaires de la Grande Armée, de collections géologiques et entomologiques, et un immense atelier dans lequel Eugène Lambert croqua son premier chat, Édouard Cadol pleura sur la mort violente de l'héroïne de son premier roman, et où Delacroix esquissa quelques-unes de ses toiles. Lambert, compagnon de classe de Maurice, venu à Nohant pour y passer les vacances, y resta quinze ans. Cadol n'y resta que onze mois.
LE JARDIN ET LE PARC
"La maison, demi-château, a bonne figure avec ses lierres et ses vieilles murailles grises au milieu d'un vaste enclos, moitié parc, moitié jardin." (Théophile Gautier)
Le jardin et le parc de Nohant ont été "réhabilités" par l'architecte paysagiste Isabelle Auricoste aidée de l'historienne d'art Monique Mosser.
Le parc s'ouvre par deux grands cèdres plantés à la naissance des enfants de George Sand, Maurice (1823) et Solange (1828). Le bassin derrière les deux arbres date de 1896.
Un verger, une roseraie, un "fleuriste", un petit bois dans l'esprit romantique et le cimetière, tout y évoque l'écrivain. Le parc historique de 6 hectares, propriété de l'État depuis 1961, a fait l'objet d'une restauration minutieuse. Cette réhabilitation vise à mettre simultanément en valeur l'atmosphère du parc de l'enfance de George Sand et les tracés et plantations auxquels contribua l'écrivain. Deux influences de style s'y opposent : le XVIIIe siècle avec les idées d'utopie champêtre et le point «naturaliste» du milieu du XIXe siècle.
On découvre successivement la cour d'honneur ombragée par un grand if, puis une allée bordée de pivoines qui conduit à la roseraie avec rosiers grimpants et plantes annuelles. Le potager et le verger occupent chacun une grande parcelle, séparés par une allée bordée de plantes vivaces. De vieux fruitiers sont disposés sur une prairie fauchée. Derrière, un allée traverse le parc boisé, entre la pinède et le bosquet, pour mener à l'étang. Enfin, le jardin des cèdres et le jardin des parfums (chèvrefeuilles, clématites et weigelias) rappellent que l'endroit reste propice à la flânerie et à l'inspiration.
– Les éditions Albin Michel ont publié en 1995 un ouvrage abondamment illustré Le Jardin romantique de George Sand, avec des textes de Christiane Sand, Aurore Sand, Gilles Clément.
– En 2004, un colloque s'est tenu à Clermont-Ferrand sur le thème "Fleurs et jardins dans l'oeuvre de George Sand" avec, en particulier, une étude de Damien Zanone : "Scènes de jardin dans Histoire de ma vie: Nohant où le jardin de l'âme".
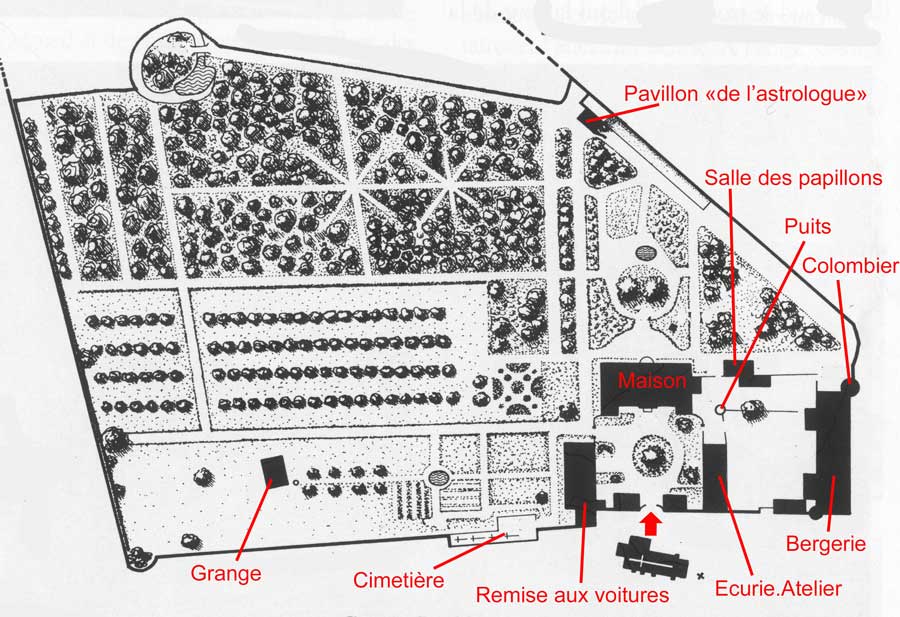
 |
 |
wiki-SiefkinDR
GS préfère aux « jardins arrangés » la nature laissée à elle-même :
"Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties, et je classerais volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l'homme altère et transforme pour son usage et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent. Vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez. Mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces "mauvaises herbes", comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables et – que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée – ce caractère persiste avec le milieu qui l'a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu tout les types primitifs disparaîtront peut-être comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau les avaient conservés vierges de pas humain. Dans ces cas-là je me garde bien de faire part de ces trouvailles : on dévasterait tout."
("Le pays des anémones" dans Nouvelles lettres d'un voyageur, 1877, p. 48)
Ne pas toucher au jardin
En 1815, la comtesse Marie-Thérèse de Bérenger du Gua, née Le Gendre de Vilmorin, s'est réfugiée à Nohant. Profitant de la maladie de la grand-mère, elle décide de refaire tout le jardin. La petite Aurore n'apprécie pas du tout..
"Mme de Bérenger était fort active et ne pouvait rester en place. Elle se croyait très habile à lever ou à rectifier le plan d'un jardin ou d'un parc, et elle n'eut pas plutôt vu notre vieux jardin régulier qu'elle se mit en tête de le transformer en jardin anglais : c'était une idée saugrenue, car, sur un terrain plat, ayant peu de vue et où les arbres sont très lents à pousser, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de conserver précieusement ceux qui s'y trouvent, de planter pour l'avenir, de ne point ouvrir de clairières qui vous montrent la pauvreté des lignes environnantes ; c'est surtout, lorsqu'on a la route en face et tout près de la maison, de se renfermer autant que possible derrière des murs ou des charmilles pour être chez soi. Mais nos charmilles faisaient horreur à madame de Bérenger, nos carrés de fleurs et de légumes qui me paraissaient si beaux et si riants, elle les traitait de jardin de curé. Voilà donc cette bonne dame à l'œuvre ; elle mande une vingtaine d'ouvriers, et de sa fenêtre dirige l'abattage, élaguant ici, détruisant là, et cherchant toujours un point de vue qui ne se trouva jamais, parce que, si des fenêtres du premier étage de la maison la campagne est assez jolie, rien ne peut faire que, dans ce jardin, de plain-pied avec cette campagne, on ne la voie pas de niveau et sans étendue. Il aurait fallu exhausser de cinquante pieds le sol du jardin, et chaque ouverture pratiquée dans les massifs n'aboutissait qu'à nous faire jouir de la vue d'une grande plaine labourée. On élargissait la brèche, on abattait de bons vieux arbres qui n'en pouvaient mais ; madame de Bérenger traçait des lignes sur le papier, tendait de sa fenêtre des ficelles aux ouvriers, criait après eux, montait, descendait, retournait, s'impatientait et détruisait le peu d'ombrage que nous avions, sans nous faire rien gagner en échange. Enfin elle y renonça, Dieu merci, car elle eût pu faire table rase. Il a fallu une trentaine d'années pour faire disparaître le dégât causé chez nous par madame de Bérenger, et pour refermer les brèches de ses points de vue." (H.V., I, 749)
Constructions enfantines dans le parc de Nohant
"Il y a dans notre enclos un petit bois planté de charmilles, d'érables, de frênes, de tilleuls et de lilas. Ma mère choisit un endroit où une allée tournante conduit à une sorte d'impasse. Elle pratiqua – avec l'aide d'Hippolyte, de ma bonne, d'Ursule et de moi – un petit sentier dans le fourré, qui était alors fort épais. Ce sentier fut bordé de violettes, de primevères et de pervenches qui, depuis ce temps-là, ont tellement prospéré qu'elles ont envahi presque tout le bois. L'impasse devint donc un petit nid où un banc fut établi sous les lilas et les aubépines, et l'on allait étudier et répéter là ses leçons pendant le beau temps. Ma mère y portait son ouvrage, et nous y portions nos jeux, surtout nos pierres et nos briques pour construire des maisons, et nous donnions à ces édifices, Ursule et moi, des noms pompeux. C'était le château de la fée, c'était le palais de la Belle au bois dormant, etc. Voyant que nous ne venions pas à bout de réaliser nos rêves dans ces constructions grossières, ma mère quitta un jour son ouvrage et se mit de la partie. « Ôtez-moi, nous dit-elle, vos vilaines pierres à chaux et vos briques cassées. Allez me chercher des pierres bien couvertes de mousse, des cailloux roses, verts, des coquillages, et que tout cela soit joli, ou bien je ne m'en mêle pas. » Il y avait à la maison un âne, le meilleur âne que j'aie jamais connu. […] L'âne fut mis par nous en réquisition, et il rapportait chaque jour dans ses paniers une provision de pierres pour notre édifice. Ma mère choisissait les plus belles ou les plus bizarres et, quand les matériaux furent rassemblés, elle commença à bâtir devant nous avec ses petites mains fortes et diligentes, non pas une maison, non pas un château, mais une grotte en rocaille." [Histoire de ma vie, I, 631]
"Plus tard, je voulus élever un autel à Corambé [un personnage que GS enfant avait imaginé et auquel elle rendait un culte]. J'avais d'abord pensé à la grotte en rocaille qui subsistait encore, quoique ruinée et abandonnée ; mais le chemin en était trop connu et trop fréquenté. Le petit bois du jardin offrait alors certaines parties d'un fourré impénétrable. Les arbres encore jeunes n'avaient pas étouffé la végétation des aubépines et des troènes qui croissaient à leur pied, serrés comme les herbes d'une prairie. Dans ces massifs qui côtoyaient les allées de charmille, j'avais donc remarqué qu'il en était plusieurs où personne n'entrait jamais et où l'œil ne pouvait pénétrer durant la saison des feuilles. Je choisis le plus épais, je m'y frayai un passage et je cherchai dans le milieu un endroit convenable. Il s'y trouva, comme s'il m'eût attendue. Au centre du fourré s'élevaient trois beaux érables sortant d'un même pied, et la végétation des arbustes, étouffés par leur ombrage, s'arrondissait à l'entour pour former comme une petite salle de verdure. La terre était jonchée d'une mousse magnifique, et, de quelque côté qu'on portât les yeux, on ne pouvait rien distinguer dans l'interstice des broussailles à deux pas de soi. J'étais donc là aussi seule, aussi cachée qu'au fond d'une forêt vierge, tandis qu'à trente ou quarante pieds de moi couraient des allées sinueuses où l'on pouvait passer et repasser sans se douter de rien. Il s'agissait de décorer à mon gré le temple que je venais de découvrir. Pour cela je procédai comme ma mère me l'avait enseigné. Je me mis à la recherche des beaux cailloux, des coquillages variés, des plus fraîches mousses. J'élevai une sorte d'autel au pied de l'arbre principal, et au-dessus je suspendis une couronne de fleurs que des chapelets de coquilles roses et blanches faisaient descendre comme un lustre des branches de l'érable. Je coupai quelques broussailles, de manière à donner une forme régulière à la petite rotonde, et j'y entrelaçai du lierre et de la mousse de facon à former une sorte de colonnade de verdure avec des arcades, d'où pendaient d'autres petites couronnes, des nids d'oiseaux, de gros coquillages en guise de lampes, etc. Enfin je parvins à faire quelque chose qui me parut si joli que la tête m'en tournait et que j'en rêvais la nuit." [H.V., I, 819]
GS aimait jardiner :
"Je vis dehors, à l'air, tant que la faim ou le froid de la nuit ne me forcent pas à rentrer. Je fais faire beaucoup de travaux de jardinage […] pour avoir un prétexte de rester en sabots au milieu des pierres et de la terre fraîche, béatitude stupide où je me plonge avec délices sans savoir pourquoi." (lettre à Hetzel du 15 novembre 1845)
A 50 ans, elle construit une rocaille avec sa petite fille Nini, la fille de Solange, qui a environ 5 ans.
"Je travaille à la terre, quatre ou cinq heures par jour, avec une passion d'abrutie, et j'ai fait un jardin à ma fantaisie dans mon petit bois. Un jardin de pierres, de mousse, de lierre, de tombeaux, de coquillages, de grottes, ça n'a pas le sens commun, mais tout ce que j'y remue de pierres, de souches, d'arrosoirs, de brouettées de sable et de terre, tout ce que j'y rêvasse de comédies, de romans, de riens, de flâneries intellectuelles est fabuleux. J'ai commencé par une rocaille pour ma petite-fille et j'en suis à envahir un terrain qui ne s'arrête pas. Elle m'aide, comme un vrai petit cheval. Elle bêche, elle ratisse. Elle se fait un petit corps de fer. Toute ma journée est donc un tête à tête avec elle et, après six mois de courbature renouvelée tous les jours malgré la chaleur, le froid, la pluie, je suis arrivée à être infatigable et à peu près insensible à l'atmosphère. J'ai tenu bon dans la neige quand le jardinier et les ouvriers renonçaient à leur ouvrage. C'est que je travaille avec la tête autant qu'avec le corps. C'est une rage et je tourne positivement à la monomanie." (Lettre à l'éditeur Pierre-Jules Hetzel du 12 janvier 1854).
"Je travaille tous les jours à mon petit Trianon: je brouette des cailloux, j'arrache et je plante du lierre; je m'éreinte dans un jardin de poupée et cela me fait dormir et manger on ne peut mieux." (à Mme de Bertholdi, 28 octobre 1853).
Trois jours après, elle écrit dans l'Écho de l'Indre : "Je me livre au jadinage avec furie, par tous les temps, cinq heures par jour, avec Nini à côté de moi, piochant et brouettant aussi. Cela m'abrutit beaucoup et la preuve c'est que, tout en bêchant et ratissant, je me mets à faire des vers".
Le jardin de Nohant a tenu une place importante dans sa sensibilité :
"Je me souviens d'un jour où, révoltée d'injustices sans nom qui, dans ma vie intime, m'arrivaient tout à coup de plusieurs côtés à la fois, je m'en allai pleurer dans le petit bois de mon jardin de Nohant, à l'endroit où jadis ma mère faisait pour moi et avec moi ses jolies petites rocailles. J'avais alors environ quarante ans. […] Il se fit là en moi une grande révolution: à ces deux heures d'anéantissement succédèrent deux ou trois heures de méditation et de rassérénement dont le souvenir est resté net en moi comme une chose décisive en ma vie." (Histoire de ma vie, Pléiade, II, 439)
Dans le parc, un banc lui rappelle Jules Sandeau que GS a rencontré au château du Coudray à Verneuil-sur-Igneraie : « Il y a une place que j'affectionne surtout. C'est un banc placé dans un joli bois qui fait partie de mon jardin. C'est là que pour la première fois nos cœurs se révélèrent tout haut l'un à l'autre, c'est là que nos mains se rencontrèrent pour la première fois. C'est là aussi que plusieurs fois il vint s'asseoir en arrivant de La Châtre, tout haletant, tout fatigué dans un jour de soleil et d'orage. Il y trouvait mon livre et mon foulard et, quand j'arrivais, il se cachait dans une allée voisine et je voyais son chapeau gris et sa canne sur le banc… » (lettre à Émile Regnault, mai 1831)

Le peintre Auguste Charpentier, en avril 1838 à Nohant,
a peint George Sand parée de fleurs de son jardin.
George Sand s'est intéressée à la botanique
C'est d'abord dans le parc de Nohant, puis dans les prairies de la Vallée Noire, puis dans la vallée de la Creuse autour de Gargilesse que George Sand a acquis une véritable compétence en botanique, en entomologie et en géologie : "Je savais très bien dans quel blé poussaient les plus belles nielles et les plus belles gesses sauvages, dans quelle haie je trouverais des coronilles et des saxifrages, dans quel pré des mousserons ou des morilles, sur quelles fleurs, au bord de l'eu, se posaient les demoiselles vertes et les petits hannetons bleus." (Histoire de ma vie)
Initiée par un voisin, Ajasson de Grandsagne, et un ami, Jules Néraud dit "le Malgache", elle constitua un riche herbier et des collections d'insectes et les minéraux.
LE CIMETIÈRE
Étranges pratiques de son père et de son précepteur
La mère de George Sand mit au monde un enfant, qui mourut à l’âge de trois mois, en 1808. Dans sa douleur, après l’enterrement, elle s’imagina que l’enfant avait été enterré en état de léthargie, mais vivant.
Mon père combattit d'abord cette pensée, mais peu à peu elle le gagna aussi, et regardant à sa montre : "Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il ; il faut que j'aille chercher cet enfant ; ne fais pas de bruit, ne réveillons personne, je te réponds que dans une heure tu l'auras."
Il se lève, s'habille, ouvre doucement les portes, va prendre une bêche et court au cimetière, qui touche à notre maison et qu'un mur sépare du jardin ; il approche de la terre fraîchement remuée et commence à creuser. Il faisait sombre, et mon père n'avait pas pris de lanterne. Il ne put voir assez clair pour distinguer la bière qu'il découvrait, et ce ne fut que quand il l'eut débarrassée en entier, étonné de la longueur de son travail, qu'il la reconnut trop grande pour être celle de l'enfant. C'était celle d'un homme de notre village qui était mort peu de jours auparavant. Il fallut creuser à côté, et là, en effet, il retrouva le petit cercueil. Mais, en travaillant à le retirer, il appuya fortement le pied sur la bière du pauvre paysan, et cette bière, entraînée par le vide plus profond qu'il avait fait à côté, se dressa devant lui, le frappa à l'épaule et le fit tomber dans la fosse. Il a dit ensuite à ma mère qu'il avait éprouvé un instant de terreur et d'angoisse inexprimable en se trouvant poussé par ce mort, et renversé dans la terre sur la dépouille de son fils. Il était brave, on le sait de reste, et il n'avait aucun genre de superstition. Pourtant il eut un mouvement de terreur, et une sueur froide lui vint au front. Huit jours après, il devait prendre place à côté du paysan, dans cette même terre qu'il avait soulevée pour en arracher le corps de son fils.
Il recouvra vite son sang-froid, et répara si bien le désordre que personne ne s'en aperçut jamais. Il rapporta le petit cercueil à ma mère et l'ouvrit avec empressement. Le pauvre enfant était bien mort, mais ma mère se plut à lui faire elle-même une dernière toilette. On avait profité de son premier abattement pour l'en empêcher. Maintenant, exaltée et comme ranimée par ses larmes, elle frotta de parfums ce petit cadavre, elle l'enveloppa de son plus beau linge et le replaça dans son berceau pour se donner la douloureuse illusion de le regarder dormir encore.
Elle le garda ainsi caché et enfermé dans sa chambre toute la journée du lendemain, mais la nuit suivante, toute vaine espérance étant dissipée, mon père écrivit avec soin le nom de l'enfant et la date de sa naissance et de sa mort sur un papier qu'il plaça entre deux vitres et qu'il ferma avec de la cire à cacheter tout autour.
Étranges précautions qui furent prises avec une apparence de sang-froid, sous l'empire d'une douleur exaltée. L'inscription ainsi placée dans le cercueil, ma mère couvrit l'enfant de feuilles de roses, et le cercueil fut recloué et porté dans le jardin, à l'endroit que ma mère cultivait elle-même, et enseveli au pied du vieux poirier. (Histoire de ma vie, I, 590)
En 1821, la veille de l’enterrement de sa grand-mère, son précepteur Deschartres persuade la jeune fille d’aller la nuit dans le cimetière pour ouvrir le cercueil de son père mort depuis 13 ans, prendre le squelette et lui donner un baiser.
Dans la nuit, Deschartres vint m'appeler; il était fort exalté et me dit d'une voix brève : «Avez-vous du courage ? Ne pensez-vous pas qu'il faut rendre aux morts un culte plus tendre encore que celui des prières et des larmes ? Ne croyez-vous pas que de là-haut ils nous voient et sont touchés de la fidélité de nos regrets ? Si vous pensez toujours ainsi, venez avec moi.»
Il était environ une heure du matin. Il faisait une nuit claire et froide. Le verglas, venu par-dessus la neige, rendait la marche si difficile, que, pour traverser la cour et entrer dans le cimetière qui y touche, nous tombâmes plusieurs fois.
Soyez calme, me dit Deschartres toujours exalté sous une apparence de sang-froid étrange. Vous allez voir celui qui fut votre père. Nous approchâmes de la fosse ouverte pour recevoir ma grand-mère. Sous un petit caveau, formé de pierres brutes, était un cercueil que l'autre devait rejoindre dans quelques heures.
J'ai voulu voir cela, dit Deschartres, et surveiller les ouvriers qui ont ouvert cette fosse dans la journée. Le cercueil de votre père est encore intact ; seulement les clous étaient tombés. Quand j'ai été seul, j'ai voulu soulever le couvercle. J'ai vu le squelette. La tête s'était détachée d'elle-même. Je l'ai soulevée, je l'ai baisée. J'en ai éprouvé un si grand soulagement, moi qui n'ai pu recevoir son dernier baiser, que je me suis dit que vous ne l'aviez peut-être pas reçu non plus. Demain cette fosse sera fermée. On ne la rouvrira sans doute plus que pour vous. Il faut y descendre, il faut baiser cette relique. Ce sera un souvenir pour toute votre vie. Quelque jour, il faudra écrire l'histoire de votre père, ne fût-ce que pour le faire aimer à vos enfants, qui ne l'auront pas connu. Donnez maintenant à celui que vous avez connu à peine vous-même, et qui vous aimait tant, une marque d'amour et de respect. Je vous dis que là où il est maintenant, il vous verra et vous bénira.
J'étais assez émue et exaltée moi-même pour trouver tout simple ce que me disait mon pauvre précepteur. Je n’y éprouvai aucune répugnance, je n'y trouvai aucune bizarrerie, j'aurais blâmé et regretté qu'ayant conçu cette pensée il ne l'eût pas exécutée. Nous descendîmes dans la fosse et je fis religieusement l'acte de dévotion dont il me donna l'exemple.
Ne parlons de cela à personne, me dit-il, toujours calme en apparence, après avoir refermé le cercueil et sortant avec moi du cimetière : on croirait que nous sommes fous, et pourtant nous ne le sommes pas, n'est-il pas vrai ?
— Non certes, répondis-je avec conviction. […]
Dans la journée qui suivit cette nuit d'une étrange solennité, nous conduisîmes ensemble la dépouille de la mère auprès de celle du fils. Tous nos amis y vinrent et tous les habitants du village y assistèrent. Mais le bruit les figures hébétées, les batailles des mendiants qui, pressés de recevoir la distribution d'usage, nous poussaient jusque dans la fosse pour se trouver les premiers à la portée de l'aumône, les compliments de condoléance, les airs de compassion fausse ou vraie, les pleurs bruyants et les banales exclamations de quelques serviteurs bien intentionnés, enfin tout ce qui est de forme et de regret extérieur me fut pénible et me parut irréligieux. J'étais impatiente que tout ce monde fût parti. Je savais un gré infini à Deschartres de m'avoir amenée là, dans la nuit, pour rendre à cette tombe un hommage grave et profond. (Histoire de ma vie, I, 1106)
Les tombes
En 1855, sont déjà inhumés dans le cimetière communal jouxtant la propriété son père, sa grand-mère et sa petite-fille Gabrielle. George Sand obtient alors de la mairie l'autorisation de privatiser ce coin du cimetière en concession perpétuelle pour sa famille.
Y auront leur sépulture sa mère Sophie Delaborde (ses restes étant transférés depuis Paris), George Sand elle-même (1876), son fils Maurice (1889), sa fille Solange (1899), Lina Calamatta (1901), Gabrielle (1909), Aurore (1961).
Edmond Plauchut est le seul étranger de la famille admis en ce lieu par Aurore en 1909. Sa tombe est placée en retrait des autres sépultures avec cette épitaphe : "On me croit mort, je vis ici".



Les obsèques de George Sand (résumé de l'article paru dans le Figaro)
La famille ne voulut pas de funérailles pompeuses, mais un enterrement dans la terre de Nohant. Comme GS était considérée comme déiste, il fallut, pour pouvoir passer par l'église, que Solange demande par télégramme l'autorisation de l'archevêque de Bourges. Dès le matin, des attelages de paysans, venus parfois de loin, envahirent le village. Le cercuei, exposé d'abord au bas du grand escalier, fut porté de la maison au cimetière par six paysans, les cordons du poêle étant tenus par deux neveux de la défunte, le prince Napoléon, parrain de sa petite fille, et Alexandre Dumas. Suivirent Renan, Flaubert, Calman-Levy et d'autres. Après le passage à l'église, où l'on n'entendit nulle musique mais la voix chevrotante du vieux chantre, on alla au cimetière sous une pluie battante. Alexandre Dumas avait passé la nuit à préparer un discours, mais il dut laisser la parole à un conseiller général, M. Périgois, puis à Paul Meurice lisant un texte de Victor Hugo. La première oraison funèbre fit pleurer l'assistance, celle de Hugo, jugée trop intellectuelle, ne suscita aucune émotion ("Je pleure une morte, et je salue une immortelle…"). Toujours sous la pluie, chacun jeta sur le cercueil une branche de laurier, et l'on se sépara.
Flaubert : "La mort de la pauvre mère Sand m'a fait une peine infinie. J'ai pleuré à son enterrement comme un veau, et par deux fois, la première en embrassant sa petite-fille Aurore (dont les yeux ce jour-là ressemblaient tellement aux siens que c'était comme une résurrection) – et la seconde, en voyant passer devant moi son cercueil. Il y a eu là de belles histoires ! Pour ne pas blesser «l'opinion publique», l'éternel et exécrable on, on l'a portée à l'église ! Je vous donnerai les détails de cette bassesse. J'avais le cœur bien serré ! Mes compagnons de route, Renan et le prince Napoléon, ont été charmants, celui-là parfait de tact et de convenance et il a vu clair, dès le début, mieux que nous deux. Vous avez raison de regretter notre amie, car elle vous aimait beaucoup et ne parlait jamais de vous qu'en vous appelant «le bon Tourgueneff». Mais pourquoi la plaindre ? Rien ne lui a manqué. – Elle restera une très grande figure. Les bonnes gens de la campagne pleuraient beaucoup autour de sa fosse. Dans ce petit cimetière de campagne, on avait de la boue jusqu'aux chevilles. Une pluie douce tombait. Son enterrement ressemblait à un chapitre d'un de ses livres." (Flaubert à Tourgueniev, 25 juin 1876)jn-1976
QUELQUES TÉMOIGNAGES D'EDMOND PLAUCHUT SUR LA VIE À NOHANT
Lucien-Joseph-Edmond Plauchut est né en 1824 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Sa correspondance avec George Sand débuta en 1848. Expatrié volontaire à la suite de la chute de la République, il partit vers Singapour. Au cours du voyage, il fit naufrage au large des îles du Cap-Vert et ne put sauver qu'une cassette contenant les lettres de G. Sand grâce auxquelles il fut recueilli, nourri, habillé par un riche Portugais. Après de nombreux voyages vers l'Extrême-Orient, il rencontrera George Sand en 1861. Invité à Nohant en 1865, il y fit de fréquents séjour de 1868 à 1876 et fut très rapidement intégré à la vie de la famille jusqu'à sa mort en janvier 1909. Aurore Dudevant accepta qu'il ait sa tombe non loin de celle de George Sand.
Pourquoi s'habilla-t-elle avec des vêtements masculins ? "J'apprenais mon métier de littérateur, disait-elle, en allant alors fréquemment au théâtre, mais comme je n'étais pas assez riche pour m'offrir un fauteuil d'amphithéâtre ou une loge, j'avais pris le parti de me déguiser en étudiant, persuadée que je serais plus respectée au parterre sous mes vêtements d'homme, qu'en première loge sous un vêtement de femme. Les poètes de l'école romantique, dont Théophile Gautier était le chef, portaient les cheveux bouclés et tombants sur les épaules. Cela donnait à ces jeunes gens une apparence des plus efféminées, et, c'est certainement à cette mode que je dus de ne pas être reconnue au théâtre, même par mes compatriotes. Dans le jour, je m'habillais tout naturellement comme mes semblables. Dans le Tyrol, en Suisse – mais là seulement, – je pris la blouse, et toujours, parce que n'ayant pas assez d'argent pour aller en poste, il me fallait bien aller à pied."
Nohant cher à son coeur : "Ces sillons de terres brunes et grasses ; ces gros noyers tout ronds, ces petits chemins ombragés, ces buissons en désordre, ce cimetière plein d'herbes, ce petit clocher couvert de tuiles, ce porche de bois brut, ces grands ormeaux délabrés, ces maisonnettes de paysans entourées de leurs jolis enclos, de leurs berceaux de vigne et de leurs vertes chènevières, tout cela, disait-elle, devient doux et cher à la pensée quand on a vécu longtemps dans ce milieu calme et silencieux."
Des bruits étranges provenant de la demeure – Des paysans, qui à l'heure de minuit passaient non loin des haies dont il est clos, et qui s'en revenaient un peu ivres d'une foire des environs, prétendaient que le château et le bois étaient hantés par des esprits et que "ça y revenait". Il s'en échappait à "nuitée", disaient-ils, des cris furieux et des plaintes, des voix qui riaient, qui chantaient, puis des coups de feu, le son d'un tambour battant la charge, des bruits de batailles et des instruments de musique jouant, le diable seul savait pour qui. Les paysans de ce temps-là ne savaient pas encore ce qu'était un théâtre ; ils ignoraient que tous les soirs, ou plutôt chaque nuit, on jouait la comédie ou le drame au château, et que c'étaient des voix d'artistes, des soli de piano ou de violon qui, par les fenêtres ouvertes, se répandaient dans la campagne silencieuse.
Taquineries et railleries de George Sand – Jamais, même dans sa vieillesse, madame Sand ne se priva du plaisir de taquiner ceux qu'elle aimait le plus. Que de fois n'a-t-elle pas jeté dans le lit d'Eugène Lambert et d'Édouard Cadol les brosses de leur table de toilette, ou retardé d'une bonne heure la pendule de la cuisine, pour les faire pester contre la lenteur du temps. Combien de fois aussi, un livre lancé très adroitement par sa petite main n'est-il pas tombé sur mon nez, lorsque, à l'époque de la chasse, je m'assoupissais, sans respect pour mes hôtes, autour de la fameuse table de Pierre Bonnin ? Toutes ses malices étaient enfantines, et celle qui se les permettait les rachetait par tant de bontés qu'on était malheureux dès qu'on n'en était plus la "victime".
Je l'ai vue pourtant se moquer assez crûment des importuns qui s'obstinaient à forcer sa porte lorsque, malade ou très occupée, elle refusait de les recevoir. C'est ce qui arriva à une Anglaise ; circonstance aggravante, cette Anglaise devait lui remettre une décoration et le titre d'adhérente à une société humanitaire quelconque.
– Interrogez-moi donc, finit par dire avec résignation madame Sand à ce reporter en jupons qui, le carnet à la main, s'était présentée dix fois chez elle en deux jours.
– A quelle heure travaillez-vous, madame ?
– Jamais je ne travaille.
– Ho ! mais vos livres... quand les faites-vous ?
– Ils se font d'eux-mêmes, le matin, le soir et la nuit.
–
Quel est votre roman préféré ?
– Olympia.
– Ho ! je ne le connais pas.
– Peut-être ne l'ai-je pas fait encore.
Et ce fut tout, car madame Sand se leva, prête à éclater, en voyant que ses réponses allaient être consignées sur le carnet que l'Anglaise tenait toujours à la main.
Ue journée de George Sand à Nohant – A neuf heures du matin, été comme hiver, une domestique berrichonne, au tablier immaculé et à la coiffe bien épinglée, entrait dans la chambre de George Sand pour la réveiller, lui servir un très léger déjeuner, du café, et pour lui remettre ses lettres, ses journaux et les livres que des auteurs inconnus ou célèbres lui envoyaient. […]
A midi, elle descendait dans la salle à manger, où sa jeune famille et ses invités prenaient leur repas. Cette famille se composait de son fils Maurice, de madame Maurice Sand, petite-fille de Houdon et de Raoul Rochette, de deux fillettes, Aurore et Gabrielle, leurs enfants.
Après de tendres embrassades aux siens, une cordiale poignée de main aux amis, une caresse à son vieux chien Fadet, une mie de pain aux oiseaux, madame Sand conviait les personnes présentes à une promenade dans le jardin ou dans le bois. Elle visitait une à une les fleurs qu'elle aimait, leur parlait quelquefois, recommandant bien de ne pas les couper, de les laisser vivre. On restait dehors en s'entretenant toujours gaiement jusqu'à deux heures.
Elle rentrait alors dans sa bibliothèque pour donner une leçon à ses fillettes ou travailler, calme et souriante, au milieu de leurs jeux. Sa table de travail était encombrée de poupées et de joujoux. Quoique souvent perdue dans ses rêveries, elle n'en suivait pas moins de son regard tendre les ébats des enfants ; Fadet y jouait un rôle. Plus les jeux étaient fous et bruyants et plus le visage de la grand'mère rayonnait de joie et de bonheur intérieur.
A six heures précises, le dîner. L'été, après une nouvelle visite aux fleurs du jardin, on rentrait au salon, où madame Sand faisait danser les enfants jusqu'au moment du coucher. Souvent, elle restait devant son piano sans s'inquiéter des personnes présentes. Elle jouait de préférence du Mozart, des airs d'Espagne ou encore de vieux refrains berrichons qu'elle avait appris dans son enfance lorsque, avec son frère Hippolyte, elle allait danser la bourrée aux fêtes des villages voisins.
Les enfants couchés, et après une partie de dominos et de cartes, elle confectionnait avec une adresse de fée des robes pour les poupées d'Aurore et de Gabrielle, ses deux petites-filles, ou des costumes pour les marionnettes de son fils. Parfois aussi, elle faisait des dendrites, sorte d'aquarelles imitant les dessins que l'on trouve sur les pierres carbonisées, ou encore des patiences jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Pendant quelques-unes de ces silencieuses veillées, lorsque la neige tombait sur la campagne déserte ou quand, au printemps, par les fenêtres entr'ouvertes, les chants du rossignol se mêlaient aux causeries, Flaubert, Tourgueneff et bien d'autres personnages en renom, lurent plusieurs de leurs œuvres inédites. […] Elle y lisait aussi elle-même, et très rapidement, à ses enfants et à ses amis en villégiature, les romans qu'elle venait d'achever. […] Les veillées littéraires étaient toutefois des exceptions, car, en dehors des heures du travail, il était interdit de parler littérature autour de la table de Pierre Bonnin.
Flaubert à Nohant – L'auteur de Salammbô, que madame Sand affectionna comme on aime un fils malade, comme elle avait aimé le graveur Manceau, Chopin – qui partit irrité de Nohant parce que madame Sand lui refusa sa fille le sachant depuis longtemps condamné à une mort prématurée – avait seul le privilège de tout dire contre ses confrères, les gens en place, les Bouvards et les Pécuchets. Un jour que Flaubert s'était exaspéré plus que de coutume contre ses éditeurs ou un "bourgeois" quelconque, Maurice Sand, qui voyait sa mère fatiguée, imagina, en ma compagnie et celle de ses fillettes, d'organiser un charivari dans la salle à manger, voisine du salon où se trouvait le pourfendeur des bourgeois. Au premier coup frappé sur les pincettes, Flaubert vint vers nous, bondissant, indigné, criant qu'on ne s'entendait plus et que nous étions d'un bas comique. Madame Sand, qui le suivait, avait, de son côté, pris une pelle et s'était, pleine d'entrain, jointe à nous. Flaubert prit la fuite comme un homme qu'on assassine, mais pour revenir au plus vite, costumé en femme andalouse, un tambour de basque à la main et dansant le plus désordonné des fandangos.
George Sand et la cloche de l'église – Un jour de Sainte-Anne, jour de fête de Nohant, George Sand entendit, de son jardin, la cornemuse du maître sonneur Gerbaud qui, sous les ormeaux, faisait danser sur la pelouse la jeunesse du bourg. […] Elle sortit de chez elle et vint s'asseoir sur une dalle moussue qui fait face à l'église, sorte de banc appelé la "pierre des morts". On y dépose les cercueils en attendant l'arrivée du prêtre. George Sand se vit bientôt entourée de bonnes vieilles aux chefs branlants, de bonshommes à l'échine courbée par le travail, et de jeunes femmes qui, très proprement attiffées, le callot brodé sur la tête, s'empressèrent de lui porter leurs poupons. J'étais là, et je vis tous les paysans de Nohant et des environs, heureux de renouveler connaissance avec elle. […] Alors, s'adressant au vieux fossoyeur et sacristain, le père Carnat.
– Tu t'endors donc en sonnant ta cloche, que tu n'en finis jamais ? Sais-tu que chaque matin tu m'empêches de dormir ?
– Bon sang de bon sang ! c'est-y ben possible, ma boune dame !
Et voilà le père Carnat qui s'excuse, puis qui raconte que, par une nuit très noire, par un temps d'orage effrayant, il était sorti de son lit pour mettre sa cloche en branle, afin de détourner la grêle qui menaçait les blés ; il sonnait à toute volée, lorsque, à la lueur d'éclairs livides, il vit apparaître une forme confuse sur le porche de l'église, puis cette forme s'avancer à tâtons les mains en avant, dans sa direction. "Mon sang ne fit qu'un tour, dit le père Carnat à ceux qui l'écoutaient, et pour sûr que j'allais m'ensauver, quand je reconnus la dame du château ! Ah ! qu'elle était trempée ! Et qu'elle paraissait grande, aux éclairs qui illuminaient l'église comme jamais elle ne l'avait été !… Elle était venue, la dame du châtiau, pour me dire de ne pas sonner parce que ça attirerait la foudre sur moi et que ça me ferait périr... Je ne sonnai plus, mais je me remis à faire tinter doucement ma cloche dès qu'elle fut partie, car si la grêle était tombée sur la commune, on ne m'eût donné ni noix ni froment."
Le père Carnat, mis en verve, raconta encore qu'une belle dame, ben rieuse, lui avait donné cinq francs pour qu'il ne sonnât pas l'Angélus du matin à toute volée. "Et je me dis, ajouta le père Carnat, puisque cette dame – c'était madame Edmond Adam, qui était venue passer quelques jours à Nohant – me donne cinq francs parce que je sonne fort, qui sait si elle ne m'en donnera pas dix en sonnant davantage ? J'en fus pour ma peine, car elle partit sans ren me donner de plus."
La mort de George Sand à Nohant – Le 30 mai 1876, elle s'alita pour ne plus se relever. Un télégramme de Maurice que je reçus à Nice, au retour d'une excursion au Col de Tende, me permit d'assister à ses derniers moments. Le 8 juin, à neuf heures du matin, elle expirait, calme et sereine, son front superbe couronné d'admirables cheveux blancs, cheveux qui, d'après la poétique expression d'Armand Sylvestre, semblaient moins, sur la jeunesse persistante de son visage, le dernier éclair de givre du printemps que le premier frisson de neige de l'automne.
Par les soins pieux de sa famille, de ses vieux serviteurs, et pour se conformer à ses dernières paroles : "De la verdure", elle fut littéralement ensevelie sous les fleurs.
La pluie tombait à torrents le jour des funérailles, et cependant l'église de Nohant fut trop étroite et ne put contenir tous ceux qui étaient accourus pour prier et l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Rien de plus touchant que les paysans et les paysannes, celles-ci enveloppées de leurs capuches de deuil, et qui, agenouillés sur les dalles de la chapelle ou la terre détrempée, priaient, sans souci de la pluie qui ruisselait sur leurs têtes nues, pour la châtelaine dont ils n'avaient jamais imploré en vain la charité. Son corps repose à Nohant, dans ce petit cimetière plein d'herbes dont j'ai parlé, où tant d'êtres qu'elle a chéris et pleurés l'attendaient et où d'autres, non moins aimés, sont allés la rejoindre.
La statue de George Sand – Elle fut inaugurée à la Châtre, en 1880 ; c'est un beau marbre d'Aimé Millet, auquel l'ombre des vieux tilleuls de Nohant eût mieux convenu que le bruit et le jour banal de la place publique. Cette inauguration fut un jour de fête et de glorification. Paris et le Berry y participèrent largement, justifiant ces paroles de Victor Hugo prononcées sur le cercueil de l'illustre femme : "Je pleure une morte et salue une immortelle."
Entre les couronnes déposées au pied de la blanche statue, il y en avait un certain nombre venues de Paris, toutes décorées de larges rubans sur lesquels on lisait en lettres d'or : La marquise de Villemer à George Sand ; François le Champi et la Petite Fadette à la muse du Berry ; et puis, sur quelques-unes, ces noms bien connus : Valentine, Consuelo, Indiana, Mauprat, Jean de la Roche, mademoiselle La Quintinie, héros et héroïnes de la vie romantique de George Sand qui semblaient être venus en ce moment suprême pour la glorifier.
QUELQUES TÉMOIGNAGES DE VISITEURS CÉLÈBRES QUI ONT ÉTÉ REÇUS À NOHANT
LA COMTESSE D’AGOULT
Dans ses Mémoires, elle parle de son séjour à Nohant : promenades au bord de l’Indre, randonnées à cheval dans les matins de juin, nuits passées sur la terrasse à écouter le piano de Liszt. Elle fait le portrait de Maurice (“qui sera l’homme du bon sens, de la règle, des vertus commodes”) et de Solange (“dont la vie sera pleine de luttes et de combats”). En quittant Nohant, le 24 juillet, elle écrira : « Mon séjour à Nohant a été bon… J’y ai trouvé l’amitié, l’oubli du mal et la paix du coeur. »
«La nuit était chaude et calme. Les derniers bruits humains s’étaient depuis longtemps éteints dans l’espace. La nature semblait prendre possession d’elle-même et se réjouir de l’absence de l’homme, en envoyant au ciel toutes ses voix et tous ses parfums… La famille était réunie sur la terrasse. Quelques-uns rêvaient, d’autres, en plus petit nombre, pensaient. Ceux qui ne rêvaient ni ne pensaient parlaient… Mais tout à coup il n’y eut plus ni rêverie, ni parole, ni pensée ; le silence se fit sur nos lèvres et le recueillement descendit dans nos coeurs. Le Maître venait de se mettre au piano. Un accord puissant nous était venu, porté sur les airs…»
AUGUSTE CHARPENTIER a détaillé le programme d'une journée à Nohant :
Le peintre Charpentier est venu à Nohant en avril 1838 pour faire le portrait de George Sand (aujourd'hui à Paris au Musée de la Vie romantique). Il écrit :
«Ma chère tante, je suis encore tout émerveillé de cette célèbre Mme Sand. Le public ne la connaît pas du tout, et tout ce que l'on veut bien lui prêter ne sont que d'abominables calomnies. Mme Sand est la meilleure mère de famille et la femme la plus excellente que l'on puisse imaginer. [...] C'est la plus admirable tête que l'on puisse voir, et je ne suis pas encore revenu de ma première impression. Je commence son portrait demain seulement, j'ai voulu avant passer une journée pour étudier son admirable personne. [...] On mène ici l'existence la plus heureuse et la plus libre possible. Tout le monde se lève quand bon lui semble parce qu'on ne se réunit pas pour déjeuner. A sept ou huit heures du matin un domestique vient vous allumer un énorme feu et vous demande ce que vous désirez pour déjeuner, chacun est servi chez soi. Après le déjeuner on travaille ou on se rend mutuellement visite ou on fait une partie de billard pour se reposer. Dans le courant de la journée Mme Sand reste chez elle à travailler, elle ne reçoit personne. A cinq heures, la cloche sonne, on s'habille, et tout le monde se trouve réuni pour dîner, alors de ce moment on vit en famille, on passe au salon et là, fume la cigarette qui veut. Mme Sand en montre l'exemple. Mais tout cela le plus noblement possible. C'est depuis ces deux soirées que j'ai pu admirer cette femme si belle et si remarquable à qui on ne donnerait pas plus de vingt-huit ans. Les deux enfants sont magnifiques et remplis de moyens. A onze heures on se retire, et chacun trouve rentrant dans sa chambre un superbe feu, sa couverture faite, des verres d'eau sucrée, etc., et enfin tout le luxe d'un véritable château. Voici en gros, ma chère tante, la vie intérieure et journalière que l'on passe dans le château de Nohant.»
Le Musée de la Vie romantique conserve également un éventail sur lequel Auguste Charpentier et Gavarni ont caricaturé George Sand et ses hôtes de Nohant.
EUGÈNE DELACROIX a séjourné à Nohant du 4 juin au 2 juillet 1842.
«Le lieu est très agréable…; quand on n’est pas réuni pour dîner, déjeuner, jouer au billard ou se promener, on est dans sa chambre à sa goberger sur un canapé. Par instants, par la fenêtre ouverte sur le jardin, il vous arrive des bouffées de la musique de Chopin qui travaille de son côté ; cela se mêle au chant des rossignols et à l’odeur des rosiers.»

Un coin du parc de Nohant, par Delacroix
ELISA FOURNIER
Cette jeune femme de La Rochelle, aménée par les Duvernet, a passé à Nohant la soirée du 9 juillet 1846 en compagnie de Chopin.
Quelle soirée nous avons passée, chère mère ! Au milieu de ces impressions délicieuses, je te regrettais plus que jamais, car tu eusses été bien heureuse d'entendre comme nous l'admirable talent de Chopin, il a été d'une complaisance infinie, il était monté à la musique, et il n'a cessé que vers minuit de nous faire passer à son gré par toutes les émotions heureuses ou tristes, gaies ou sérieuses, suivant qu'il les éprouvait lui-même. Je n'ai de ma vie entendu un talent comme celui-là ; c'est prodigieux de simplicité, de douceur, de bonté et d'esprit. Il nous a joué dans ce dernier genre la charge d'un opéra de Bellini, qui nous a fait rire à nous tordre, tant il y avait de finesse d'observation et de spirituelle moquerie du style et des habitudes musicales de Bellini ; puis une prière des Polonais dans la détresse, qui nous arrachait des larmes ; puis une étude sur le bruit du tocsin, qui faisait frissonner ; puis une marche funèbre, si grave, si sombre, si douloureuse, que nos cœurs se gonflaient, que notre poitrine se serrait et qu'on n'entendait, au milieu de notre silence, que le bruit de quelques soupirs mal contenus par une émotion trop profonde pour être dominée. Enfin sortant de cette inspiration douloureuse et rappelé à lui même après un moment de repos par quelques notes chantées par Mme George, il nous a fait entendre de jolis airs d'une danse appelée la bourrée, qui est tout à fait commune dans le pays et dont les motifs recherchés avec soin par lui, forment un recueil précieux, plein de grâce et de naïveté. Enfin il a terminé cette longue et trop heureuse séance par un tour de force dont je n'avais nulle idée. Il a imité sur le piano les petites musiques qu'on enferme dans des tabatières, des tableaux, etc., et cela avec une vérité telle que si nous n'avions pas été dans le même appartement que lui, nous n'aurions jamais pu croire que ce fût un piano qui résonnait sous ses doigts. Tout ce perlé, cette finesse, cette rapidité des petites touches d'acier qui fait vibrer un cylindre imperceptible était rendu avec une délicatesse sans pareille, puis tout à coup une cadence sans fin et si faible qu'on l'entendait à peine se faisait entendre et était instantanément interrompue par la machine qui probablement avait quelque chose de dérangé. Il nous a joué un de ces airs, la tyrolienne, je crois, dont une note manquait au cylindre et toujours cette note accrochait chaque fois qu'elle eût dû être jouée...
THEOPHILE GAUTIER (d’après les Goncourt)
— Ah! mais, à propos, Gautier, vous revenez de Nohant, de chez Madame Sand, est-ce amusant ?
— Comme un couvent des Frères Moraves. Je suis arrivé le soir. C’est loin du chemin de fer. On a mis ma malle dans un buisson. Je suis entré par la ferme, au milieu de chiens qui me faisaient une peur… On m’a fait dîner. La nourriture est bonne, mais il y a trop de gibier et de poulet. Moi, ça ne me va pas… Là étaient Marchal le peintre, Madame Calamatta, Alexandre Dumas fils…
— Et quelle est la vie à Nohant ?
— On déjeune à dix heures. Au dernier coup, quand l’aiguille est sur l’heure, chacun se met à table. Madame Sand arrive avec un air de somnambule, et reste endormie tout le déjeuner… Après le déjeuner, on va dans le jardin. On joue au “cochonnet”, ça la ranime. Elle s’assied et se met à causer. On cause généralement, à cette heure, des choses de prononciation : par exemple, sur la prononciation d’«ailleurs» et «meilleur». La cauderie affriolante toutefois, ce sont les plaisanteries stercoraires.
— Bah!
— Mais, par exemple, pas le plus petit mot sur le rapport des sexes. Je croix qu’on vous flanquerait à la porte si vous y faisiez la moindre allusion… A trois heures, Madame sand remonte faire de la copie jusqu’à six heures. On dîne, seulement on dîne un peu vite, pour laisser le temps de dîner à Marie Caillot. C’est la bonne de la maison, une petite Fadette que Madame Sand a prise dans le pays, pour jouer les pièces de son théâtre, et qui vient au salon, le soir.
Après dîner, Madame Sand fait des patiences sans dire un mot, jusqu’à minuit… Par exemple, le second jour, j’ai commencé à dire que si l’on ne parlait pas littérature, je m’en allais… Ah! littérature… ils semblaient revenir tous de l’autre monde !… Il faut vous dire que, pour le moment, il n’y a qu’une chose dont on s’occupe là-bas : la minéralogie. Chacun a son marteau, on ne sort pas sans… J’ai donc déclaré que Rousseau était le plus mauvais écrivain de la langue française, et cela nous a fait une discussion avec Madame Sand jusqu’à une heure du matin…
Tout de même, Manceau lui a joliment machiné ce Nohant pour la copie. Elle ne peut s’asseoir dans une pièce sans qu’il surgisse des plumes, de l’encre bleue, du papier à cigarettes, du tabac turc et du papier à lettres rayé. Et elle en use. Car vous n’ignorez pas qu’elle retravaille à minuit jusqu’à quatre heures… Enfin vous savez ce qui lui est arrivé. Quelque chose de monstrueux ! Un jour, elle finit un roman à une heure du matin… et elle en recommence un autre dans la nuit… La copie est une fonction chez Madame Sand…
Au reste, on est très bien chez elle. Par exemple, c’est un service silencieux. Il ya dans le corridor une boîte qui a deux compartiments : l’un est destiné aux lettres pour la poste, l’autre aux lettres pour la maison. Dans ce dernier, on écrit tout ce dont on a besoin, en indiquant son nom et sa chambre. J’ai eu besoin d’un peigne. J’ai écrit : «M. Gautier, telle “chambre” et ma demande. Le lendemain à six heures, j’avais trente peignes à choisir». (Jules et Edmond de Goncourt, Journal, II, 116-118.)
ALEXANDRE DUMAS FILS évoque George Sand dans sa maison de Palaiseau :
« Il est midi, l’heure où l’on voit tout ! Regardez cette femme qui descend les marches de son perron. Elle a les cheveux grisonnants sous son petit chapeau de paille ; elle est toute seule, elle se promène au soleil, doucement ; elle contemple son horizon vulgaire ; elle écoute les bruits vagues de la nature ; elle s’amuse à suivre de l’oeil les nuées… Elle cause avec le jardinier ; elle se penche pour respirer ses fleurs, qu’elle se garde bien de cueillir ; elle s’arrête, elle écoute ! Quoi ? Elle n’en sait rien elle-même ! Quelque chose qui n’est pas encore et qui sera un jour. Elle s’assied sur son banc de pierre. Elle ne bouge plus. La voilà fondue dans l’immensité, la voilà plante, étoile, brise, océan, âme ! Elle se souvient ! Elle devine ! Tout ce qu’on entend au milieu des flots, elle l’entend sous son dôme de lilas, et les oiseaux, et les tempêtes, et tout ce qui chante et tout ce qui pleure, et tout ce qui rit. Elle va errer, regarder, écouter ainsi, sans bien savoir ce qu’elle accomplit, somnambule de jour, et, à mesure que l’ombre gagnera la plaine, — comme ces plantes qui se sont imprégnées du matin au soir de rosée et de rayons, de pluie et de soleil, et qui ne s’ouvrent et n’exhalent leurs parfums que la nuit —, la nuit, cette femme restituera au monde de l’âme et de l’esprit tout ce qu’elle a reçu du monde matériel et visible ; car cette femme, elle pense comme Montaigne, elle rêve comme Ossian, elle écrit comme Jean-Jacques. » (Préface du Fils Naturel)
QUELQUES TEXTES DE GEORGE SAND SUR NOHANT
L'achat de Nohant par sa grand-mère
Ce fut au milieu de la Révolution que, des minces débris d'une très grande fortune, ma grand-mère, madame Dupin de Francueil, fit acheter une petite terre en Berry. Elle avait habité Châteauroux, où son mari avait été receveur général des finances; elle y avait laissé des amis, elle savait le pays tranquille. La grande préoccupation des personnes, que le nouvel état des choses effrayait, était alors de fuir Paris et de se réfugier dans quelque province où le choc social vînt s'amortir dans le calme des habitudes et la douceur des relations. Sous ce rapport, le Berry, et surtout la partie que nous appelons la Vallée-Noire, est une sorte d'oasis, où, en bien comme en mal, le changement arrive sans grandes secousses, et cela de temps immémorial. J'ignore si ma grand-mère connaissait Nohant lorsqu'elle en fit l'acquisition. Elle y fut longtemps fort gênée et ne put jamais y introduire le luxe de ses anciennes habitudes.
La maison de Nohant
La maison est saine, aérée et bien disposée pour contenir une famille. La distribution à laquelle je n'ai presque rien changé est telle que je n'y peux loger que quelques amis. Le système des petites chambres nombreuses et serrées qui permet d'entasser beaucoup de personnes sous le même toit n'a pas été adopté dans cette construction médiocrement spacieuse pour une maison de campagne, et infiniment trop petite pour être un château. Mais, telle qu'elle est, elle s'est prêtée à nos besoins, à nos goûts et aux nécessités de nos occupations : nous avons trouvé moyen d'y faire deux ateliers de peinture, un atelier de gravure, une petite bibliothèque, un petit théâtre avec vestiaire et magasin de décors.
L'environnement de la maison de Nohant
Je dirai quelques mots de cette terre de Nohant où j'ai été élevée, où j'ai passé presque toute ma vie et où je souhaiterais pouvoir mourir. Le revenu en est peu considérable, l'habitation est simple et commode. Le pays est sans beauté, bien que situé au centre de la Vallée Noire, qui est un vaste et admirable site. Mais précisément cette position centrale dans la partie la plus nivelée et la moins élevée du pays, dans une large veine de terres à froment, nous prive des accidents variés et du coup d'oeil étendu dont on jouit sur les hauteurs et sur les pentes. Nous avons pourtant de grands horizons bleus et quelque mouvement de terrain autour de nous, et, en comparaison de la Beauce et de la Brie, c'est une vue magnifique; mais, en comparaison des ravissants détails que nous trouvons en descendant jusqu'au lit caché de la rivière, à un quart de lieu de notre porte, et des riantes perspectives que nous embrassons en montant sur les coteaux qui nous dominent, c'est un paysage nu et borné.
Quoi qu'il en soit, il nous plaît et nous l'aimons. Ma grand-mère l'aima aussi, et mon père y vint chercher de douces heures de repos à travers les agitations de sa vie. Ces sillons de terres brunes et grasses, ces gros noyers tout ronds, ces petits chemins ombragés, ces buissons en désordre, ce cimetière plein d'herbes, ce petit clocher couvert de tuiles, ce porche de bois brut, ces grands ormeaux délabrés, ces maisonnettes de paysan entourées de leurs jolies enclos, de leurs berceaux de vigne et de leurs vertes chènevières, tout cela devient doux à la vue et cher à la pensée quand on a vécu si longtemps dans ce milieu calme, humble et silencieux.
Le château, si château il y a (car ce n'est qu'une médiocre maison du temps de Louis XVI), touche au hameau et se pose au bord de la place champêtre sans plus de faste qu'une habitation villageoise. Les feux de la commune, au nombre de deux ou trois cents, sont fort dispersés dans la campagne; mais il s'en trouve une vingtaine qui se resserrent auprès de la maison, comme qui dirait porte à porte, et il faut vivre d'accord avec le paysan, qui est aisé, indépendant, et qui entre chez vous comme chez lui. Nous nous en sommes toujours bien trouvés, et, bien qu'en général les propriétaires aisés se plaignent du voisinage des ménageots, il n'y a pas tant à se plaindre des enfants, des poules et de chèvres de ces voisins-là qu'il n'y a à se louer de leur obligeance et de leur bon caractère.
Les paysans de Nohant
Les gens de Nohant, tous paysans, tous petits propriétaires (on me permettra bien d’en parler et d’en dire du bien, puisque, par exception, je prétends que le paysan peut être bon voisin et bon ami), sont d'une humeur facétieuse sous un air de gravité. Ils ont de bonnes moeurs, un reste de piété sans fanatisme, une grande décence dans leur tenue et dans leurs manières, une activité lente mais soutenue, de l'ordre, une propreté extrême, de l'esprit naturel et de la franchise. […] Il ne sont ni flatteurs ni rampants et chaque jour je leur ai vu prendre plus de fierté bien placée, plus de hardiesse bien entendue, sans que jamais ils aient abusé de la confiance qui leur était témoignée. Ils ne sont point grossiers non plus. Ils ont plus de tact, de réserve et de politesse que je n'en ai vu régner toujours parmi ceux qu'on appelle les gens bien élevés. (Histoire de ma vie, I, 122)
Les soirs d'hiver à Nohant pour la petite Aurore
Je me souviens que, dans les soirs d’hiver, ma mère nous lisait tantôt du Berquin, tantôt les Veillées du château, par madame de Genlis, et tantôt d’autres fragments de livres à notre portée, mais dont je ne me souviens plus. J’écoutais d’abord attentivement. J’étais assise aux pieds de ma mère, devant le feu, et il y avait entre le feu et moi un vieux écran à pieds garni de taffetas vert. Je voyais un peu le feu à travers ce taffetas usé, et il y produisait de petites étoiles dont j’augmentais le rayonnement en clignant les yeux. Alors peu à peu je perdais le sens des phrases que lisait ma mère ; sa voix me jetait dans une sorte d’assoupissement moral, où il m’était impossible de suivre une idée. Des images se dessinaient devant moi et venaient se fixer sur l’écran vert. C’étaient des bois, des prairies, des rivières, des villes d’une architecture bizarre et gigantesque, comme j’en vois encore souvent en songe ; des palais enchantés avec des jardins comme il n’y en a pas, avec des milliers d’oiseaux d’azur d’or et de pourpre, qui voltigeaient sur les fleurs et qui se laissaient prendre comme les roses se laissent cueillir. Il y avait des roses vertes, noires, violettes, des roses bleues surtout. Il paraît que la rose bleue a été longtemps le rêve de Balzac. Elle était aussi le mien dans mon enfance, car les enfants, comme les poètes, sont amoureux de ce qui n’existe pas. Je voyais aussi des bosquets illuminés, des jets d’eau, des profondeurs mystérieuses, des ponts chinois, des arbres couverts de fruits d’or et de pierreries. Enfin, tout le monde fantastique de mes contes devenait sensible, évident, et je m’y perdais avec délices. Je fermais les yeux, et je le voyais encore ; mais quand je les rouvrais, ce n’était que sur l’écran que je pouvais le retrouver. Je ne sais quel travail de mon cerveau avait fixé là cette vision plutôt qu’ailleurs ; mais il est certain que j’ai contemplé sur cet écran vert des merveilles inouïes. Un jour ces apparitions devinrent si complètes que j’en fus comme effrayée et que je demandai à ma mère si elle ne les voyait pas. Je prétendais qu’il y avait de grandes montagnes bleues sur l’écran, et elle me secoua sur ses genoux en chantant pour me ramener à moi-même.
Espiègleries avec son demi-frère Hippolyte
J’avoue bien, malgré mon amitié pour mon frère, que c’était un enfant insupportable. Il ne songeait qu’à briser, à détruire, à taquiner, à jouer de mauvais tours à tout le monde. Un jour il lançait des tisons enflammés dans la cheminée, sous prétexte de sacrifier aux dieux infernaux, et il mettait le feu à la maison. Un autre jour il mettait de la poudre dans une grosse bûche pour qu’elle fît explosion dans le foyer et lançât le pot-au-feu au milieu de la cuisine. Il appelait cela étudier la théorie des volcans. Et puis il attachait une casserole à la queue des chiens et se plaisait à leur fuite désordonnée et à leurs cris d’épouvante à travers le jardin. Il mettait des sabots aux chats, c’est-à-dire qu’il leur engluait les quatre pieds dans des coquilles de noix et qu’il les lançait ainsi sur la glace ou sur les parquets, pour les voir glisser, tomber et retomber cent fois avec des jurements épouvantables. D’autres fois, il disait être Calchas, le grand prêtre des Grecs, et, sous prétexte de sacrifier Iphigénie sur la table de la cuisine, il prenait le couteau destiné à de moins illustres victimes, et s’évertuant à droite et à gauche, il blessait les autres ou lui-même.
Je prenais bien quelquefois un peu de part à ses méfaits, dans la mesure de mon tempérament, qui était moins fougueux. Un jour que nous avions vu tuer un cochon gras dans la basse-cour, Hippolyte s’imagina de traiter comme tels les concombres du jardin. Il leur introduisait une petite brochette de bois dans l’extrémité qui, selon lui, représentait le cou de l’animal ; puis, pressant du pied ces malheureux légumes, il en faisait sortir tout le jus. Ursule le recueillait dans un vieux pot à fleurs, pour faire le boudin, et j’allumais gravement un feu fictif à côté, pour faire griller le porc, c’est-à-dire le concombre, comme nous l’avions vu pratiquer au boucher. Ce jeu nous plut tellement, que, passant d’un concombre à un autre, choisissant d’abord les plus gras, et finissant par les moins rebondis, nous dévastâmes lestement une couche, objet des sollicitudes du jardinier. Je laisse à penser quelle fut sa douleur quand il vit cette scène de carnage. Hippolyte, au milieu des cadavres, ressemblait à Ajax immolant dans son délire les troupeaux de l’armée des Grecs. Le jardinier porta plainte, et nous fûmes punis ; mais cela ne fit pas revivre les concombres, et on n’en mangea pas cette année-là.
Un autre de nos méchants plaisirs était de faire ce que les enfants de notre village appellent des trompe-chien. C’est un trou que l’on remplit de terre légère délayée dans de l’eau. On le recouvre avec de petits bâtons sur lesquels on place des ardoises et une légère couche de terre ou de feuilles sèches et, quand ce piège est établi au milieu d’un chemin ou d’une allée de jardin, on guette les passants et on se cache dans les buissons pour les voir s’embourber, en vociférant contre les gamins abominables qui s’inventent de pareils tours. Pour peu que le trou soit profond, il y a de quoi se casser les jambes ; mais les nôtres n’offraient pas ce danger-là, ayant une assez grande surface. L’amusant c’était de voir la terreur du jardinier qui sentait la terre manquer sous ses pieds dans les plus beaux endroits de ses allées ratissées, et qui en avait pour une heure à réparer le dommage. Un beau jour Deschartres y fut pris. Il avait toujours de beaux bas à côtes, bien blancs, des culottes courtes et de jolies guêtres de nankin ; car il était vaniteux de son pied et de sa jambe ; il était d’une propreté extrême, et recherché dans sa chaussure. Avec cela, comme tous les pédants (c’est un signe caractéristique à quoi on peut les reconnaître à coup sûr, même quand ils ne font pas métier de pédagogues), il marchait toujours le jarret tendu et les pieds en dehors. Nous marchions derrière lui pour mieux jouir du coup d’œil. Tout d’un coup le sol s’affaisse et le voilà jusqu’à mi-jambe dans une glaise jaune admirablement préparée pour teindre ses bas. Hippolyte fit l’étonné, et toute la fureur de Deschartres dut retomber sur Ursule et sur moi ; mais nous ne le craignions guère, nous étions bien loin avant qu’il eût repêché ses souliers.
Comme Deschartres battait cruellement mon pauvre frère, et qu’il se contentait de dire des sottises aux petites filles, il était convenu entre Hippolyte, Ursule et moi que nous prendrions beaucoup de ces sortes de choses sur notre compte ; et même nous avions, pour mieux donner le change, une petite comédie tout arrangée et qui eut du succès pendant quelque temps. Hippolyte prenait l’initiative. « Voyez ces petites sottes ! criait-il aussitôt qu’il avait cassé une assiette ou fait crier un chien trop près de l’oreille de Deschartres, elles ne font que du mal ! Voulez-vous bien finir, mesdemoiselles ! » Et il se sauvait tandis que Deschartres, mettant le nez à la fenêtre, s’étonnait de ne pas voir les petites filles.
Un jour que Deschartres était allé vendre des bêtes à la foire, car l’agriculture et la régie de nos fermes l’occupaient en première ligne, Hippolyte, étant censé étudier sa leçon dans la chambre du grand homme, s’imagina de faire le grand homme tout de bon. Il endosse la grande veste de chasse, qui lui tombait sur les talons, il coiffe la casquette à soufflet, et le voilà qui se promène dans la chambre en long et en large, les pieds en dehors, les mains derrière le dos à la manière du pédagogue. Puis il s’étudie à imiter son langage, il s’approche du tableau noir, fait des figures avec de la craie, entame une démonstration, se fâche, bégaye, traite son élève d’ignorant crasse et de butor ; puis, satisfait de son talent d’imitation, il se met à la fenêtre et apostrophe le jardinier sur la manière dont il taille les arbres ; il le critique, le réprimande, l’injurie, le menace ; le tout dans le style de Deschartres et avec ses éclats de voix accoutumés. Soit que ce fût assez bien imité, soit la distance, le jardinier qui, dans tous les cas, était un garçon simple et crédule, y fut pris, et commença à répondre et à murmurer. Mais quelle fut sa stupeur quand il vit à quelques pas de lui le véritable Deschartres qui assistait à cette scène et ne perdait pas un des gestes ni une des paroles de son Sosie ! Deschartres aurait dû en rire, mais il ne supportait pas qu’on s’attaquât à sa personnalité, et, par malheur, Hippolyte ne le vit pas, caché qu’il était par les arbres. Deschartres, qui était rentré de la foire plus tôt qu’on ne l’attendait, monta sans bruit à sa chambre et en ouvrit brusquement la porte, au moment où l’espiègle disait d’une grosse voix à un Hippolyte supposé : « Vous ne travaillez pas, voilà une écriture de chat et une orthographe de crocheteur ! pim, pan ! voilà pour vos oreilles, animal que vous êtes ! »
En ce moment la scène fut double, et pendant que le faux Deschartres souffletait un Hippolyte imaginaire, le vrai Deschartres souffletait le véritable Hippolyte. (Histoire de ma Vie, I,702)
Plaisirs dans la campagne autour de Nohant
Tout au milieu de mes rêvasseries sans fin et des chagrins de ma situation, je me développais extraordinairement. J’annonçais devoir être grande et robuste; de douze à treize ans, je grandis de trois pouces et j’acquis une force exceptionnelle pour mon âge et pour mon sexe. Mais j’en restai là, et mon développement s’arrêta au moment où il commence souvent pour les autres. Je ne dépassai pas la taille de ma mère, mais je fus toujours très forte, et capable de supporter des marches et des fatigues presque viriles.
Ma grand-mère, ayant enfin compris que je n’étais jamais malade que faute d’exercice et de grand air, avait pris le parti de me laisser courir, et, pourvu que je ne revinsse pas avec des déchirures à ma personne ou à mes vêtements, Rose m’abandonnait peu à peu à ma liberté physique. La nature me poussait par un besoin invincible à seconder le travail qu’elle opérait en moi et ces deux années, celles où je rêvai et pleurai pourtant le plus, furent aussi celles où je courus et où je m’agitai davantage. Mon corps et mon esprit se commandaient alternativement une inquiétude d’activité et une fièvre de contemplations, pour ainsi dire. Je dévorais les livres qu’on me mettait entre les mains, et puis tout à coup je sautais par la fenêtre du rez-de-chaussée, quand elle se trouvait plus près de moi que la porte, et j’allais m’ébattre dans le jardin ou dans la campagne, comme un poulain échappé. J’aimais la solitude de passion ; j’aimais la société des autres enfants avec une passion égale, j’avais partout des amis et des compagnons. Je savais dans quel champ, dans quel pré dans quel chemin je trouverais Fanchon, Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. Nous faisions le ravage dans les fossés, sur les arbres, dans les ruisseaux. Nous gardions les troupeaux, c’est-à-dire que nous ne les gardions pas du tout et que, pendant que les chèvres et les moutons faisaient bonne chère dans les jeunes blés, nous formions des danses échevelées, ou bien nous goûtions sur l’herbe avec nos galettes, notre fromage et notre pain bis. On ne se gênait pas pour traire les chèvres et les brebis, voire les vaches et les juments quand elles n’étaient pas trop récalcitrantes. On faisait cuire des oiseaux ou des pommes de terre sous la cendre. Les poires et les pommes sauvages, les prunelles, les mûres de buisson, les racines, tout nous était régal. Mais c’était là qu’il ne fallait pas être surpris par Rose, car il m’était enjoint de ne pas manger hors des repas, et si elle arrivait, armée d’une houssine verte, elle frappait impartialement sur moi et sur mes complices.
Chaque saison amenait ses plaisirs. Dans le temps des foins, quelle joie que de se rouler sur le sommet du charroi, ou sur les miloches ! Toutes mes amies, tous mes petits camarades rustiques venaient glaner derrière les ouvriers dans nos prairies, et j’allais rapidement faire l’ouvrage de chacun d’eux, c’est-à-dire que, prenant leurs râteaux, j’entamais dans nos récoltes, et qu’en un tour de main je leur en donnais à chacun autant qu’il en pouvait emporter. Nos métayers faisaient la grimace, et je ne comprenais pas qu’ils n’eussent pas le même plaisir que moi à donner. Deschartres se fâchait ; il disait que je faisais de tous ces enfants des pillards qui me feraient repentir, un jour, de ma facilité à donner et à laisser prendre.
C’était la même chose en temps de moisson ; ce n’étaient plus des javelles qu’emportaient les enfants de la commune, c’étaient des gerbes. Les pauvresses de La Châtre venaient par bandes de quarante et cinquante. Chacune m’appelait pour suivre sa rège, c’est-à-dire pour tenir son sillon avec elle, car elles établissent entre elles une discipline et battent celle qui glane hors de sa ligne. Quand j’avais passé cinq minutes avec une glaneuse, comme je ne me gênais pas pour prendre à deux mains dans nos gerbes, elle avait gagné sa journée et lorsque Deschartres me grondait, je lui rappelais l’histoire de Ruth et de Booz. (Histoire de ma vie, I,823)
La chasse aux alouettes "à la saulnée"
Quel plaisir, n’est-ce pas, de se sentir en famille, auprès d’un bon feu, dans ces longues soirées de campagne, où l’on s’appartient si bien les uns aux autres, où le temps même semble nous appartenir où la vie devient toute morale et tout intellectuelle en se retirant en nous-mêmes ?
L’hiver, ma grand-mère me permettait d’installer ma société dans la grande salle à manger, qu’un vieux poêle réchauffait au mieux. Ma société, c’était une vingtaine d’enfants de la commune qui apportaient là leurs saulnées. La saulnée est une ficelle incommensurable, toute garnie de crins disposés en nœuds coulants pour prendre les alouettes et menus oiseaux des champs en temps de neige. Une belle saulnée fait le tour d’un champ. On la roule sur des dévidoirs faits exprès, et on la tend avant le lever du jour dans les endroits propices. On balaie la neige tout le long du sillon, on y jette du grain, et, deux heures après, on y trouve les alouettes prises par centaines. Nous allions à cette récolte avec de grands sacs que l’âne rapportait pleins.
Comme il y avait de graves contestations pour les partages, j’avais établi le régime de l’association, et l’on s’en trouva fort bien. Les saulnées ne peuvent servir plus de deux ou trois jours sans être regarnies de crins (car il s’en casse beaucoup dans les chaumes), et sans qu’on fasse le rebouclage, c’est-à-dire le nœud coulant à chaque crin dénoué. Nous convînmes donc que ce long et minutieux travail se ferait en commun, comme celui de l’installation des saulnées, qui exige aussi un balayage rapide et fatigant. On se partageait, sans compter et sans mesurer, la corde et le crin; le crin était surtout la denrée précieuse, et c’était en commun aussi qu’on en faisait la maraude: cela consistait à aller dans les prés et dans les étables arracher de la queue et de la crinière des chevaux tout ce que ces animaux voulaient bien nous en laisser prendre sans entrer en révolte. Aussi nous étions devenus bien adroits à ce métier-là, et nous arrivions à éclaircir la chevelure des poulains en liberté, sans nous laisser atteindre par les ruades les plus fantastiques. L’ouvrage se faisait entre nous tous avec une rapidité surprenante, et nous avons été jusqu’à regarnir deux ou trois cents brasses dans une soirée.
Après la chasse venait le triage. On mettait d’un côté les alouettes, de l’autre les oiseaux de moindre valeur. Nous prélevions pour notre régal du dimanche un certain choix, et l’un des enfants allait vendre le reste à la ville, après quoi je partageais l’argent entre eux tous. Ils étaient fort contents de cet arrangement, et il n’y avait plus de disputes et de méfiance entre eux. Tous les jours notre association recrutait de nouveaux adhérents, qui préféraient ce bon accord à leurs querelles et à leurs batailles. On ne pensait plus à se lever avant les autres pour aller dépouiller la saulnée des camarades, et la journée du dimanche était une véritable fête. Nous faisions nous-mêmes notre cuisine de volatiles. Rose était de bonne humeur ces jours-là, car elle était gaie et bonne fille quand elle n’était pas furibonde. La cuisinière faisait l’esprit fort à l’endroit de notre cuisine, le père Saint-Jean seul faisait la grimace et prétendait que la queue de son cheval blanc diminuait tous les jours. Nous le savions bien. (Histoire de ma vie, I,838)
Retour du couvent
J’allai embrasser une dernière fois toutes mes chères amies du couvent. J’étais véritablement désespérée.
Nous arrivâmes à Nohant aux premiers jours du printemps de 1820, dans la grosse calèche bleue de ma grand-mère, et je retrouvai ma petite chambre livrée aux ouvriers qui en renouvelaient les papiers et les peintures ; car ma bonne maman commençait à trouver ma tenture de toile d’orange à grands ramages trop surannée pour mes jeunes yeux, et voulait les réjouir par une fraîche couleur lilas. Cependant mon lit à colonnes, en forme de corbillard, fut épargné, et les quatre plumets rongés des vers échappèrent encore au vandalisme du goût moderne.
On m’installa provisoirement dans le grand appartement de ma mère. Là, rien n’était changé, et je dormis délicieusement dans cet immense lit à grenades dorées qui me rappelait toutes les tendresses et toutes les rêveries de mon enfance.
Je vis enfin, pour la première fois depuis notre séparation décisive, le soleil entrer dans cette chambre déserte où j’avais tant pleuré. Les arbres étaient en fleur, les rossignols chantaient, et j’entendais au loin la classique et solennelle cantilène des laboureurs, qui résume et caractérise toute la poésie claire et tranquille du Berry. Mon réveil fut pourtant un indicible mélange de joie et de douleur. Il était déjà neuf heures du matin. Pour la première fois depuis trois ans, j’avais dormi la grasse matinée, sans entendre la cloche de l’angélus et la voix criarde de Marie-Josèphe m’arracher aux douceurs des derniers rêves. Je pouvais encore paresser une heure sans encourir aucune pénitence. Échapper à la règle, entrer dans la liberté, c’est une crise sans pareille dont ne jouissent pas à demi les âmes éprises de rêverie et de recueillement.
J’allai ouvrir ma fenêtre et retournai me mettre au lit. La senteur des plantes, la jeunesse, la vie, l’indépendance m’arrivaient par bouffées ; mais aussi le sentiment de l’avenir inconnu qui s’ouvrait devant moi m’accablait d’une inquiétude et d’une tristesse profondes. Je ne saurais à quoi attribuer cette désespérance maladive de l’esprit, si peu en rapport avec la fraîcheur des idées et la santé physique de l’adolescence. Je l’éprouvai si poignante que le souvenir très net m’en est resté après tant d’années, sans que je puisse retrouver clairement par quelle liaison d’idées, quels souvenirs de la veille, quelles appréhensions du lendemain, j’arrivai à répandre des larmes amères, en un moment où j’aurais dû reprendre avec transport possession du foyer paternel et de moi-même. Que de petits bonheurs, cependant, pour une pensionnaire hors de cage ! Au lieu du triste uniforme de serge amarante, une jolie femme de chambre m’apportait une fraîche robe de guingan rose. J’étais libre d’arranger mes cheveux à ma guise sans que madame Eugénie me vînt observer qu’il était indécent de se découvrir les tempes. Le déjeuner était relevé de toutes les friandises que ma grand-mère aimait et me prodiguait. Le jardin était un immense bouquet. Tous les domestiques, tous les paysans venaient me faire fête. J’embrassais toutes les bonnes femmes de l’endroit, qui me trouvaient fort embellie parce que j’étais devenue plus grossière, c’est-à-dire, dans leur langage, que j’avais pris de l’embonpoint. Le parler berrichon sonnait à mon oreille comme une musique aimée, et j’étais tout émerveillée qu’on ne m’adressât pas la parole avec le blaisement et le sifflement britanniques. Les grands chiens, mes vieux amis qui m’avaient grondée la veille au soir, me reconnaissaient et m’accablaient de caresses avec ces airs intelligents et naïfs qui semblent vous demander pardon d’avoir un instant manqué de mémoire.
Vers le soir, Deschartres, qui avait été à je ne sais plus quelle foire éloignée, arriva enfin, avec sa veste, ses grandes guêtres et sa casquette en soufflet. Il ne s’était pas encore avisé, le cher homme, que je dusse être changée et grandie depuis trois ans, et, tandis que je lui sautais au cou, il demandait où était Aurore. Il m’appelait mademoiselie, enfin, il fit comme mes chiens, il ne me reconnut qu’au bout d’un quart d’heure.
Tous mes anciens camarades d’enfance étaient aussi changés que moi. Liset était loué, comme on dit chez nous. Je ne le revis pas, il mourut peu de temps après. Cadet était devenu aide-valet de chambre. Il servait à table et disait naïvement à mademoiselle Julie, qui lui reprochait de casser toutes les carafes : « Je n’en ai cassé que sept la semaine dernière. » Fanchon était bergère chez nous. Marie Aucante était devenue la reine de beauté du village. Marie et Solange Croux étaient des jeunes filles charmantes. Pendant trois jours ma chambre ne désemplit pas des visites qui m’arrivaient. Ursule ne fut pas des dernières.
Mais, comme Deschartres, tout le monde m’appelait mademoiselle. Plusieurs étaient intimidés devant moi. Cela me fit sentir mon isolement. L’abîme de la hiérarchie sociale s’était creusé entre des enfants qui jusque-là s’étaient sentis égaux. Je n’y pouvais rien changer, on ne l’eût pas souffert. Je me pris à regretter davantage mes compagnes de couvent.
Pendant quelques jours ensuite, je fus tout au plaisir physique de courir les champs, de revoir la rivière, les plantes sauvages, les prés en fleur. L’exercice de marcher dans la campagne, dont j’avais perdu l’habitude, et l’air printanier me grisaient si bien, que je ne pensais plus et dormais de longues nuits avec délices ; mais bientôt l’inaction de l’esprit me pesa, et je songeai à occuper ces éternels loisirs qui m’étaient faits par l’indulgente gâterie de ma grand-mère.
J’éprouvai même le besoin de rentrer dans la règle, et je m’en tracai une dont je ne me départis pas tant que je fus seule et maîtresse de mes heures. Je me fis naïvement un tableau de l’emploi de ma journée. Je consacrais une heure à l’histoire, une au dessin, une à la musique, une à l’anglais, une à l’italien, etc. Mais le moment de m’instruire réellement un peu n’était pas encore venu. Au bout d’un mois je n’avais fait encore que résumer sur des cahiers ad hoc, mes petites études du couvent. (Histoire de ma vie, I,1015)
Nohant transformé par Casimir
Je passai l’automne et l’hiver suivants à Nohant, tout occupée de Maurice. Au printemps de 1824, je fus prise d’un grand spleen dont je n’aurais pu dire la cause. Elle était dans tout et dans rien. Nohant était amélioré, mais bouleversé ; la maison avait changé d’habitudes, le jardin avait changé d’aspect. Il y avait plus d’ordre, moins d’abus dans la domesticité, les appartements étaient mieux tenus, les allées plus droites, l’enclos plus vaste ; on avait fait du feu avec les arbres morts, on avait tué les vieux chiens infirmes et malpropres, vendu les vieux chevaux hors de service, renouvelé toutes choses, en un mot. C’était mieux, à coup sûr. Tout cela d’ailleurs occupait et satisfaisait mon mari. J’approuvais tout et n’avais raisonnablement rien à regretter ; mais l’esprit a ses bizarreries. Quand cette transformation fut opérée, quand je ne vis plus le vieux Phanor s’emparer de la cheminée et mettre ses pattes crottées sur le tapis, quand on m’apprit que le vieux paon qui mangeait dans la main de ma grand-mère ne mangerait plus les fraises du jardin, quand je ne retrouvai plus les coins sombres et abandonnés où j’avais promené mes jeux d’enfant et les rêveries de mon adolescence, quand, en somme, un nouvel intérieur me parla d’un avenir où rien de mes joies et de mes douleurs passées n’allait entrer avec moi, je me troublai, et sans réflexion, sans conscience d’aucun mal présent, je me sentis écrasée d’un nouveau dégoût de la vie qui prit encore un caractère maladif. (Histoire de ma vie, II,38)
En juillet 1835, George Sand, après son procès, se retrouve seule à Nohant
J’eus donc à Nohant quelques beaux jours d’hiver, où je savourai pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère les douceurs d’un recueillement que ne troublait plus aucune note discordante. J’avais, autant par économie que par justice, fait maison nette de tous les domestiques habitués à commander à ma place. Je ne gardai que le vieux jardinier de ma grand-mère, établi avec sa femme dans un pavillon au fond de la cour. J’étais donc absolument seule dans cette grande maison silencieuse. Je ne recevais même pas mes amis de La Châtre, afin de ne donner lieu à aucune amertume.
Il ne m’eût pas semblé de bon goût de pendre sitôt la crémaillère, comme on dit chez nous, et de paraître fêter bruyamment ma victoire. Ce fut donc une solitude absolue, et, une fois dans ma vie, j’ai habité Nohant à l’état de maison déserte. La maison déserte a longtemps été un de mes rêves. Jusqu’au jour où j’ai pu goûter sans alarmes les douceurs de la vie de famille, je me suis bercée de l’espoir de posséder dans quelque endroit ignoré une maison, fût-ce une ruine ou une chaumière où je pourrais de temps en temps disparaître et travailler sans être distraite par le son de la voix humaine.
Nohant fut donc en ce temps-là, c’est-à-dire en ce moment-là, car il fut court comme tous les pauvres petits repos de ma vie, un idéal pour ma fantaisie. Je m’amusai à le ranger, c’est-à-dire à le déranger moi-même. Je faisais disparaître tout ce qui me rappelait des souvenirs pénibles, et je disposais les vieux meubles comme je les avais vus placés dans mon enfance. La femme du jardinier n’entrait dans la maison que pour faire ma chambre et m’apporter mon dîner. Quand il était enlevé, je fermais toutes les portes donnant dehors et j’ouvrais toutes celles de l’intérieur. J’allumais beaucoup de bougies et je me promenais dans l’enfilade de grandes pièces du rez-de-chaussée, depuis le petit boudoir où je couchais toujours, jusqu’au grand salon illuminé en outre par un grand feu. Puis j’éteignais tout et marchant à la seule lueur du feu mourant de l’âtre je savourais l’émotion de cette obscurité mystérieuse et pleine de pensées mélancoliques, après avoir ressaisi les riants et doux souvenirs de mes jeunes années. Je m’amusais à me faire un peu peur en passant comme un fantôme devant les glaces ternies par le temps, et le bruit de mes pas dans ces pièces vides et sonores me faisait quelquefois tressaillir, comme si l’ombre de Deschartres se fût glissée derrière moi. (Histoire de ma vie, II, 376)
A Nohant, le 6 novembre 1870
Me voilà revenue au nid. Je me suis échappée, ne voulant pas encore amener la famille ; je retournerai ce soir à La Châtre, et je reviendrai demain ici. J’en suis partie, il y a deux mois, par une chaleur écrasante, j’y reviens par un froid très vif. Tout s’est fait brutalement cette année. — Pauvre vieux Nohant désert, silencieux, tu as l’air fâché de votre abandon. Mon chien ne me fait pas le moindre accueil, on dirait qu’il ne me reconnaît pas : que se passe-t-il dans sa tête ? Il a eu froid ces jours-ci, il me boude d’avoir tant tardé à revenir. Il se presse contre mon feu et ne veut pas me suivre au jardin. Est-ce que les chiens eux-mêmes ne caressent plus ceux qui les négligent ? Au fait, s’il est mécontent de moi, comment lui persuaderais-je qu’il ne doit pas l’être ? J’attise le feu, je lui donne un coussin et je vais me promener sans lui. Peut-être me pardonnera-t-il ?
Le jardin que j’ai laissé desséché a reverdi et refleuri comme s’il avait le temps de s’amuser avant les gelées. Il a repoussé des roses, des anémones d’automne, des mufliers panachés, des nigelles d’un bleu charmant, des soucis d’un jaune pourpre. Les plantes frileuses sont rangées dans leur chambre d’hiver. La volière est vide, la campagne muette. Y reviendrons-nous pour y rester ? La maison sera-t-elle bientôt un pauvre tas de ruines comme tant d’autres sanctuaires de famille qui croyaient durer autant que la famille ? Mes fleurs seront-elles piétinées par les grands chevaux du Mecklembourg? Mes vieux arbres seront-ils coupés pour chauffer les jolies pieds prussiens ? Le major Boum ou le caporal Schlag coucheront-ils dans mon lit après avoir jeté au vent mes herbiers et mes paperasses ? Eh bien ! Nohant à qui je viens dire bonjour, silence et recueillement où j’ai passé au moins cinquante ans de ma vie, je te dirai peut-être bientôt adieu pour toujours. En d’autres circonstances, c’eût été un adieu déchirant ; mais si tout succombe avec toi, le pays, les affections, l’avenir, je ne serai point lâche, je ne songerai ni à toi ni à moi en te quittant ! J’aurai tant des choses à pleurer !
QUELQUES MOMENTS DE BONHEUR DE GEORGE SAND À NOHANT
– L'hiver : "J'ai toujours aimé passionnément l'hiver à la campagne. […] On s'imagine à Paris que la nature est morte pendant six mois, et pourtant les blés poussent dès l'automne, et le pâle soleil des hivers, on est convenu de l'appeler comme cela, est le plus vif et le plus brillant de l'année. Quand il dissipe les brumes, quand il se couche dans la pourpre étincelante des soirs de grande gelée, on a peine à soutenir l'éclat de ses rayons. Même dans nos contrées froides, et fort mal nommées tempérées, la création ne se dépouille jamais d'un air de vie et de parure. Les grandes plaines fromentales se couvrent de ces tapis courts et frais, sur lesquels le soleil, bas à l'horizon, jette de grandes flammes d'émeraude. Les prés se revêtent de mousses magnifiques, luxe tout gratuit de l'hiver. Le lierre, ce pampre inutile, mais somptueux, se marbre de tons d'écarlate et d'or. Les jardins mêmes ne sont pas sans richesse. La primevère, la violette et la rose de Bengale rient sous la neige. Certaines autres fleurs, grâce à un accident de terrain, à une disposition fortuite, survivent à la gelée et vous causent à chaque instant une agréable surprise. Si le rossignol est absent, combien d'oiseaux de passage, hôtes bruyants et superbes, viennent s'abattre ou se reposer sur le faîte des grands arbres ou sur le bord des eaux! Et qu'y a-t-il de plus beau que la neige, lorsque le soleil en fait une nappe de diamants, ou lorsque la gelée la suspend aux arbres en fantastiques arcades, en indescriptibles festons de givre et de cristal? Et quel plaisir n'est-ce pas de se sentir en famille, auprès d'un bon feu, dans ces longues soirées de campagne, où l'on s'appartient si bien les uns aux autres, où le temps même semble nous appartenir, où la vie devient toute morale et tout intellectuelle en se retirant en nous-mêmes ?" (Histoire de ma vie)
– Les soirs d'hiver : « L'hiver étend ses voiles gris sur la terre attristée, le froid siffle et pleure autour de nos toits. Mais quelquefois encore, à midi, des lueurs empourprées percent la brume et viennent réjouir les tentures assombries de ma chambre. Alors mon bengali s'agite et soupire dans sa cage, en apercevant, sur le lilas dépouillé du jardin, un groupe de moineaux silencieux, hérissés en boule et recueillis dans une béatitude mélancolique. Le branchage se dessine en noir dans l'air chargé de gelée blanche. Le genêt, couvert de ses gousses brunes, pousse encore tout en haut une dernière grappe de boutons qui essayent de fleurir. La terre, doucement humide, ne crie plus sous les pieds des enfants. Tout est silence, regret et tendresse. Le soleil vient faire ses adieux à la terre, la gelée fond, et des larmes tombent de partout. » [A François Rollinat – Janvier 1835 – Lettres d'un voyageur V]
– Les soirs d'hiver : « Qu'y a-t-il de plus beau que la neige, lorsque le soleil en fait une nappe de diamants, ou lorsque la gelée la suspend aux arbres en fantastiques arcades, en indescriptibles festons de givre et de cristal? Et quel plaisir n'est-ce pas de se sentir en famille, auprès d'un bon feu, dans ces longues soirées de campagne, où l'on s'appartient si bien les uns aux autres, où le temps même semble nous appartenir, où la vie devient toute morale et tout intellectuelle en se retirant en nous-mêmes ? »
Et, six mois avant de mourir, elle écrira : « Que Nohant est beau dans ce moment-ci! C'est une vraie nappe de neige avec les pins et les cèdres blancs jusqu'aux pointes des rameaux. Avec cela, un beau clair de lune tous les soirs. La vie est comme cela, pleine de petits plaisirs innocents et qui ne coûtent rien.» ([HV]
– Les matins de mai : « Il est sept heures du matin. Je ne suis pas encore couchée. Le temps est magnifique aujourd'hui. La couleur renaît avec le soleil, la verdure enveloppée dans les brouillards éclate ce matin, comme si elle était née cette nuit. Les rossignols chantent à gorge déployée. L'horizon est pur, l'air est doux, les parfums montent... » [mai 1837]
– Les soirs d'été sur la terrasse avec Litz et Marie d'Agoult : « Ce soir-là, pendant que Franz jouait les mélodies les plus fantastiques de Schubert, la princesse se promenait dans l'ombre autour de la terrasse. Elle était vêtue d'une robe pâle, un grand voile blanc enveloppait sa tête et presque toute sa taille élancée. Elle marchait d'un pas mesuré qui semblait ne pas toucher le sable et décrivait un grand cercle coupé en deux par le rayon d'une lampe, autour de laquelle toutes les phalènes du jardin venaient danser des sarabandes délirantes. La lune se couchait derrière les grands tilleuls et dessinait dans l'air bleuâtre le spectre noir des sapins immobiles. Un calme profond régnait parmi les plantes, la brise était tombée, mourante, épuisée, sur les longues herbes aux premiers accords de l'instrument sublime. Le rossignol luttait encore, mais d'une voix timide et pâmée. Il s'était approché dans les ténèbres du feuillage et plaçait son point d'orgue extatique comme un excellent musicien qu'il est, dans le ton et dans la mesure. Nous étions tous assis sur le perron, l'oreille attentive aux phrases tantôt charmantes, tantôt lugubres d'Erlkœnig [le Roi des Aulnes]. Engourdis comme toute la nature dans une morne béatitude, nous ne pouvions détourner nos regards du cercle magnétique tracé devant nous par la muette sibylle au voile blanc. Elle se ralentit peu à peu lorsque l'artiste passa par une série de modulations étrangement tristes à la tendre mélodie Sei mir gegrüst. Alors sa démarche prit le milieu entre l'andante et le maestoso, et tous ses mouvements avaient tant de grâce et d'harmonie qu'on eût dit que les sons sortaient d'elle comme d'une lyre vivante. Lorsqu'elle traversait lentement le rayon de la lampe, son voile blanc dessinait sur le fond noir du tableau des contours fins et déliés, tandis que le reste flottait vague et vaporeux dans le mystère de la nuit. Puis elle approchait de nous comme si elle eût voulu se poser sur le lilas blanc, mais, insaisissable comme les ombres, elle s'effaçait lentement. Elle ne semblait pas s'enfoncer sous les voûtes obscures du feuillage. L'obscurité semblait la prendre et l'entraîner dans ses profondeurs en épaississant autour d'elle des rideaux de ténèbres. Au bout de la terrasse, elle était à peine visible, puis elle se perdait tout à fait dans les sapins et reparaissait tout à coup dans le rayon de la lampe comme une création spontanée de la flamme. Puis elle s'effaçait encore et flottait indécise et bleuâtre sur la clairière. Enfin elle vint s'asseoir sur une branche flexible qui ne plia pas plus que si elle eût porté un fantôme. Alors la musique cessa, comme si un lien mystérieux eût attaché la vie des sons à la vie de cette belle femme pâle qui semblait prête à s'envoler vers les régions de l'intarissable harmonie. Elle se leva, glissa par un inexplicable mouvement d'ascension vers le haut du perron et disparut dans la salle ténébreuse. Un instant après nous vîmes une vraie châtelaine du moyen âge traverser la salle voisine à la clarté des flambeaux. Sa chevelure blonde rayonnait comme une auréole d'or, et son voile blanc, jeté sur ses épaules, voltigeait comme un nuage dans le mouvement rapide et léger de sa démarche impérieuse. Les doigts errant sur le piano firent silence, les flambeaux s'éteignirent et la vision rentra dans la nuit.»
(Entretiens journaliers avec le très docte et très habile docteur Piffoël, professeur de botanique et de psychologie, II, 989)
Michelle PERROT,
extrait de "Nohant, un lieu inséparable de sa vie", dans George Sand l'insoumise, Le Monde hors-série, juillet 2018.
J'ai arpenté les lieux en historienne, soucieuse de saisir leurs productions, réelle et imaginaire, leurs mutations, la fascination qu'ils avaient exercée, l'énergie qu'ils avaient absorbée, l'influence que peut-être ils avaient eue sur l'œuvre.
La maison, le jardin, la terre constituent trois enveloppes concentriques.
La maison, elle l'avait héritée de sa grandmère, qui l'avait achetée en 1793 à la faveur de la vente des biens nationaux; elle ne l'avait pas choisie, mais après un temps d'hésitation, elle l'avait investie et désiré la transmettre à ses enfants. De cette thébaïde, elle rêvait de faire un lieu de création, une communauté d'artistes, la seule identité qu'elle se reconnût. Pour cela il fallait la transformer. Instrument plus que home, la maison est toujours en travaux. Il fallait des chambres pour la famille et les amis; des ateliers pour les peintres, Delacroix quand il vient, mais surtout Maurice, son fils, et les jeunes amis de celui-ci; à partir de 1846, des théâtres, théâtre d'acteurs où elle essayait les pièces qu'elle voulait jouer à Paris; théâtre de marionnettes dont Maurice était le maître inventif. Il fallait aussi instaurer un minimum de confort. "Le froid est mon ennemi personnel", dit Sand qui gèle dans les longues nuits d'écriture qui étaient son quotidien. À partir de 1850, l'installation d'un calorifère, objet de plaisanteries sans fin, améliore les choses. Mais souvent "le calorifère est enrhumé". L'eau, l'hygiène étaient d'autres défis, qui nécessitaient une nombreuse domesticité.
Autour de la maison, le jardin qu'elle voulait ouvert (son père avait fait détruire les murs qui l'entouraient), naturel, peuplé d'arbres dont elle avait la passion, et qui empêchaient toute "vue", et de fleurs "à mort", berrichonnes, mais aussi exotiques. Le paysagiste Gilles Clément a dénombré 195 espèces florales différentes dans ce jardin transformé où Sand aimait travailler avec sa petite-fille Nini. Parcelle de nature, le jardin introduit aux sciences naturelles, obsession du siècle et de la maison. Botanique, entomologie, géologie sont l'objet de quêtes, d'excursions, de classements de plus en plus savants qui multiplient les meubles à tiroirs soigneusement étiquetés. Sand préférait les plantes, Maurice les papillons et les pierres. Au-delà de la collection, il y a le désir de comprendre la formation de la Terre et du monde. Résolument évolutionniste, Sand est disciple de Geoffroy Saint-Hilaire et adepte du darwinisme naissant. Elle révère les savants qu'elle convie à Nohant pour de studieuses soirées.
Autour du jardin, il y a la terre : 200 hectares, ce qui, dans un pays de petites tenures (vers 1820, 43 % des exploitations ont moins de 5 ha), fait de Sand une grande propriétaire. La gestion de ces terres, pour laquelle elle n'a ni goût ni aptitude, lui cause un perpétuel tourment. Elle l'a pourtant tenté sérieusement, arpentant les champs en sabots avec ses fermiers qu'elle voudrait convertir à l'élevage alors qu'ils sont obstinés du "bled". Lorsque le fermier Camus réussit à produire une paire de bœufs "monstres", il les conduit à La Châtre, la ville voisine, dans une procession festive mémorable. Sand se lasse de cette gestion qu'après elle son fils Maurice et son épouse Lina Calamatta exercent consciencieusement, suscitant l'admiration narquoise de Flaubert qui s'en inspire pour Bouvard et Pécuchet. Le revenu des terres, de l'ordre de 2,5 %, ne suffisait évidemment pas à l'entretien de Nohant et d'un train de vie qui, sans être fastueux, était généreux et dispendieux. Une maisonnée d'une douzaine de personnes en permanence, constamment accrue par les va-et-vient incessants des invités. Nohant, ce "boulet", exige la "pioche", et l'a poussée à écrire plus sans doute qu'elle ne l'aurait désiré. Mais ce contact concret, direct avec la terre, avec les "gens de la campagne", tels que voulaient désormais s'appeler les paysans, a nourri la pensée et l'œuvre de Sand. D'un point de vue social et quasiment ethnologique. Elle voyait en eux à la fois le produit de la Révolution, et les témoins de très anciennes traditions, venues des Celtes, dont elle s'est fait le barde, observant leurs coutumes, leurs danses, leurs mots, leurs croyances, les fameuses "légendes rustiques", les "visions de la nuit dans nos campagnes" qu'elle a racontées, tandis que Maurice les illustrait.
Nohant est un lieu peuplé. Domestiques, animaux familiers, famille – une famille élargie aux filiations incertaines –, amis berrichons, invités de toutes sortes forment un milieu foisonnant, fluctuant, traversé par les passions, les amours et les amitiés, les conflits souvent cruels. Un lieu créatif : Chopin y a composé les deux tiers de son œuvre, et Sand y a écrit l'essentiel de ses romans.
Un lieu qu'elle aurait voulu soustraire aux ravages du temps. Elle pensait que le centre de la France y échappait en partie, que c'était une espèce de noyau solide, conservateur et conservatoire. Mais elle était consciente que le "progrès", en articulier les chemins de fer, détruisaient sourdement les pratiques et les sociabilités anciennes. […] En 1875, elle confie à un photographe de Châteauroux, Verdot, le soin de faire toute une série de photos des jardins et de l'intérieur. […] Sa maison fut celle d'une vieillesse sereine et d'une mort acceptée. "Vivre et mourir, c'est mourir et vivre de mieux en mieux."
LA VALLÉE NOIRE ET LES ROMANS DE GEORGE SAND
"Les recoins de la France sont peu connus, et ils sont aussi beaux que ceux qu'on va chercher bien loin. J'y trouve des cadres pour mes romans. J'aime à avoir vu ce que je décris; cela simplifie les recherches, les études. N'eussé-je que trois mots à dire d'une localité, j'aime à me tromper le moins que je peux." (George Sand, lettre du 26 nov. 1869 à Louis Ulbach)
MAUPRAT (1836)
Donjon de Sainte-Sévère - Tour Gazeau, où habite le bonhomme Patience
*
LE MEUNIER D'ANGIBAULT (1845)
Moulin d'Angibault, "coin de paradis sauvage" - Château de Sarzay (Blanchemont) - La Couarde, "ruisseau noir, étroit et profond"
*
LA MARE AU DIABLE (1846)
Corlay (auberge du Point-du-Jour) - Bois de Chanteloube (la mare au Diable) - Le Magnet - Fourche
*
FRANÇOIS LE CHAMPI (1848)
Mers-sur-Indre - Saint-Denis-de-Jouhet - Clocher de Montipouret, "qui est l'ami de tout le monde"
*
LES MAÎTRES SONNEURS (1853)
Château de Saint-Chartier avec ses souterrains - Chêne "des Maîtres Sonneurs" dans la forêt
*
LES BEAUX MESSIEURS DE BOIS-DORÉ (1858)
Château de Briantes (où s'est retiré Sylvain de Bois-Doré) - La Motte-Feuilly (château de Lauriane) - Château d'Ars (Almivar)
Voir le dossier "Promenades avec George Sand dans la Vallée Noire et dans la Creuse"
