SUR LES PAS DE BALZAC
DANS LA RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Balzac en 1842
TOURS ET LA VALLÉE DE LA LOIRE
– Chronologie : Balzac en Touraine
– Textes de Balzac sur la Touraine et les tourangeaux
– Textes de Balzac sur Tours et ses environs
– À Tours, la "maison de Tristan" dans La Recherche de l'Absolu
– À Tours, la cathédrale Saint-Gatien
– À Tours, la Psalette
– La Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire
– La Roche-Corbon
– VouvraySACHÉ ET LA VALLÉE DU LYS
– Le château de Saché
– La Vallée du Lys
– Le Lys dans la valléeAUTRES LIEUX BALZACIENS
– Vendôme et le collège des Oratoriens
– Grez-sur-Loing, la Bouleaunière
– Saumur dans Eugénie Grandet
– Sèvres, les Jardies
– Issoudun, château de Frapesle
- 1 -
TOURS ET LA VALLÉE DE LA LOIRE
Honte à qui n’admirerait pas ma joyeuse, ma belle, ma brave Touraine, dont les sept vallées ruissellent d’eau et de vin. (Les deux Amis)
Ne me demandez pas pourquoi j’aime la Touraine. Je ne l’aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert ; je l’aime comme un artiste aime l’art ; sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus. (Le Lys dans la Vallée)
Il me reste des premiers souvenirs de ma vie le sentiment du beau qui respire dans le paysage de Tours.
La Touraine, c'est la véritable abbaye de Thélème, si vantée dans le livre de Gargantua.
CHRONOLOGIE : BALZAC EN TOURAINE
Bernard-François Balzac fut nommé à Tours en 1795 comme agent en chef des subsistances, puis comme administrateur de l'hôpital. Il s'installa dans un modeste rez-de-chaussée de la rue principale de la ville, la rue de l'Armée-d'Italie (qui devait devenir la "rue Napoléon", puis reprendre son nom de "rue Royale", puis s'appeller "rue Nationale").
En 1797, il épousa une jeune parisienne, Laure Sallambier. Elle mit au monde un enfant presque tous les ans: Louis-Daniel (mort prématurément) en 1798, Honoré en 1799 (le 20 mai), Laure en 1800, Laurence en 1802. Puis, en 1804, la famille s’installa dans un bel hôtel de la même rue.
Pendant quatre ans, Honoré a été en nourrice à Saint-Cyr avec sa sœur Laure, qui deviendra plus tard Mme de Surville :
"Ma mère, qui avait perdu son premier enfant en voulant l’allaiter, choisit pour le petit Honoré une belle nourrice qui demeurait à la porte de la ville, dans une maison bien aérée et entourée de jardins. elle fut très satisfaite des soins de cette femme. Elle me fit élever aussi par elle et lui laissa mon frère après son sevrage. Il avait près de quatre ans quand nous revînmes ensemble au foyer paternel." (Laure de Surville)
Dans son roman Sténie, Balzac a fait allusion à ses années passées à Saint-Cyr :
"Le désir de revoir le petit village de Saint-Cyr, où demeurait ma nourrice, me fit diriger mes pas de ce côté. Je m'informai si elle vivait encore, dans le dessein de lui procurer une douce aisance qui dorât ses vieux jours. J'appris avec douleur qu'elle était morte. Alors je me mis à visiter tous les sentiers témoins de mes premiers pas. Ils me parurent bien plus petits, surtout un certain endroit que je m'imaginais être immense, endroit où j'exerçais jadis mes talents naissants pour la construction. J'y restais des journées entières à bâtir avec des cailloux et de la boue des Louvres en miniature. Tous ces lieux examinés avec une curieuse ardeur se paraient de la grâce enchanteresse de mes souvenirs. J'avais, en les voyant, un sentiment tout à part, suave comme la volupté sans être elle, bon à l'âme comme le plaisir, mais mêlé de regrets et plein de mélancolie. Ce fut au milieu de mes anciens ateliers, de mes chantiers en mouvement, que je me rappelai ma petite sœur... adjointe à mes bâtisses. Nos visages frais et tendres étaient souvent barbouillés de nos matériaux. Ces fragments errants dans ma mémoire firent naître d'autres souvenirs, et je finis par m'asseoir sur les débris de mes anciennes villes pour réfléchir à mon enfance. J'étais sur un tertre qui dominait toute la campagne, la Loire et les environs, et là, déposant mon Virgile, je repassai les événements de mon enfance qui m'apparaissaient entourés de ce vague gracieux produit par les années. Douce naïveté, rêve charmant, ignorance mêlée de finesse, étonnement de l'essor de la vie, vous fuyez sans retour! Qu'il est beau le temps où l'on n'a pas encore vécu !"
Ensuite, de cinq à huit ans, Balzac a été demi-pensionnaire à Tours, à la pension Le Guay (71 rue de la Scellerie). Dans Le Lys dans la Vallée, il prête ses souvenirs à Félix de Vandenesse :
À cinq ans, je fus envoyé comme externe dans une pension de la ville, conduit le matin et ramené le soir par le valet de chambre de mon père. Je partais en emportant un panier peu fourni, tandis que mes camarades apportaient d’abondantes provisions. Ce contraste entre mon dénuement et leur richesse engendra mille souffrances. Mes camarades, qui presque tous appartenaient à la petite bourgeoisie, venaient me présenter leurs excellentes rillettes en me demandant si je savais comment elles se faisaient, où elles se vendaient, pourquoi je n’en avais pas. Ils se pourléchaient en vantant les rillons, ces résidus de porc sautés dans sa graisse et qui ressemblent à des truffes cuites ; ils douanaient mon panier, n’y trouvaient que des fromages d’Olivet ou des fruits secs et m’assassinaient d’un "tu n’as donc pas de quoi" qui m’apprit à mesurer la différence mise entre mon frère et moi. Ce contraste entre mon abandon et le bonheur des autres a souillé les roses de mon enfance et flétri ma verdoyante jeunesse. Pour éviter les persécutions, je me battis. Le courage du désespoir me rendit redoutable, mais je fus un objet de haine et restai sans ressources contre les traîtrises. Un soir, en rentrant, je reçus dans le dos un coup de mouchoir roulé, plein de cailloux. Quand le valet de chambre, qui me vengea rudement, apprit cet événement à ma mère, elle s’écria : "Ce maudit enfant ne nous donnera que des chagrins !"
A huit ans, en juin 1807, il partit à Vendôme, chez les Oratoriens. Il y resta six ans, retranché du monde, sans vacances, ne recevant que deux fois la visite de sa mère. Celle-ci, en décembre 1807, eut un dernier enfant, Henry, qui était en fait le fils de M. de Margonne, un ami de Saché. Honoré sortit de Vendôme épuisé et il fallut le ramener à Tours en 1813, sans même attendre la fin de l’année scolaire.
En 1814, à Tours, la Restauration dominait les esprit et Honoré participa à la liesse des Tourangeaux accueillant le duc d'Angoulême. Il représenta même son père au bal qui fut donné à la Préfecture. Et, quelques mois plus tard, il reçut du recteur la fleur de lys en argent, décoration par laquelle les Bourbons voulaient s'attacher les élèves des lycées.
En juin 1814, il fut inscrit comme externe au collège de Tours, redoublant sa troisième. Ses parents lui ont fait donner des leçons particulières et il se révéla grand travailleur. Eugène de Mirecourt raconte cette anecdote : "Vous verrez, disait Honoré à ses sœurs, je serai célèbre un jour !" A partir de ce moment, les railleuses jeunes filles ne l'abordèrent plus sans lui prodiguer des révérences et sans lui dire, avec un ton de voix extrêmement respectueux: "Salut au grand Balzac!". Sa sœur Laure le confirme dans ses Souvenirs :
"Il commençait à dire qu'on parlerait de lui un jour, et ces paroles qui faisaient rire devinrent le prétexte de plaisanteries incessantes. Au nom de cette célébrité future, on lui fit subir une infinité de petits tourments, préludes des plus grands qu'on devait lui infliger pour l'illustration acquise. L'apprentissage n'était pas inutile! Il acceptait toutes ces malices en riant plus que les autres (il riait toujours dans cet heureux temps !). Jamais caractère ne fut plus aimable, jamais non plus personne n'eut plus tôt le désir et l'intuition de la renommée."
Alors, toujours selon Laure de Surville, sa mère lui fit découvrir la ville dans de longues promenades :
"Dans les longues promenades que notre mère lui faisait faire, il regardait en artiste les doux paysages de sa chère Touraine, qu’il décrivit si bien. Il s’arrêtait quelquefois, enthousiasmé devant ces beaux soleils couchants qui éclairent si pittoresquement les clochers gothiques de Tours, les villages épars sur les coteaux, et cette Loire, si majestueuse, couverte alors de voiles de toutes grandeurs."
A la fin de 1814, les Balzac quittèrent la Touraine pour Paris. En 1815 et 1816, Honoré a été mis en pension dans des institutions privées. En 1817, comme clerc d’avoué, il suivit des cours de droit. En 1818, il a été employé chez un notaire. Mais il refusa d’aller plus loin dans cette voie et il s’engagea dans l’écriture, ne gagnant la célébrité qu’en 1827 avec Les Chouans.
En 1830, il vint passer l’été avec Mme de Berny à la Grenadière. Laure de Berny était la fille d'un Allemand et d'une femme de chambre de Marie-Antoinette. Elle habitait Villeparisis avec son mari et ses nombreux enfants. Balzac l'avait rencontrée en 1821; il avait 22 ans, elle en avait 44. Il fut séduit par l'affection maternelle qu'elle lui témoigna; elle fut séduite par la fougue et l'ardeur amoureuse d'Honoré. Elle était devenue non seulement sa maîtresse, mais aussi une amie qui l'aidait de ses conseils et, parfois, de sa bourse.
En 1845 et 1846, il vint s’installer avec Mme Hanska à Tours, à l’hôtel de la Boule-d’Or. Eveline Rzewuska, épouse du comte Wenceslas Hanski, était devenue sa maîtresse en 1833; il avait envisagé de l'épouser quand elle était devenue veuve (en 1842). A son deuxième séjour en Touraine, Mme Hanska était enceinte et Balzac se réjouissait à l'idée d'avoir un fils, qui fut en fait un enfant mort-né. Il essaya alors de convaincre sa maîtresse d’acheter le petit château de Moncontour, à Vouvray. Mais "l’Étrangère" devait se dérober à cette suggestion. Balzac ne put l'épouser qu'en mars 1850, quelques mois seulement avant de mourir.
Balzac a fait surtout des séjours fréquents à Saché chez l'ami de ses parents, Jean de Margonne. Il y compose une grande partie de son oeuvre.
Les années suivantes, il préféra aller chez ses amis Carraud, à Issoudun, puis chez George Sand à Nohant pour quelques jours, avant de s'installer aux Jardies, à Sèvres près de Ville-d'Avray. Il délaissa alors la Touraine, jusqu'à ce qu'il ramène de Russie Mme Hanska, veuve et donc épousable. Il s'installa avec elle à Tours, en 1845 et 1846, les deux fois à l'hôtel de la Boule-d'Or.
En 1848, pour fuir les troubles de la révolution, Balzac revint à Saché. Mme de Margonne est morte depuis six ans. Mais Balzac a du mal à travailler; il passe son temps à jouer au whist. Il écrit à Mme Hanska : "Je viens de m'établir dans ma petite chambre, cette petite chambre où je vous ai tant écrit, où j'ai tant pensé à vous, et mon premier souci est de vous écrire encore… Je suis levé ce matin depuis cinq heures et je n'ai fait que penser à vous, me rappeler vos robes, vos toilettes, nos promenades et ce que nous disions… Hier, j'ai senti bien péniblement le poids de la vie, aussi me suis-je jeté à corps perdu dans les souvenirs, ce vaste champ où vous êtes partout comme une consolatrice." Avec M. de Margonne, il veut refaire la promenade du "lys"; mais il parvient avec beaucoup de fatigue à la terrasse du château de Valesne d'où se découvre toute la vallée… Il sent que la mort s'approche peu à peu. Il mourra en 1850.
Quand Rodin, quarante ans après la mort de Balzac, reçut commande de la Société des Gens de Lettres de sculpter sa statue, il alla à Saché. On lui parla d'un voiturier d'Azay-le-Rideau qui ressemblait beaucoup au défunt romancier ; on l'avait même surnommé "Balzac". Rodin le contraignit à de longues séances de pose au château de l'Ilette, sur les bords de l'Indre. Mais l'œuvre de Rodin, trop "moderne" fut refusée…
TEXTES DE BALZAC SUR LA TOURAINE ET LES TOURANGEAUX
Dans son roman Sténie, le héros, Del Ryès, confie ses sentiments à un ami :
À mesure que j’approchais de ma douce patrie, tout disparut lorsque j’aperçus les bords de la Loire et les collines de Touraine. J’étais tout entier à ma délicieuse sensation et je m’écriais en moi-même : ô champs aimés des Cieux ! tranquille pays, l’Indostan de la France, où coule un autre Gange, que je te vois avec délices ! oui, ton air est plus parfumé que celui que je respirais et ta verdure est plus belle que celle que je foulais naguères ! mon âme est plus en harmonie avec tes sites charmants où règne non pas l’audace, le grandiose, mais la bonté naïve de la nature ; je suis chez moi… C’est sur ton ciel pur que mes premiers regards ont vu fuir les premiers nuages… à cette place… dans cette vallée… Salut, Bateliers… Salut, Laboureurs, salut mon doux pays. […] Si tu connaissais la Touraine, cette autre Tempé, tu partagerais mon enthousiasme. Ce pays paraît beau même à ceux qui ont de plus belles patries au dire des hommes, et l’Anglais, si patriote, abandonne la sienne pour adopter les rives de la Loire ; en effet, si de vastes forêts la bordaient de leurs colonnades antiques, ce serait l’Ohio, le Meschacebé ; mais combien elle est plus belle avec son sable doré et ses tableaux pittoresques. […] L'air pur, un ciel d'Italie, une bienfaisance générale pour tout ce qui regarde la nature, dont les mains sont prodigues en ce pays, en font un séjour délicieux. Le langage y est sonore, et d'une pureté semblable à celle du ciel. Malgré ces avantages, les habitants y sont en général, lâches, sans énergie, leur caractère se ressent de la douceur du climat, c'est la tranquillité de l'indien sur les bords de l'Indus, leur organe même est traînant, ils appuyent sur les finales. C'est toujours où la nature déploye sa sévérité que l'homme considéré en masse a de grandes qualités, mais lorsqu'elle est indulgente on jouit de ses bienfaits et le moral se ressent du bien-être ; c'est l'histoire des enfants gâtés. Néanmoins Descartes, Rabelais et d'autres génies ont pris naissance dans ces vallées fertiles; rien n'indique à l'étranger la patrie de Descartes, nouvelle preuve de l'insouciance. Malgré ses défauts, j'aime ma patrie avec délices.
Dans l'Illustre Gaudissart, il fait la satire des Tourangeaux:
"L'esprit conteur, rusé, goguenard, épigrammatique dont, à chaque page, est empreinte l'œuvre de Rabelais, exprime fidèlement l'esprit tourangeau, esprit fin, poli, comme il doit l'être dans un pays où les rois de France ont, pendant longtemps, tenu leur cour; esprit ardent, artiste, poétique, voluptueux, mais dont les dispositions premières s'abolissent promptement. La mollesse de l'air, la beauté du climat, une certaine facilité d'existence et la bonhomie des mœurs y étouffent bientôt le sentiment des arts, y rétrécissent le plus vaste cœur, y corrodent la plus tenace des volontés. Transplantez le Tourangeau, ses qualités se développent et produisent de grandes choses, ainsi que l'ont prouvé, dans les sphères d'activité les plus diverses, Rabelais et Semblançay, Plantin l'imprimeur et Descartes, Boucicault, le Napoléon de son temps, et Pinaigrier, qui peignit la majeure partie des vitraux dans les cathédrales, puis Verville et Courrier. Ainsi le Tourangeau, si remarquable au debors, chez lui demeure comme l'Indien sur sa natte, comme le Turc sur son divan. Il emploie son esprit à se moquer du voisin, à se réjouir, et arrive au bout de la vie, heureux. La Touraine est la véritable abbaye de Thélème, si vantée dans le livre de Gargantua; il s'y trouve, comme dans l'œuvre du poète, de complaisantes religieuses, et la bonne chère tant célébrée par Rabelais y trône. Quant à la fainéantise, elle est sublime, et admirablement exprimée par ce dicton populaire: — Tourangeau, veux-tu de la soupe? — Oui. — Apporte ton écuelle! — Je n'ai plus faim. Est-ce à la joie du vignoble, est-ce à la douceur harmonieuse des plus beaux paysages de la France, est-ce à la tranquillité d'un pays où jamais ne pénètrent les armes de l'étranger qu'est dû le mol abandon de ces faciles et douces mœurs? A ces questions, nulle réponse. Allez dans cette Turquie de la France, vous y resterez paresseux, oisif, heureux. Fussiez-vous ambitieux comme l'était Napoléon, ou poète comme l'était Byron, une force inouïe, invincible, vous obligerait à grder vos poésies pour vous, et à convertir en rêves vos projets ambitieux."
TEXTES DE BALZAC SUR TOURS ET SES ENVIRONS
La ville de Tours décrite dans Sténie
Entre la Loire et le Cher est une large plaine, non pas aride et sèche, mais bien verdoyante et sans cesse arrosée par l'espèce d'amitié souterraine que les ondes du fleuve ont contractée avec les eaux de la rivière; à un tel point que l'eau dans certains endroits se trouve à deux pieds; aussi les héritages multipliés qui se partagent la vallée sont-ils couverts d'une multitude de puits construits avec des tonneaux, luxe ignoré dans les jardins de Paris; les nôtres sont entourés de haies vives. L'activité de chacun dans son petit domaine, rempli d'arbres fruitiers, ajoute à l'air riant du vallon et rend son spectacle animé.
Dans ce plateau désigné par la nature s'élève l'antique ville que l’on dit fondée par Turnus; aussi je ne vois pas un corbeau voltiger en criant sur les tours de l'immense cathédrale sans penser qu'il a peut-être mangé des Sarrazins à leur défaite sous Charles-Martel; tu vois que nous avons nos temps héroïques : il nous manque par malheur l'arbre auquel on attacha notre Saint-Martin et qu'il renversa d'un signe de croix du côté opposé, évitant le supplice qu'on lui destinait; sans cela nous aurions nos reliques; espérons qu'on retrouvera ce saint arbre pour l'honneur du christianisme.
La ville est ronde, et son côté septentrional a le plus bel aspect qui soit au monde; il balance celui de Naples. La Loire extrêmement large semble couler devant la ville dans un canal taillé par un architecte. Lorsqu'une voile arrive, on la voit de loin, blanchâtre, on la suit à travers quelques îles, qui rompent la monotonie de ce vaste lac; l'œil s'y joue et leur verdure repose; on a la sensation profonde de la vue de la mer sans en avoir l'immense qui fatigue notre petitesse. L'activité du port, les cris des mariniers et la présence d'une brise fraîche rendent cette levée très agréable: car levée est le mot du pays; elle est bordée d'un rang de peupliers magnifiques dont on entend le bruissement; ils s'étendent de chaque côté de la ville partagée par le Pont et la rue qui s'est appelée successivement républicaine, impériale et royale; ces arches dérobent les maisons et présentent un rideau majestueux interrompu par l'esplanade du pont, de manière qu'en arrivant de Paris on aperçoit entre ces deux péristyles de verdure le commencement de la ville. J'ose dire qu'il est peu de capitales dont l'abord ait tant de dignité, car on a construit sur cette place deux vastes bâtiments, d'un effet d'autant plus admirable que leur simple architecture est en harmonie avec le tableau. Là commence cette rue immuable à noms changeants ; c'est de cette place, de ce pont que l'on jouit du plus beau point de vue, à quelqu'endroit que l'on se mette.
La grande rue de Tours évoquée dans l'Apostrophe
Dans ses Contes drôlatiques ("L'Apostrophe"), Balzac s’amuse à évoquer la grande rue de Tours, la rue Royale, devenue rue Nationale, là où il est né. Elle était alors toute neuve, d’une ordonnance très classique, sans magasins.
Tours ha été et sera touiours les pieds dedans la Loire, comme une jolie fille qui se baigne et joue avecque l'eaue, faisant flic flac en fouettant les ondes avecque ses mains blanches; car ceste ville est rieuse, rigolleuse, amoureuse, fresche, fleurie, perfumée mieux que toutes les aultres villes du monde qui ne sont pas tant seullement dignes de lui paigner ses cheveulx, ni de luy nouer sa saincture... Et comptez, si vous y allez, que vous lui trouverez, au milieu d'elle, une jolie raye, qui est une rue délicieulse où tout le monde se pourmène, où touiours il y ha du vent, de l'umbre et du soleil, de la pluye et de l'amour... Ha ! ha ! riez donc, allez-y donc !... C'est une rue touiours neufve, touiours royalle, touiours impériale, une rue patrioticque, une rue à deux trottoirs, une rue ouverte des deux bouts, bien percée, une rue si large que iamays nul n'y a crié: gare !... Une rue qui ne s'use pas, une rue qui mène à l'abbaye de Grant-Mont et à une tranchée qui s'emmanche très-bien avecque le pont, et au bout de laquelle est ung beau champ-de-foire; une rue bien pavée, bien bastie, bien lavée, propre comme ung mirouère, populeuse; silencieuse à ses heures, coquette, bien coiffée de nuict par ses iolys toicts bleus; brief, c'est une rue où ie suys né, c'est la royne des rues, toujours entre la terre et le ciel, une rue à fontaine, une rue à laquelle rien ne manque pour estre cellébrée parmy les rues!... Et de faict, c'est la vraye rue !... la seule rue de Tours... S'il y en ha d'aultres, elles sont noires, tortueuses, estroites, humides, et viennent touttes respectueuses saluer ceste noble rue, qui les commande !... Où en suis-je... car, une foys dans cette rue nul n'en veut issir, tant playsante elle est... Mays je debvoys cet hommaige filial, hymne descriptive, venue du cueur, à ma rue natale, aux coins de laquelle manquent seullement les braves figures de mon bon maistre Rabelais et du sieur Descartes, incogneus aux natturels du pays*.
* Le reproche de Balzac a été pris en compte par les Tourangeaux.
En 1862, une statue de Descartes (par Nieuwerkerke) était élevée dans l’axe de la rue Royale,
en avant du pont. En 1880, deux squares étaient créés de chaque côté du pont,
recevant l’un la statue de Descartes, l’autre une statue de Rabelais (par Dumaige).
Le boulevard Bérenger dans Sténie
Dans Sténie, une remarque en passant sur le boulevard Bérenger :
Il existe à Tours une magnifique promenade où chacun se rend en grande parure pour se montrer mutuellement sa garde-robe, où l'on cause de ce qu'a ou n'a pas le voisin, où l'on se salue à qui mieux-mieux. C'est une espèce de Bourse où l'habit remplace le crédit pour juger de la fortune de chacun.
Les environs de Tours
Dans Jane la Pâle, Balzac a donné a aperçu des environs de Tours :
Ce jour-là Horace et Jane allèrent se promener sur le bord de la Loire! Ils voyaient à l'autre rive cette chaîne de rochers, de vallons, de vignobles si pittoresques, et, assis sur l'herbe, ils respiraient la fraîcheur des eaux en admirant cette nature si belle et si variée. […] Le ciel était pur, les ombres du soir tombaient en laissant encore apercevoir les costumes des paysannes qui regagnaient en chantant leurs demeures creusées par étages dans les rochers; on voyait la fumée des cheminées s'échapper des touffes de pampres; de loin, des voiles blanches apparaissaient sur le lac limpide que forme la Loire en cet endroit; les chants monotones des paysannes jetaient une teinte de mélancolie dans ce tableau que Jane faisait admirer à Horace.
Un soir il revenait de Tours en guidant son amie à travers les sentiers qui couronnent les rochers de Vouvray, de Rochecorbon et de Saint-Symphorien: ils avaient joui de l'éclat de ces belles journées d'automne où la nature semble se parer encore une fois avant de s'envelopper de ses vêtements de deuil. Ces rochers éclairés le soir par les derniers rayons du soleil, qui répand à cette époque une lueur rougeâtre, la pureté des eaux du fleuve, l'aspect des plaines qui séparent la Loire du Cher, tout rappelait à Jane l'Ecosse, qu'elle avait habitée avant de venir en France.
Dans Sténie, il a développé encore plus le tableau :
Si des Alpes, des Pyrénées n'effrayent pas le spectateur par leurs crêtes neigeuses, leur verdure graduée et leur sombre magnificence, en revanche, on aperçoit, de chaque côté du pont, une colline perpétuelle et variée par mille accidents. Un des faubourgs par delà le pont est niché dans le roc, on voit s'échapper une légère fumée de ce sol verdoyant. Le pauvre est enseveli dans cette demeure éternelle comme la nature. Logé sous son héritage, il l'entend fructifier, son vignoble est son toit, le pampre en fait l'ornement; pour lui la terre est tout, il s'y loge et s'y nourrit comme un enfant dans le sein de sa mère. Ces habitations rappellent celles des solitaires de la Thébaïde, mais ce fleuve qui coule aux pieds de l'habitant est le pasteur le plus sublime qu'il puisse entendre. Il parle mieux que le silence ne parlait aux solitaires. Sa tranquille vie s'écoule dans le rocher qu'ont habité ses aïeux !... il est impossible de regarder ce faubourg dont la population est identifiée avec cette pierre froide qu'elle anime, sans que des pensées profondes vous saisissent. Quel courage il faut à ces gens pour vivre dans ce sépulcre anticipé, en présence d'une image vivante de l'éternité et de la brièveté de l'homme...
En continuant la colline, peu à peu les chaumières à cheminées fumantes s'éclaircissent et, des sinuosités, des redans de la montagne, des maisons de campagne élégantes occupent l'œil, et remplacent l'idée de la pauvreté par l'image des plaisirs de la richesse; à côté l'une de l'autre, sur la même colline, devant le même fleuve, on aperçoit, autre image, les ruines de l'abbaye de Marmoutiers auxquelles il ne manque pour être admirées que d'être en Suisse. Enfin, la tour pointue de la Roche Corbon se dessine comme un fantôme sur le paysage charmant que présentent les alentours de Vouvray; toujours la verdure, la Loire, les gais vignobles, et des touffes d'arbres d'autant plus agréables qu'elles sont rares et jetées avec élégance, varient ce tableau vraiment enchanteur. Alors la vue se perd dans un lointain bleuâtre qui vous laisse encore à désirer. La nature ressemble en cet endroit aux coquettes qui cachent leurs trésors pour les grossir à l'imagination.
De l'autre côté, non pas de l'eau, mais du pont, le paysage contraste avec l'autre: d'abord la colline est coupée par une large tranchée que j'ai montée bien souvent dans mon enfance et dont j'ai vu avec un plaisir naïf les arbres toujours couverts des mêmes fruits rouges. Une grande île pleine de peupliers semble s'opposer au cours majesteux du fleuve, la côte est enrichie de deux ou trois villages les uns au bas, les autres au sommet. Leurs clochers gothiques s'élèvent dans les airs et plus loin, après l'île, la Loire tourne et s'aperçoit encore au loin.
La ville à l'orient possède des remparts* célèbres dans nos guerres civiles, mais les fossés sont comblés, les vignes tapissent la lourde muraille, et des fruits exquis, des légumes nourrissants ont remplacé les machines mortelles; des collines, des prairies, des peupliers, des fermes, le Cher fécond en détours s'étendent au loin; et, sur la gauche, un ou deux villages, entr'autres Saint-Avertin, illustre par sa fête, sont groupés à l'horizon; l'œil les cherche à travers une magnifique avenue d'arbres, terminée par une grosse montagne ronde garnie de pins et que la route de Bordeaux caresse en fuyant.
* Ces remparts ont été abattus en 1840, à l’endroit où on allait construire le Palais de Justice.
Le coteau de Loire
Le coteau de Loire depuis la Cisse jusqu'à la Choisille, depuis Vouvray jusqu’au delà de Saint-Cyr, a inspiré à Balzac maintes pages, particulièrement dans ses Contes drôlatiques.
— Dans le Péché véniel il raconte « comment print femme Messire Bruyn, celluy-la qui paracheva le chastel de la Roche-Corbon-les-Vouvray sur la Loire ».
— Le récit des Joyeussetez du Roy Loys le unziesme montre le roi bourgeois tourangeau « dans son chasteau royal de Plessis-les-Tours, basti en briques et pierres, entouré de beaulx ombraiges ».
— Il nous ramène à Saint-Cyr-sur-Loire en narrant Comment la belle fille de Portillon quinaulda son juge: «La Portillonne estoyt buandière au lieu dict de PortilIon, d'où son nom. Si aulcuns ne cognoissent Tours, besoing est de dire que Portillon est en aval de la Loire du costé de Sainct-Cyr, loing du pont qui mène à la cathédrale de Tours, autant que ce dict pont est loing de Marmoutier. Adoncques la fille avait là sa buanderie d'où elle dévalloyt en ung rien de temps pour laver en Loire, et passoyt sur une toue pour aller à Sainct-Martin qui se trouvoyt de l'aultre costé de l'eau où elle vendoyt la plus grand part de ses buées en Chasteauneuf et aultres lieux.»
— Dans l'Apostrophe, il raconte comment cette belle lavandière de Portillon «devint taincturière, bonne bourgeoise de Tours par son mariaige avec ung vieulx taincturier de soyeries qui demouroyt en la rue Montfumier et y possédoyt ung logis scandaleux de richesse». Ce bonhomme Taschereau était aussi propriétaire du clos de la Grenadière, situé sur le «joly costeau de Sainct-Cyr». C'est là qu'il connut la belle de Portillon, et de "la Portillonne" il fit "la Tascherette".
À TOURS, LA "MAISON DE TRISTAN" DANS LA RECHERCHE DE L'ABSOLU
Dans La Recherche de l’Absolu, pour décrire la maison flamande de Balthazar Claës à Douai Balzac s’est inspiré de la maison dite "de Tristan l’Hermite", 16 rue Briçonnet, en fait hôtel de Pierre du Puiz (1495), souvenir de l’entourage flamand de Louis XI. Cette famille du Puiz était une des plus influentes de Tours au XVe siècle. Pierre du Puiz a fait figurer sur sa maison l’anagramme de son nom : "Priez Dieu Pur".

wiki-Pline
La maison est en briques et des cordons de pierre moulurés séparent les étages. Corniches, angles et chambrales sont en pierre. La façade côté ouest comporte une porte en anse de panier surmontée d’une accolade amortie par un cul-de-lampe soutenant une Vierge, décorée de petits crochets, accompagnée de deux pilastres en torsade. Au bas de cette façade courent deux cordelières, l’une sculptée en pierre, l’autre en terre cuite (mais restaurée en ciment au XXe siècle). Les deux étages ont chacun trois fenêtres inégales. Le pignon triangulaire à redans est caractéristiques des maisons des Flandres ; il est percé de deux petites fenêtres et comporte des boulins pour les oiseaux.
Or la maison que décrit Balzac, celle de Claës, possède elle aussi une assise surélévée, des fenêtres encadrées en pierre blanche, un vitrage divisé en quatre parties inégales avec de petites vitres en losange "enchâssées dans des branches en fer", une porte en chêne dont la baie se termine par un cintre pointu surmonté d'une niche, un fronton triangulaire dont les côtés sont "découpés carrément par des espèces de marches jusqu'au couronnement du premier étage".
Il existe à Douai dans la rue de Paris une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et les détails ont, plus que ceux d’aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions flamandes, si naïvement appropriées aux mœurs patriarcales de ce bon pays. L'esprit de la vieille Flandre respirait tout entier dans cette habitation, qui offrait aux amateurs d'antiquités bourgeoises le type des modestes maisons que se construisit la riche bourgeoisie au Moyen-âge.
Le principal ornement de la façade était une porte à deux vantaux en chêne garnis de clous. La baie de cette porte, édifiée en pierre de grès, se terminait par un cintre pointu qui supportait une petite lanterne surmontée d'une croix, et dans laquelle se voyait une statuette de sainte Geneviève filant sa quenouille. Quoique le temps eût jeté sa teinte sur les travaux délicats de cette porte et de la lanterne, le soin extrême qu'en prenaient les gens du logis permettait aux passants d'en saisir tous les détails. Aussi le chambranle, composé de colonnettes assemblées, conservait-il une couleur gris foncé et brillait-il de manière à faire croire qu'il avait été verni. De chaque côté de la porte, au rez-de-chaussée, se trouvaient deux croisées semblables à toutes celles de la maison. Leur encadrement en pierre blanche finissait sous l'appui par une coquille richement ornée, en haut par deux arcades que séparait le montant de la croix qui divisait le vitrage en quatre parties inégales, car la traverse placée à la hauteur voulue pour figurer une croix, donnait aux deux côtés inférieurs de la croisée une dimension presque double de celle des parties supérieures. Les vitres, petites et en losange, étaient enchâssées dans les branches en fer extrêmement minces et peintes en rouge. Les murs, bâtis en briques rejointoyées avec un mortier blanc, étaient soutenus de distance en distance et aux angles par des chaînes en pierre. Le grenier tirait son jour d'une grande ouverture, bordée en grès, et placée au milieu du fronton triangulaire que décrivait le pignon. Au faîte s'élevait, en guise de girouette, une quenouille chargée de lin. Les deux côtés du grand triangle que formait le mur du pignon étaient découpés carrément par des espèces de marches. À droite et à gauche de la maison, tombaient les eaux pluviales rejetées par la gueule d'un animal fantastique. Au bas de la maison, une assise en grès y simulait une marche. Depuis sa construction, cette façade se nettoyait soigneusement deux fois par an. Si quelque peu de mortier manquait dans un joint, le trou se rebouchait aussitôt. Les croisées, les appuis, les pierres, tout était épousseté mieux que ne sont époussetés à Paris les marbres les plus précieux. Ce devant de maison n'offrait donc aucune trace de dégradation. Les ombres produites par le peu de largeur de la rue ôtaient fort souvent à cette construction le lustre qu'elle empruntait à sa propreté recherchée qui, d'ailleurs, la rendait froide et triste à l'œiI. Un poète aurait aimé quelques herbes dans les jours de la lanterne ou des mousses sur les découpures du grès, il aurait souhaité que ces rangées de briques se fussent fendillées, que sous les arcades des croisées, quelque hirondelle eût maçonné son nid dans les triples cases rouges qui les ornaient. Aussi le fini, l'air propre de cette façade à demi râpée par le frottement lui donnaient-ils un aspect sèchement honnête et décemment estimable, qui, certes, aurait fait déménager un romantique, s'il eût logé en face.
Au rez-de-chaussée, la première pièce était un parloir éclairé par deux croisées du côté de la cour, et par deux autres qui donnaient sur un jardin dont la largeur égalait celle de la maison. Deux portes vitrées parallèles conduisaient l'une au jardin, l'autre à la cour, et correspondaient à la porte de la rue, de manière à ce que, dès l'entrée, un étranger pouvait embrasser l'ensemble de cette demeure, et apercevoir jusqu'aux feuillages qui tapissaient le fond du jardin.
À TOURS, LA CATHÉDRALE SAINT-GATIEN
Laure de Surville rappelle combien son frère, dans sa jeunesse, avait été attiré par la cathédrale Saint-Gatien :
«Notre mère nous conduisait régulièrement aux jours de fête à la cathédrale Saint-Gatien. Là Honoré pouvait songer à loisir, et aucune des poésies et des splendeurs de cette belle église n'était perdue pour lui. Il remarquait tout, depuis les merveilleux effets de lumière qu' y produisent les vieux vitraux, les nuages d'encens qui enveloppent comme dans des voiles les officiants, jusqu'aux pompes du service divin, rendues plus splendides encore par la présence du cardinal-archevêque. Les physionomies des prêtres, qu'il étudiait, lui aideront un jour à composer les abbés Birotteau et Loraux et le curé Bonnet, dont la tranquillité d'âme fait un si beau contraste avec les agitations du remords qui torture la repentante Véronique. Cette église l'avait tant impressionné que le nom seul de Saint-Gatien réveillait en lui des mondes de souvenirs, où les fraîches et pures sensations de l'adolescence et les sentiments religieux (qui ne l'abandonnèrent jamais) étaient mêlés aux idées d'homme qui germaient déjà dans ce puissant cerveau.» (Laure de Surville)

wiki-Velvet
Lorsque la cathédrale Saint-Gatien apparaît dans l’œuvre de Balzac, c’est souvent pour y placer une scène fantastique.
Dans Jésus-Christ en Flandre, le romancier est venu se recueillir dans l’église du couvent de la Merci, près d’Ostende. Là il est en proie à une hallucination. Jean Pommier a montré que, dans un état antérieur du texte, cette église est Saint-Gatien.
En proie à ces idées funèbres, j'entrai machinalement dans cette église du couvent, dont les tours grises m'apparaissaient alors comme des fantômes à travers les brumes de la mer. Je regardai sans enthousiasme cette forêt de colonnes assemblées dont les chapiteaux feuillus soutiennent des arcades légères, élégant labyrinthe. Je marchai tout insouciant dans les nefs latérales qui se déroulaient devant moi comme des portiques tournant sur euxmêmes. La lumière incertaine d'un jour d'automne permettait à peine de voir en haut des voûtes les clefs sculptées, les nervures délicates qui dessinaient si purement les angles de tous les cintres gracieux. Les orgues étaient muettes. Le bruit seul de mes pas réveillait les graves échos cachés dans les chapelles noires.
Je m'assis auprès d'un des quatre piliers qui soutiennent la coupole, près du chœur. De là, je pouvais saisir l'ensemble de ce monument que je contemplai sans y attacher aucune idée. L'effet mécanique de mes yeux me faisait seul embrasser le dédale imposant de tous les piliers, les roses immenses miraculeusement attachées comme des réseaux au-dessus des portes latérales ou du grand portail, les galeries aériennes où de petites colonnes menues séparaient les vitraux enchâssés par des arcs, par des trèfles ou par des fleurs, joli filigrane en pierre. Au fond du chœur, un dôme de verre étincelait comme s'il était bâti de pierres précieuses habilement serties. A droite et à gauche, deux nefs profondes opposaient à cette voûte, tour à tour blanche et coloriée, leurs ombres noires au sein desquelles se dessinaient faiblement les fûts indistincts de cent colonnes grisâtres.
A force de regarder ces arcades merveilleuses, ces arabesques, ces festons, ces spirales, ces fantaisies sarrasines qui s'entrelaçaient les unes dans les autres, bizarrement éclairées, mes perceptions devinrent confuses. Je me trouvai, comme sur la limite des illusions et de la réalité, pris dans les pièges de l'optique et presque étourdi par la multitude des aspects. Insensiblement ces pierres découpées se voilèrent, je ne les vis plus qu'à travers un nuage formé par une poussière d'or, semblable à celle qui voltige dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil dans une chambre. Au sein de cette atmosphère vaporeuse qui rendit toutes les formes indistinctes, la dentelle des roses resplendit tout à coup. Chaque nervure, chaque arête sculptée, le moindre trait s'argenta. Le soleil alluma des feux dans les vitraux dont les riches couleurs scintillèrent. Les colonnes s'agitèrent, leurs chapiteaux s'ébranlèrent doucement. Un tremblement caressant disloqua l'édifice, dont les frises se remuèrent avec de gracieuses précautions. Plusieurs gros piliers eurent des mouvements graves comme est la danse d'une douairière qui, sur la fin d'un bal, complète par complaisance les quadrilles. Quelques colonnes minces et droites se mirent à rire et à sauter, parées de leurs couronnes de trèfles. Des cintres pointus se heurtèrent avec les hautes fenêtres longues et grêles, semblables à ces dames du Moyen-âge qui portaient les armoiries de leurs maisons peintes sur leurs robes d'or. La danse de ces arcades mitrées avec ces élégantes croisées ressemblait aux luttes d'un tournoi.
Bientôt chaque pierre vibra dans l'église, mais sans changer de place. Les orgues parlèrent, et me firent entendre une harmonie divine à laquelle se mêlèrent des voix d'anges, musique inouïe, accompagnée par la sourde basse-taille des cloches dont les tintements annoncèrent que les deux tours colossales se balançaient sur leurs bases carrées. Ce sabbat étrange me sembla la chose du monde la plus naturelle, et je ne m'en étonnai pas après avoir vu Charles X à terre. J'étais moi-même doucement agité comme sur une escarpolette qui me communiquait une sorte de plaisir nerveux, et il me serait impossible d'en donner une idée. Cependant, au milieu de cette chaude bacchanale, le chœur de la cathédrale me parut froid comme si l'hiver y eût régné. J'y vis une multitude de femmes vêtues de blanc, mais immobiles et silencieuses. Quelques encensoirs répandirent une odeur douce qui pénétra mon âme en la réjouissant. Les cierges flamboyèrent. Le lutrin, aussi gai qu'un chantre pris de vin, sauta comme un chapeau chinois. Je compris que la cathédrale tournait sur elle-même avec tant de rapidité que chaque objet semblait y rester à sa place. Le Christ colossal, fixé sur l'autel, me souriait avec une malicieuse bienveillance qui me rendit craintif, je cessai de le regarder pour admirer dans le lointain une bleuâtre vapeur qui se glissa à travers les piliers, en leur imprimant une grâce indescriptible. Enfin plusieurs ravissantes figures de femmes s'agitèrent dans les frises. Les enfants qui soutenaient de grosses colonnes battirent eux-mêmes des ailes. Je me sentis soulevé par une puissance divine qui me plongea dans une joie infinie, dans une extase molle et douce. J'aurais, je crois, donné ma vie pour prolonger la durée de cette fantasmagorie.
Saint-Gatien sert également de cadre pour le mariage de Sténie (abréviation de Stéphanie) avec un homme qu’elle n’aime pas, sous les yeux de Del Ryès, qui l’aime avec passion. Pour accentuer l'effet, le mariage a lieu à minuit.
Je suis devant Saint-Gatien, sur une place entourée de vieux murs; je vois avec plaisir les nuages s'ammonceler sur les tours noires et antiques de la cathédrale. Eveillés par l'approche de l'orage, une nuée de corbeaux croasse un chant de mort. Quelques éclairs rougissent cet immense et admirable monument; l'air rafraîchit mon visage et mes pensées sinistres. J'entends sonner lentement minuit, heure de malheur, heure du crime. Appuyé sur une pierre, je contemple la basilique sombre où Sténie va implorer le ciel qui ne l'écoutera pas… Pourquoi, dis-je, les laisser en repos? pourquoi ne pas troubler encore leur union? La joie maligne du désespoir se glisse en mon âme et, détachant un clou d'une barrière, j'entre dans l'église, dans le dessein d'ensanglanter par ma mort, ma malédiction, mes cris, le lit nuptial que l'on va bénir. […]
En entrant dans ce vaste monument, […] je me tapis derrière une colonne gothique et j'attends. On allume les cierges, le prêtre vient, son air est vénérable: c'est le vieillard que j'avais rencontré; prosterné sur le marbre il appelle l'attention du grand Etre... et bientôt Sténie el tout le monde arrive; j'avoue qu'au milieu de la nuit, ce simple appareil a quelque chose de majestueux... Le calme le plus profond a lieu, Sténie est remise et la perfide soutient cette affreuse cérémonie, sans s'émouvoir; je l'aurais vue sous le couteau sacré d'un grand Prêtre avec plus de plaisir !.. J'examinai son époux; il a une assez belle taille, une figure agréable et ses manières sont distinguées, mais sa seule vue est repoussante pour moi; je ne le contemplais pas sans frémir... il mourra... les corbeaux ont chanté son hymne funéraire... Oui, la mort plane et c'est moi qui serai son ministre…
Le prêtre se retourne; vois-le, il va les bénir... C'est quand il leur dit que l'Eternel inscrivait leur bonheur, que les anges tressaillaient de joie.... À ce moment, un violent coup de tonnerre se fit entendre, précédé d'un éclair qui glaça de terreur; les corbeaux redoublent leurs horribles croassements... . «L'Eternel, m'écriai-je, l'Eternel! dites l'enfer, la mort, la mort et le malheur.» Le désespoir donnait à ma voix déguisée un accent infernal.. Honteux, je m'échappe avant qu'on ait regardé; j'étais dehors... je fuyais comme un oiseau de proie.
Au début de Maître Cornélius, l’intérieur de la cathédrale Saint-Gatien, à la tombée de la nuit, donne une impression de fantastique.
En 1479, le jour de la Toussaint, les vêpres finissaient à la cathédrale de Tours. Le sermon avait duré longtemps, la nuit était venue pendant l’office, et l’obscurité la plus profonde régnait dans certaines parties de cette belle église, dont les deux tours n’étaient pas encore achevées. Les luminaires de chaque autel et tous les candélabres du chœur étaient allumés. Inégalement semées à travers la forêt de piliers et d’arcades qui soutient les trois nefs de la cathédrale, ces masses de lumière éclairaient à peine l’immense vaisseau, car, en projetant les fortes ombres des colonnes à travers les galeries de l’édifice, elles y produisaient mille fantaisies que rehaussaient encore les ténèbres dans lesquelles étaient ensevelis les cintres, les voussures et les chapelles latérales, déjà si sombres en plein jour.
La foule offrait des effets non moins pittoresques. Certaines figures se dessinaient si vaguement dans le clair-obscur qu’on pouvait les prendre pour des fantômes ; tandis que plusieurs autres, frappées par des lueurs éparses, attiraient l’attention comme les têtes principales d’un tableau. Les statues semblaient animées, et les hommes paraissaient pétrifiés. Çà et là, des yeux brillaient dans le creux des piliers, la pierre jetait des regards, les marbres parlaient, les voûtes répétaient des soupirs, l’édifice entier était doué de vie.

wiki-Eusebius (G. Piolle)
TAINE A VISITÉ LA CATHÉDRALE SAINT-GATIEN :
"Nous nous sommes levés à cinq heures pour voir la cathédrale. Le portail est bien élégant, bien riche, bien ouvragé, avec deux tours qui finissent en pointe émoussée; mais l'exagération du gothique y est trop visible. — Rien que des dentelles de pierre; c'est du filigrane; il n'y a pas de moulures plus fines et plus multipliées dans un joli meuble de salon. La conséquence est que rien ne tient. Quantité de jours, de fenêtres ont été bouchés pour empêcher l'écroulement; sur la droite, de haut en bas, on a plaqué un énorme emplâtre de maçonnerie, cela est piteux. Il en est de même à Strasbourg, toute la charpente du clocher est en fer, la pierre n'est qu'un revêtement. Voilà de l'art outré, faussé. La civilisation du Moyen Age est toute pareille, brillante et creuse. Rien de sain, les disparates foisonnent. Le chevet est une sorte de pigeonnier recouvert d'ardoises. Plusieurs contreforts enjambent la rue, comme une patte de crabe luxée, pour soutenir une saillie. — De dedans est beau, haut et mystique. Ce que j'ai le mieux senti, ce sont les vitraux. Le soleil du matin donnait dans les grandes fenêtres du chevet comme l'aurore d'une résurrection rayonnante; les trois rosaces commençaient à étinceler; la queue d'un paon n'est pas plus magnifique; mais l'effet est tout autre, douloureux, violent. Ces couleurs parlent; elles sont toutes excessiyes, jaune intense, écarlate, surtout violet foncé, la plus tragique des couleurs, celle qu'on doit voir dans l'extase."
À TOURS, LA PSALETTE
Balzac a également apprécié le quartier qui entoure Saint-Gatien pour son pittoresque romanesque, en particulier l'ancien Préau des chanoines de Saint-Gatien, appelé "la Psalette" parce qu’une des salles de ce cloître servait au Moyen Age aux répétitions des enfants de chœur qui chantaient aux offices, la Schola Cantorum. Les trois galeries de ce cloître mêlent les styles gothique et renaissance. La galerie sud a disparu.

wiki-LeZibou
Dans Jeanne la Pâle, l'héroïne, que des calomnies ont séparée du duc de Landon, qu’elle aime, est venue à Tours pour y cacher sa douleur.
Jane la Pâle avait choisi pour sa retraite le quartier le plus solitaire de la ville de Tours. Le seul aspect de sa demeure révélait la sombre mélancolie qui la lui avait fait chercher. Empreinte de la sombre couleur que lui ont léguée les siècles, la cathédrale de Saint-Gatien est environnée de grands bâtiments aussi noirs que les arcs nombreux qui soutiennent sa grande nef, et à l'endroit où, derrière l'abside, les arceaux se réunissent et abondent, comme pour protéger le tabernacle, est une place morne et silencieuse; l'herbe y croît entre les pavés, elle est presque toujours déserte. A peine dans le jour trois ou quatre habitants passent-ils à travers cette enceinte, et alors leurs pas retentissent dans le silence. Non loin du chœur s’élève une maison qui faisait jadis partie du cloître, comme l'indiquent les pignons séculaires, sa forme antique, la construction des croisées et la teinte sombre des pierres. Auprès de cette maison est le séminaire, plus loin les bâtiments de l'archevêché. La fabrique, en employant pour son usage presque toutes les constructions qui dépendaient jadis du domaine de l'église, semble avoir abandonné par grâce aux victimes du monde cette habitation solitaire. Là demeurait Jane, gardée par une double enceinte de paix et de mystère. Parfois cette effrayante solitude était troublée, mais par les mille voix du peuple et par les chants religieux qui, traversant les murs, venaient mourir à son oreille comme le bruit du monde qu'elle avait quitté.
Dans Le Curé de Tours, Balzac a installé les appartements d’une vieille fille, Mlle Gamard, et de ses deux locataires, Troubert et Birotteau, dans le corps est (longé par la rue de la Psalette) et dans le corps nord.
L’abbé François Birotteau, héritier de l’abbé Chapeloup, possède trois belles pièces au premier étage de la partie nord, "à l’exposition du midi". Le chanoine Hyacinthe Troubert n’a que deux pièces humides au rez-de-chaussée de la partie est. Cela explique en partie la haine qu’il portera à l’abbé Birotteau et son alliance avec Mlle Gamard pour lui faire quitter la maison.
Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était allé passer la soirée. Il traversait donc, aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre, la petite place déserte nommée le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien, à Tours.
L'abbé Birotteau, petit homme court, de constitution apoplectique, âgé d'environ soixante ans, avait déjà subi plusieurs attaques de goutte. Or, entre toutes les petites misères de la vie humaine, celle pour laquelle le bon prêtre éprouvait le plus d'aversion, était le subit arrosement de ses souliers à larges agrafes d'argent et l'immersion de leurs semelles. En effet, malgré les chaussons de flanelle dans lesquels il empaquetait en tout temps ses pieds avec le soin que les ecclésiastiques prennent d'eux-mêmes, il y gagnait toujours un peu d'humidité; puis, le lendemain, la goutte lui donnait infailliblement quelques preuves de sa constance. Néanmoins, comme le pavé du Cloître est toujours sec, que l'abbé Birotteau avait gagné trois livres dix sous au wisth chez madame de Listomère, il endura la pluie avec résignation depuis le milieu de la place de l'Archevêché, où elle avait commencé à tomber en abondance. En ce moment, il caressait d'ailleurs sa chimère, un désir déjà vieux de douze ans, un désir de prêtre! un désir qui, formé tous les soirs, paraissait alors près de s'accomplir; enfin, il s'enveloppait trop bien dans l'aumusse d'un canonicat pour sentir les intempéries de l'air: pendant la soirée, les personnes habituellement réunies chez madame de Listomère lui avaient presque garanti sa nomination à la place de chanoine, alors vacante au Chapitre métropolitain de Saint-Gatien, en lui prouvant que personne ne la méritait mieux que lui, dont les droits longtemps méconnus étaient incontestables. S'il eût perdu au jeu, s'il eût appris que l'abbé Poirel, son concurrent, passait chanoine, le bonhomme eût alors trouvé la pluie bien froide. Peut-être eût-il médit de l'existence. Mais il se trouvait dans une de ces rares circonstances de la vie où d'heureuses sensations font tout oublier. En hâtant le pas, il obéissait à un mouvement machinal, et la vérité, si essentielle dans une histoire des moeurs, oblige à dire qu'il ne pensait ni à l'averse, ni à la goutte.Jadis, il existait dans le Cloître, du côté de la Grand'rue, plusieurs maisons réunies par une clôture, appartenant à la Cathédrale et où logeaient quelques dignitaires du Chapitre. Depuis l'aliénation des biens du clergé, la ville a fait du passage qui sépare ces maisons une rue, nommée rue de la Psalette, et par laquelle on va du Cloître à la Grand'rue. Ce nom indique suffisamment que là demeurait autrefois le grand Chantre, ses écoles et ceux qui vivaient sous sa dépendance. Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison dont les murs sont traversés par les arcs-boutants de Saint-Gatien qui sont implantés dans son petit jardin étroit, de manière à laisser en doute si la Cathédrale fut bâtie avant ou après cet antique logis. Mais en examinant les arabesques et la forme des fenêtres, le cintre de la porte, et l'extérieur de cette maison brunie par le temps, un archéologue voit qu'elle a toujours fait partie du monument magnifique avec lequel elle est mariée. Un antiquaire s'il y en avait à Tours, une des villes les moins littéraires de France, pourrait même reconnaître, à l'entrée du passage dans le Cloître, quelques vestiges de l'arcade qui formait jadis le portail de ces habitations ecclésiastiques et qui devait s'harmonier au caractère général de l'édifice. Située au nord de Saint-Gatien, cette maison se trouve continuellement dans les ombres projetées par cette grande cathédrale sur laquelle le temps a jeté son manteau noir, imprimé ses rides, semé son froid humide, ses mousses et ses hautes herbes. Aussi cette habitation est-elle toujours enveloppée dans un profond silence interrompu seulement par le bruit des cloches, par le chant des offices qui franchit les murs de l'église, ou par les cris des choucas nichés dans le sommet des clochers. Cet endroit est un désert de pierres, une solitude pleine de physionomie, et qui ne peut être habitée que par des êtres arrivés à une nullité complète ou doués d'une force d'âme prodigieuse. La maison dont il s'agit avait toujours été occupée par des abbés, et appartenait à une vieille fille nommée mademoiselle Gamard. Quoique ce bien eût été acquis de la Nation, pendant la Terreur, par le père de mademoiselle Gamard; comme depuis vingt ans cette vieille fille y logeait des prêtres, personne ne s'avisait de trouver mauvais, sous la Restauration, qu'une dévote conservât un bien national: peut-être les gens religieux lui supposaient-ils l'intention de le léguer au Chapitre, et les gens du monde n'en voyaient-ils pas la destination changée.
L'abbé Birotteau se dirigeait donc vers cette maison, où il demeurait depuis deux ans. Son appartement avait été, comme l'était alors le canonicat, l'objet de son envie et son hoc erat in votis pendant une douzaine d'années. Ëtre le pensionnaire de mademoiselle Gamard et devenir chanoine, furent les deux grandes affaires de sa vie; et peut-être résument-elles exactement l'ambition d'un prêtre, qui, se considérant comme en voyage vers l'éternité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, une bonne table, des vêtements propres, des souliers à agrafes d'argent, choses suffisantes pour les besoins de la bête, et un canonicat pour satisfaire l'amour-propre, ce sentiment indicible qui nous suivra, dit-on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a des grades parmi les saints.
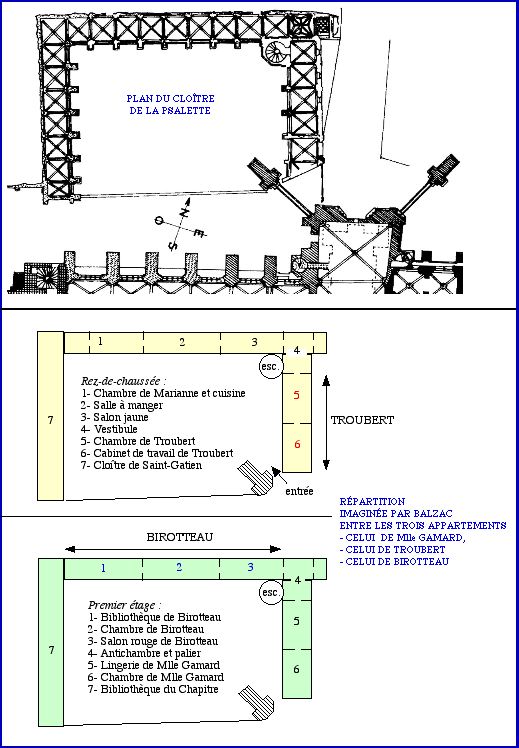
Le cloître de la Psalette, au nord de la cathédrale, dans lequel Balzac
situe les appartements de Mlle Gamard, du chanoine Troubert et de l'abbé Birotteau.
LA GRENADIÈRE À SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Au cours de l'été 1830, Balzac séjourne en Touraine avec son amante Mme de Berny (1777-1836). Il loue pour un mois la Grenadière à Amédée Coudreux, la fille de Gabriel-François Coudreux, un ancien manufacturier de Tours.
La Grenadière est une petite closerie du XVIe siècle, bâtie à flanc de coteau, remaniée et agrandie au XIXe siècle. Saint-Cyr était alors à la mode, surtout parmi les Britanniques, et de nombreuses propriétés étaient proposées à la location.
Oh ! si vous saviez ce que c'est que la Touraine !... On y oublie tout. Je pardonne bien aux habitants d'être bêtes, ils sont si heureux ! […] si vous mettez le pied en ma maison de la Grenadière, près Saint-Cyr, maison sise à mi-côte, près d'un fleuve ravissant, couverte de fleurs, de chèvrefeuilles, et d'où je vois des paysages mille fois plus beaux que tous ceux dont ces gredins de voyageurs embêtent leurs lecteurs… La Touraine me fait l'effet d'un pâté de foie gras où l'on est jusqu'au menton, et son vin délicieux, au lieu de griser, vous bêtifie et vous béatifie. Aussi ai-je loué une maisonnette pour jusqu'au mois de novembre, car, en fermant mes fenêtres, je travaille, et je ne veux revoir ce luxurieux Paris qu'armé de provisions littéraires. (Lettre de Balzac à Victor Ratier, La Grenadière, 21 juillet 1830)
Peu après leur installation, en juin, Balzac et Mme de Berny firent une excursion d'un mois sur la Loire en bateau. Ils s'arrêtèrent à Saumur, visitèrent Le Croisic et Guérande. Balzac écrivit à Victor Ratier: "J'ai fait le plus poétique voyage qui soit possible en France; je sentais mes pensées grandir avec ces fleuve qui, près de la mer, devient immense."
Ils passèrent tous deux le mois de juillet en Touraine: "Si vous saviez ce qu'est la Touraine… On y oublie tout… la vertu, le bonheur, la vie, c'est six cents francs de rente au bord de la Loire!" Mais Mme de Berny, à cause des événements de ce juillet 1830, voulut rentrer à Paris. Balzac, lui, alla à Saché.
 |
 |
Dès 1834, Balzac espéra acquérir La Grenadière, ce à uoi le pressait son amie Mme Carraud :
Ne vous verrais-je donc jamais fixé à la Grenadière, puisque c’est là votre éden ? J’ai grande foi dans l’influence de la vie simple et peu accidentée sur un talent comme le vôtre. Aucune organisation ne saurait fournir à cette constante ébullition, et la vôtre, tout exceptionnelle qu’elle soit, y périra, et je ne vous reconnais pas le droit d’en hâter la destruction. Vous m’avez écrit que vous deviendrez propriétaire de votre ermitage cette année. Courez donc vite vous y établir et ne pensez aux embellissements que dans quelques années. D’ailleurs vous avez rendu ce lieu si célèbre que je doute qu’il vous soit permis de porter une main profabne sur son ensemble. Les élus que vous admettrez dans ce sanctuaire exigeront qu’il reste tel que l’aimait l’inconnue. Que je serai donc heureuse quand je recevrai une lettre de vous datée de Tours!
Mais après deux ans de tentatives, empêtré dans les difficultés financières et profondément affecté par la mort de Mme de Berny, il annonça à Mme Hanska, depuis Tours, en novembre 1836 : "Ici, la Grenadière m'a échappé ; mais le cruel événement qui a pesé sur moi cette année m'a désintéressé de cette pauvre chaumière. Je ne saurais plus l'habiter."

Tours vu depuis la Grenadière
Balzac en donne une description détaillée au début de sa nouvelle La Grenadière, parue en 1832. Il imagine que la femme d’un lord anglais, lady Brandon, est venue s'y réfugier discrètement avec ses deux fils adultérins.
La Grenadière est une petite habitation située sur la rive droite de la Loire, en aval et à un mille environ du pont de Tours. En cet endroit, la rivière, large comme un lac, est parsemée d'îles vertes et bordée par une roche sur laquelle sont assises plusieurs maisons de campagne, toutes bâties en pierre blanche, entourées de clos de vigne et de jardins où les plus beaux fruits du monde mûrissent à l'exposition du midi. Patiemment terrassés par plusieurs générations, les creux du rocher réfléchissent les rayons du soleil, et permettent de cultiver en pleine terre, à la faveur d'une température factice, les productions des plus chauds climats. Dans une des moins profondes anfractuosités qui découpent cette colline s'élève la flèche aiguë de Saint-Cyr, petit village duquel dépendent toutes ces maisons éparses. Puis, un peu plus loin, la Choisille se jette dans la Loire par une grasse vallée qui interrompt ce long coteau.
La Grenadière, sise à mi-côte du rocher, à une centaine de pas de l'église, est un de ces vieux logis âgés de deux ou trois cents ans qui se rencontrent en Touraine dans chaque jolie situation. Une cassure de roc a favorisé la construction d'une rampe qui arrive en pente douce sur la levée, nom donné dans le pays à la digue établie au bas de la côte pour maintenir la Loire dans son lit, et sur laquelle passe la grande route de Paris à Nantes.
En haut de la rampe est une porte, où commence un petit chemin pierreux, ménagé entre deux terrasses, espèces de fortifications garnies de treilles et d'espaliers, destinées à empêcher l'éboulement des terres. Ce sentier pratiqué au pied de la terrasse supérieure, et presque caché par les arbres de celle qu'il couronne, mène à la maison par une pente rapide, en laissant voir la rivière dont l'étendue s'agrandit à chaque pas.
Ce chemin creux est terminé par une seconde porte de style gothique, cintrée, chargée de quelques ornements simples mais en ruines, couvertes de giroflées sauvages, de lierres, de mousses et de pariétaires. Ces plantes indestructibles décorent les murs de toutes les terrasses, d'où elles sortent par la fente des assises, en dessinant à chaque nouvelle saison de nouvelles guirlandes de fleurs.
En franchissant cette porte vermoulue, un petit jardin, conquis sur le rocher par une dernière terrasse dont la vieille balustrade noire domine toutes les autres, offre à la vue son gazon orné de quelques arbres verts et d'une multitude de rosiers et de fleurs. Puis, en face du portail, à l'autre extrémité de la terrasse, est un pavillon de bois appuyé sur le mur voisin, et dont les poteaux sont cachés par des jasmins, des chèvrefeuilles, de la vigne et des clématites.
Au milieu de ce dernier jardin, s'élève la maison sur un perron voûté, couvert de pampres, et sur lequel se trouve la porte d'une vaste cave creusée dans le roc. Le logis est entouré de treilles et de grenadiers en pleine terre; de là vient le nom donné à cette closerie. La façade est composée de deux larges fenêtres séparées par une porte bâtarde très rustique, et de trois mansardes prises sur un toit d'une élévation prodigieuse relativement au peu de hauteur du rez-de-chaussée. Ce toit à deux pignons est couvert en ardoises. Les murs du bâtiment principal sont peints en jaune; et la porte, les contrevents d'en bas, les persiennes des mansardes sont verts.
En entrant, vous trouverez un petit palier où commence un escalier tortueux, dont le système change à chaque tournant; il est en bois presque pourri; sa rampe creusée en forme de vis a été brunie par un long usage. A droite est une vaste salle à manger boisée à l'antique, dallée en carreau blanc fabriqué à Château-Regnault; puis, à gauche, un salon de pareille dimension, sans boiseries, mais tendu d'un papier aurore à bordure verte. Aucune des deux pièces n'est plafonnée; les solives sont en bois de noyer et les interstices remplis d'un torchis blanc fait avec de la bourre. Au premier étage, il y a deux grandes chambres dont les murs sont blanchis à la chaux; les cheminées en pierre y sont moins richement sculptées que celles du rez-de-chaussée.
Toutes les ouvertures sont exposées au midi. Au nord il n'y a qu'une seule porte, donnant sur les vignes et pratiquée derrière l'escalier. A gauche de la maison, est adossée une construction en colombage, dont les bois sont extérieurement garantis de la pluie et du soleil par des ardoises qui dessinent sur les murs de longues lignes bleues, droites ou transversales. La cuisine, placée dans cette espèce de chaumière, communique intérieurement avec la maison, mais elle a néanmoins une entrée particulière, élevée de quelques marches, au bas desquelles se trouve un puits profond, surmonté d'une pompe champêtre enveloppée de sabines, de plantes aquatiques et de hautes herbes.
Cette bâtisse récente prouve que la Grenadière était jadis un simple vendangeoir. Les propriétaires y venaient de la ville, dont elle est séparée par le vaste lit de la Loire, seulement pour faire leur récolte, ou quelque partie de plaisir. Ils y envoyaient dès le matin leurs provisions et n'y couchaient guère que pendant le temps des vendanges. Mais les Anglais sont tombés comme un nuage de sauterelles sur la Touraine, et il a bien fallu compléter la Grenadière pour la leur louer. Heureusement ce moderne appendice est dissimulé sous les premiers tilleuls d'une allée plantée dans un ravin au bas des vignes.
Le vignoble, qui peut avoir deux arpents, s'élève au-dessus de la maison, et la domine entièrement par une pente si raide qu'il est très difficile de la gravir. A peine y a-t-il entre la maison et cette colline verdie par des pampres traînants un espace de cinq pieds, toujours humide et froid, espèce de fossé plein de végétations vigoureuses où tombent, par les temps de pluie, les engrais de la vigne qui vont enrichir le sol des jardins soutenus par la terrasse à balustrade.
La maison du closier chargé de faire les façons de la vigne est adossée au pignon de gauche; elle est couverte en chaume et fait en quelque sorte le pendant de la cuisine. La propriété est entourée de murs et d'espaliers; la vigne est plantée d'arbres fruitiers de toute espèce; enfin pas un pouce de ce terrain précieux n'est perdu pour la culture. Si l'homme néglige un aride quartier de roche, la nature y jette soit un figuier, soit des fleurs champêtres, ou quelques fraisiers abrités par des pierres.
En aucun lieu du monde vous ne rencontreriez une demeure tout à la fois si modeste et si grande, si riche en fructifications, en parfums, en points de vue. Elle est, au cceur de la Touraine, une petite Touraine où toutes les fleurs, tous les fruits, toutes les beautés de ce pays sont complètement représentés. C'est les raisins de chaque contrée, les figues, les pêches, les poires de toutes les espèces, et des melons en plein champ aussi bien que la réglisse, les genêts d'Espagne, les lauriers-roses de l'Italie et les jasmins des Açores.
La Loire est à vos pieds. Vous la dominez d'une terrasse élevée de trente toises au-dessus de ses eaux capricieuses; le soir vous respirez ses brises venues fraîches de la mer et parfumées dans leur route par les fleurs des longues levées. Un nuage errant qui, à chaque pas dans l'espace, change de couleur et de forme, sous un ciel parfaitement bleu, donne mille aspects nouveaux à chaque détail des paysages magnifiques qui s'offrent aux regards, en quelque endroit que vous vous placiez. De là, les yeux embrassent d'abord la rive gauche de la Loire depuis Amboise; la fertile plaine où s'élèvent Tours, ses faubourgs, ses fabriques, le Plessis; puis, une partie de la rive gauche qui, depuis Vouvray jusqu'à Saint-Symphorien, décrit un demi-cercle de rochers pleins de joyeux vignobles. La vue n'est bornée que par les riches coteaux du Cher, horizon bleuâtre, chargé de parcs et de châteaux. Enfin, à l'ouest, l'âme se perd dans le fleuve immense sur lequel naviguent à toute heure les bateaux à voiles blanches, enflées par les vents qui règnent presque toujours dans ce vaste bassin.
Un prince peut faire sa villa de la Grenadière, mais certes un poète en fera toujours son logis; deux amants y verront le plus doux refuge, elle est la demeure d'un bon bourgeois de Tours; elle a des poésies pour toutes les imaginations; pour les plus humbles et les plus froides comme pour les plus élevées et les plus passionnées: personne n'y reste sans y sentir l'atmosphère du bonheur, sans y comprendre toute une vie tranquille, dénuée d'ambition, de soins. La rêverie est dans l'air et dans le murmure des flots, les sables parlent, ils sont tristes ou gais, dorés ou ternes; tout est mouvement autour du possesseur de cette vigne, immobile au milieu de ses fleurs vivaces et de ses fruits appétissants. Un Anglais donne mille francs pour habiter pendant six mois cette humble maison; mais il s'engage à en respecter les récoltes: s'il veut les fuits, il en double le loyer; si le vin lui fait envie, il double encore la somme.
Que vaut donc la Grenadière avec sa rampe, son chemin creux, sa triple terrasse, ses deux arpents de vigne, ses balustrades de rosiers fleuris, son vieux perron, sa pompe, ses clématites échevelées et ses arbres cosmopolites? N'offrez pas de prix! La Grenadière ne sera jamais à vendre. Achetée une fois en 1690, et laissée à regret pour quarante mille francs, comme un cheval favori abandonné par l'Arabe du désert, elle est restée dans la même famille, elle en est l'orgueil, le joyau patrimonial, le Régent. Voir, n'est-ce pas avoir? a dit un poète. De là vous voyez trois vallées de la Touraine et sa cathédrale suspendue dans les airs comme un ouvrage en filigrane. Peut-on payer de tels trésors? Pourrez-vous jamais payer la santé que vous recouvrez là sous les tilleuls?Installée à la Grenadière avec ses deux enfants de huit et treize ans, Mme Willemsens paraissait souffrante : "Sa seule promenade consistait à aller de la Grenadière au pont de Tours, où, quand la soirée était calme, elle venait avec ses deux enfants respirer l’air frais de la Loire et admirer les effets produits par le soleil couchant dans ce paysage." Après le repas, "elle restait couchée sur un long divan placé dans le pavillon du jardin d’où l’on découvrait cette douce Touraine incessamment changeante, sans cesse rajeunie par les mille accidents du jour, du ciel, de la saison." Au mois d’octobre, "elle ne pouvait plus se lever qu’à midi, quand les rayons du soleil, réfléchis par les eaux de la Loire et concentrés dans les terrasses, produisaient à la Grenadière cette température égale à celle des chaudes et tièdes journées de la baie de Naples. Elle venait alors s’asseoir sous un des arbres verts et ses deux fils ne s’écartaient plus d’elle. Elle formait un tableau sublime auquel ne manquaient ni les pourpres mélancoliques de l’automne, avec ses feuilles jaunes et ses arbres à demi dépouillés, ni la lueur adoucie du soleil et les nuages blancs du ciel de Touraine."
Après la mort de celle qui se faisait appeler Mme Willemsens, le fils aîné s’engagea dans la marine et le plus jeune entra comme interne au collège de Tours.
LA ROCHE-CORBON ET MARMOUTIER DANS L'EXCOMMUNIÉ
La Loire baigne les pieds de la falaise où se dresse le château de Roche-Corbon, dont il ne reste plus qu'une "lanterne", "cette tour antique, cette lanterne de Rochecorbon qui, semblable à un fantôme, apparaît aux voyageurs sur les coteaux de Touraine et dresse au-dessus des collines sa tête noircie par le temps".

Balzac situa dans ce château disparu une longue scène de son roman historique L'Excommunié, qui se passe au XVe siècle.
À trois mille environ de la ville de Tours, sur la levée d’Orléans, on remarque un énorme rocher creusé de telle façon qu’il offre une vague ressemblance avec le croissant de la lune. Sur le sommet de l'arc, à la partie la plus éloignée du centre, se dresse une tour sombre et haute supportée par un fragment de muraille dont les fondations presque à jour dépassent encore de près d'un pied le rocher sur lequel elles sont assises. Cette tour, nommée "la Lanterne de Rochecorbon", est le dernier vestige de l'un des anciens et des plus forts châteaux de la Touraine. Ce monument de la puissance féodale tire son nom de l'usage auquel il était destiné, car on aperçoit encore les petites embrasures par lesquelles le vigilant factionnaire examinait la campagne pour avertir les habitants du château en cas d'attaque.
Au commencement du XVe siècle, le rocher, dont les flancs abritent aujourd'hui une nombreuse population de vignerons, s'avançait jusqu'à la Loire, à laquelle il servait de quai pendant plus d'une lieue, et il n'y avait aucune trace de la levée que l'on a construite à grands frais, et sur laquelle passent les voyageurs. C'était précisément à l'endroit où la lanterne est située que s'élevait le château de Roche~Corbon, antique demeure du héros de cette aventure.
Le château, qui formait l'habitation principale des barons de Roche-Corbon, était précédé d'une vaste cour carrée dans laquelle on aurait pu ranger en bataille cinq cents hommes d'armes. Cette cour était entourée d'une épaisse muraille aux angles de laquelle s'élevaient d'énormes tours crénelées. L'entrée principale avait pour ornement une de ces tours plus considérable que les autres, et la porte était défendue par un large fossé sur lequel s' abaissait au besoin un pont-levis. Quant à la partie du château habitée par le seigneur, elle était composée de deux tours rondes plus petites que les autres et séparées par un corps de logis percé d'étroites croisées en ogives.
Ce manoir, posé comme l'aire d'un aigle sur le sommet du rocher, avait la vue de plus de cinquante mille arpents de terre qui se trouvaient de l'autre côté de la Loire.
Rien de plus pittoresque et de plus varié que le paysage qui se déroulait sous les yeux. La rivière forme en cet endroit un vaste bassin qui, à cette époque, présentait l'aspect d'un lac, car le fleuve n'était pas contenu par la levée que Louis XI fit commencer du côté d'Amboise pour préserver les campagnes qui séparent le Cher et la Loire. Ce fleuve répandait alors sa nappe brillante et polie sans rencontrer d'autres obstacles que ceux qui résultaient de la nature du sol, et Tours, comme Venise, semblait élever du sein des ondes ses murailles défendues par de grosses tours. Les eaux, comme une glace pure, réfléchissaient donc, sur une immense étendue, le beau ciel de la Touraine.
Dans le lointain, au midi, l'on apercevait les tours de la plus ancienne cathédrale de France et le bâtiment de Saint-Julien, dont les flèches hardies mêlaient aux beautés de ces lieux l'introduction du christianisme dans les Gaules. Les eaux venaient mugir aux pieds de la belle châtelaine qui, en tournant la tête, parcourait un autre horizon immense borné par les jolies collines qui s'entassent depuis Amboise jusqu'à Azai, devant lesquelles coule le Cher. Les prairies, les eaux, les villages, les forêts, semblaient placés par la main d'un habile décorateur.
Voici les données de cette histoire du conflit entre les seigneurs de La Roche-Corbon et les moines de Marmoutier.
La seigneurie de Roche-Corbon, qui possédait de grands biens en Touraine, exerçait sa suzeraineté sur tout le pays qui comprend Vernou, Vouvray, Monnaie, Saint-Symphorien. C'est un des ancêtres de la famille des Roches qui fit don à saint Martin du vallon solitaire où il fixa sa retraite avec ses disciples et qui devint la célèbre abbaye de Marmoutier. Le monastère, par la suite, bénéficia constamment des générosités du château et des avantages qui lui furent successivement concédés. Ce fut Hugues de Roche-Corbon, qui, en 1220, entreprit la construction de l'église abbatiale.
Mais bientôt l'abbaye allait devenir à son tour une véritable seigneurie. Son influence en Touraine fut considérable. Ses richesses ne se comptèrent plus. Les abbés qui se succédèrent à la tête de la communauté n'eurent d'autre but que d'obtenir de nouveaux privilèges et d'avoir à leur tour des serfs, des vassaux, des hommes d'armes. Ils se firent, à la suite d'un procès, concéder la vassalité de Saint-Symphorien qui était sous la dépendance de Roche-Corbon. Ainsi, l'abbaye, créée autrefois par les seigneurs de Roche-Corbon, se retournait contre eux et devenait une implacable ennemie. Une guerre sourde eut lieu entre le monastère et le château. Elle devait aboutir à un éclat funeste. L'abbaye ne reconnaissant aucune juridiction, il était impossible de se garantir contre ses exigences.
Un jour, l'abbé Hélias, fort de son autorité et de son prestige, décida d'affranchir l'abbaye de la suzeraineté de Roche-Corbon et de ne reconnaître que la souveraineté du roi. Il alla plus loin: il établit que le château lui-même relèverait de l'abbaye. Il manda donc au monastère le baron Ombert de Roche-Corbon. Celui-ci s'y rendit à cheval, accompagné d'hommes d'armes. Arrivé dans la cour, devant l'église d'où sortait l'abbé suivi des moines, son cheval se cabra et, soit colère de sa part, soit maladresse, le baron bouscula le cortège. L'abbé fut renversé et légèrement blessé.
L'abbé Hélias vit là un attentat à la sainteté de l'Eglise. Il consulta l'évêque et menaça Ombert de le frapper d'excommunication. Ombert avait été élevé par son père dans la crainte de Dieu et dans l'exécration des religieux. Sa fureur ne connut plus de bornes. Il jugea que le moment était venu de terminer cette querelle par un coup de force en obligeant l'abbé à accepter une charte définitive. Il se mit à la tête de ses hommes d'armes et fit le siège de l'abbaye. Il incendia la porte qu'il était impossible d'enfoncer et rassembla ses hommes au cri de "Roche-Corbon à la rescousse"! Soudain une troupe armée, très supérieure en nombre, sortit de derrière l'abbaye ou descendit la colline et se précipita sur les assaillants au cri de "Montjoie Saint-Denis"! C'était le mot de ralliement du duc d'Orléans qui, étant en Touraine, s'était fait le protecteur de l'abbaye. La petite troupe du baron de Roche-Corbon fut rapidement mise en déroute. L'abbé Hélias avait tout prévu. Il était maintenant décidé à exploiter son triomphe jusqu'au bout.
Un mois après eut lieu la terrifiante cérémonie de l'excommunication. Ombert était dans son château avec sa femme Catherine, ses fidèles et ses vassaux lorsqu'on entendit les lourdes cloches de Marmoutier qui sonnaient le glas de la mort. Un héraut d'armes vint annoncer qu'une procession de moines, conduite par l'évêque de Tours et l'abbé Hélias, se dirigeait en chantant vers le château. Tous les assistants furent atterrés. "Allons voir cela, dit Ombert. Montons sur les remparts... Est-ce donc quelque chose de si redoutable que des prêtres qui chantent?" On le suivit. La procession s'avançait par la route haute sur le plateau. Elle était encadrée par des hommes d'armes. Les moines, revêtus du costume blanc et noir de l'ordre de Saint-Benoît, tenaient des cierges et psalmodiaient des hymnes de mort. Les croix étaient voilées de noir. Quatre novices portaient un cercueil. L'abbé Hélias et l'évêque de Tours avaient revêtu leurs costumes et leurs ornements les plus magnifiques. Le soleil faisait éclater leurs mitres d'or. Tout le clergé de la cathédrale était là. Quand ils approchèrent du château, Ombert descendit dans la cour et donna l'ordre d'abaisser le pont-levis. Il se tint sur le perron, sa femme Catherine à son côté et de l'autre Roch, son fidèle écuyer, tous les siens auprès de lui, ses hommes d'armes, ses écuyers, ses fauconniers, ses varlets. La procession pénétra dans l'enceinte des murailles. Les chants se firent plus lugubres. La foule se massa derrière les moines. Soudain tout ce tumulte s'apaisa. Les chants cessèrent. Les cloches ne sonnèrent plus. Le cercueil fut déposé et recouvert d'un drap noir. Douze prêtres qui portaient douze cierges noirs les jetèrent près du cercueil et les foulèrent aux pieds. Puis ce fut le silence, un silence effrayant. On allait lire la sentence d'excommunication: "Nous excommunions, damnons, anathématisons et rejetons hors du sein de notre sainte mère l'Eglise Joseph-Ombert, baron et seigneur suzerain de la Roche-Corbon, Vernou, Monnaye, etc... Nous excommunions également tous ses complices et adhérents qui ne se sépareront pas de lui à l'instant même. Que Dieu les poursuive et les punisse dans les siècles, que leurs fils soient orphelins, leurs épouses veuves, que chacun leur refuse le pain et les fuie comme une peste maudite."
En fait cette excommunication était une manœuvre d'un seigneur de sang royal qui, épris de Catherine de la Bourdaisière, avait imaginé ce moyen pour la séparer de son époux, le baron Ombert.
VOUVRAY
Balzac avait 24 ans, en 1822, lorsqu'il vint faire un séjour à Vouvray chez M. de Savary, beau-père de Jean de Margonne. La Caillerie, près de la Vallée-Coquette, était un beau domaine de quinze hectares de vignobles (la maison du XVIe siècle n'existe plus; il n'en reste que les dépendances).
"Mr. de Savary est venu-z-ici ; il a toujours sa petite perruque de chiendent qu'il raffermit à chaque instant en la prenant par deux mèches qui se trouvent collées contre ses tempes." (Balzac à Laure Surville, Villeparisis, février 1822).
L'hôte de Balzac à Vouvray se retrouve dans le Curé de Tours, sous le nom de M. de Bourbonne: "Il appartenait à la classe des planteurs de province, gens habitués à se rendre compte de tout, à faire des marchés avec les paysans et, à ce métier, un homme devient perspicace malgré lui."
A Vouvray, Balzac a fait son éducation de dégustateur. Dans l'Illustre Gaudissart, il portera ce jugement de connaisseur: "L'inconvénient du vin de Vouvray est de ne pouvoir se servir ni comme vin ordinaire ni comme vin d'entremets: il est trop généreux, trop fort". Et Théophile Gautier témoignera plus tard: "Balzac mangeait avec une joviale gourmandise qui inspirait l'appétit, et il buvait d'une façon pantagruélique: quatre bouteilles de vin blanc de Vouvray, un des plus capiteux qu'on connaisse, n'altéraient en rien sa forte cervelle et ne faisaient que donner un pétillement plus vif à sa gaieté."

A Vouvray le syndicat des voyageurs de commerce a fait élever une statue au héros de la nouvelle de Balzac L'Illustre Gaudissard (1833). L'artiste s'est efforcé de reproduite la silhouette de cet "homme de trente-huit ans, de taille moyenne, gros et gras, à figure ronde comme une citrouille, colorée, régulière, dont le ventre protubérant affectait la forme de la poire, qui avait de petite jambes, mais était agile et nerveux".
Le Félix Gaudissart imaginé par Balzac est un commis-voyageur "rond en affaires, bon homme, rigoleur", à qui ses immenses succès ont valu le surnom d'illustre. Il a travaillé d'abord dans les chapeaux, puis dans l'Article-Paris. Puis, à partir de 1830, pour satisfaire aux besoins de sa maîtresse, la fleuriste Jenny Courand, il s'est mis à placer des assurances et des abonnements à des journaux.
D'abors ses affaires allèrent bien: à Orléans, il a pu placer 162 châles de cachemire ("je ne sais pas ce qu'ils en feront, à moins qu'ils ne les remettent sur le dos de leurs moutons"!); à Amboise, à Blois, à Tours, il parvint aussi, par sa faconde, à "rouler" bon nombre de naïfs.
C'est à Vouvray, "un canton riche et populeux dont l'esprit public lui parut susceptible d'être exploité", qu'allait périr "son infaillibilité commerciale".
S'étant installé au Soleil-d'Or, l'auberge tenue par Mitouflet, un ancien grenadier de la Garde impériale, il se rendit d'abord chez "le malin de Vouvray, le boute-en-train du bourg", monsieur Vernier. Celui-ci, bien décidé à lui jouer un bon tour, l'envoya chez un homme "à peu près fou", un certain Margaritis, qui habitait "en haut d'une délicieuse vallée, nommée la Vallée Coquette, à cause de ses sinuosités, de ses courbes qui renaissent à chaque pas et paraissent plus belles à mesure que l'on s'y avance". A l'issue d'une rude négociation, le fou réussit à faire signer à Gaudissard une commande pour deux pièces de vin… qui appartenaient à son voisin. Comprenant que Vernier s'était moqué de lui en l'envoyant chez un fou, Gaudissard lui donna un soufflet. Les deux hommes se rencontrèrent pour un duel lendemain "au bas du pont de la Cise", mais ils se réconcilièrent aussitôt et la femme de Margaritis, pour éviter un procès, apporta vingt francs à Gaudissard, en dédommagement des deux pièces de vin. Mais, désormais, Gaudissard se méfia des habitants des "contrées méridionales".
À Vouvray, Balzac avait eu le désir d’acheter le château de Montcontour. Il l'avait montré à Mme Hanska lors de leur séjour à Tours en 1845, après lui avoir écrit:
Montcontour est ma prédilection; je voudrais que tu vinsses le voir, tant c'est joli. C'est une des plus belle vues de Touraine, et il y a une station à une demi-lieue, celle de Vouvray. Si nous avions Montcontour, tous mes plans seraient changés. Je ne meublerais plus si richement l'appartement de Paris. Nous attendrions. Je réunirais tous mes efforts sur le château de Montcontour, car on peut l'habiter toujours. Si, plus tard, nous avions une terre, il faudrait toujours venir y passer les automnes qui y sont délicieux. Ce serait notre séjour pour au moins dix ans, et nous passerions décembre, janvier, février, mars et avril à Paris. A aucun moment de notre amour, je n'ai eu pareille impatience d'avoir à moi mon adorée. Quand je pense que nous n'avons pas encore eu une seule nuit tranquille et entière, avoue que ce désir immense de tenir ma femme renfermée dans le château fort de Montcontour est bien naturel.
En 1846, il lui écrivit:
«Tu vas sauter de joie! Montcontour est à vendre. Ce rêve de trente ans de ma vie va se réaliser, ou peut se réaliser. En somme, il faut mettre quatre-vingt mille francs, mais il y a pour trente à quarante mille francs de bien de trop à vendre en détail. Montcontour a vingt arpents de vignes qui, d'après les plus sûrs renseignements, produisent (en moyenne par dix ans) quatre pour cent des quatre-vingt mille francs. L'arpent vaut entre trois et quatre mille francs. C'est beaucoup trop que d'avoir vingt arpents à exploiter. Il faut en vendre au moins dix. Ce serait donc quarante ou cinquante mille francs que coûterait Montcontour.
Te souviens-tu de Montcontour, de ce joli petit château à deux tourelles qui se mire dans la Loire, qui voit toute la Touraine, qui a deux terrasses superposées dont la deuxième a un couvert de tilleuls d'un demi-quart de lieue de long, avec une balustrade? Il y a d'excellents fruits, les meilleurs de la côte. Nous aurions donc le château pour rien et près de deux mille francs de revenu, sans compter les fruits et l'habitation.»Mais le prix de quatre-vingt mille francs fera reculer Mme Hanska, pourtant revenue à Tours en cette année 1846…

wiki-Les Hutchins
Dans La Femme de trente ans (1842) Balzac évoue à deux reprises le paysage vu de Vouvray.
En mars 1814, le couple d'Aiglemont s'arrête sur pour découvrir le paysage depuis le pont sur l'embouchure de la Cise [la Cisse] (p. 686-687) :
Les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche eurent le loisir de contempler à leur réveil un des plus beaux sites que puissent présenter les séduisantes rives de la Loire. A sa droite, le voyageur embrasse d'un regard toutes les sinuosités de la Cise, qui se roule, comme un serpent argenté, dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l'émeraude. A gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence. Les innombrables facettes de quelques roulées, produites par une brise matinale un peu froide, réfléchissaient les scintillements du soleil sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière. Çà et là des îles verdoyantes se succèdent dans l'étendue des eaux, comme les chatons d'un collier. De l'autre côté du fleuve, les plus belles campagnes de la Touraine déroulent leurs trésors à perte de vue. Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher, dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel. A travers le tendre feuillage des îles, au fond du tableau, Tours semble, comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs, où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres.
Au delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée, le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature, paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve dont les flots minent incessamment la pierre, spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur.
Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges et les éboulements de ces roches, qui commencent à décrire un coude devant le pont de la Cise. Puis, de Vouvray jusqu'à Tours, les effrayantes anfractuosités de cette colline déchirée sont habitées par une population de vignerons. En plus d'un endroit il existe trois étages de maisons, creusées dans le roc et réunies par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d'un toit, une jeune fille en jupon rouge court à son jardin. La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments et le pampre naissant d'une vigne. Des closiers labourent des champs perpendiculaires. Une vieille femme, tranquille sur un quartier de roche éboulée, tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier, et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi. Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du sol que de la ruine pendante d'un vieux mur dont les assises ne sont plus retenues que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre. Le marteau des tonneliers fait retentir les voûtes de caves aériennes. Enfin, la terre est partout cultivée et partout féconde, là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine. Aussi rien n'est-il comparable, dans le cours de la Loire, au riche panorama que la Touraine présente alors aux yeux du voyageur. Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués, procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son souvenir; et, quand un poète en a joui, ses rêves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques.
Au moment où la voiture parvint sur le pont de la Cise, plusieurs voiles blanches débouchèrent entre les îles de la Loire, et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site harmonieux. La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide. Les oiseaux faisaient entendre leurs prolixes concerts; le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie, tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine. De molles vapeurs, capricieusement arrêtées autour des arbres épars dans ce vaste paysage, y imprimaient une dernière grâce. C'était la Touraine dans toute sa gloire, le printemps dans toute sa splendeur.En août 1821, Julie et lord Grenville découvrent le paysage depuis le château de Montcontour (p. 719-720):
Montcontour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers au bas desquels passe la Loire. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles sculptées, brodés comme une dentelle de Malines; un de ces châteaux mignons, pimpants, qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de Montcontour pétillent sous les rayons du soleil, tout y est ardent. Mille vestiges de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation : les genêts d'or, les fleurs à clochettes embaument la brise: l'air est caressant, la terre sourit partout, et partout de douces magies enveloppent l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, l'amollissent et la bercent. Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous ce ciel si pur, devant ces eaux scintillantes. Là meurt plus d'une ambition, là vous vous couchez au sein d'un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pourpre et d'azur.
Par une douce soirée du mois d'août, en 1821, deux personnes gravissaient les chemins pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et lord Grenville, mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. Ses yeux étincelaient à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriait, elle était heureuse et concevait la vie. Sous l'ombrelle de soie blanche qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant, il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur, toujours mû par un perpétuel sentiment de bonté, par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme, sentiments qui semblaient être innés en lui, autant et plus peut-être que le mouvement nécessaire à sa propre existence.
Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher; mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site.
— Oh! reprit-elle, je voudrais rester toujours ici. Peut-on jamais se lasser d'admirer cette belle vallée? Savez-vous le nom de cette jolie rivière, milord?
— C'est la Cise.
— La Cise, répéta-t-elle. Et là-bas, devant nous, qu'est-ce?
— Ce sont les coteaux du Cher, dit-il.
— Et sur la droite? Ah! c'est Tours, mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale!
Elle se fit muette et laissa tomber sur la main d'Arthur la main qu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirèrent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. Le murmure des eaux, la pureté de l'air et du ciel, tout s'accordait avec les pensées qui vinrent en foule dans leurs cœurs aimants et jeunes.
L'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement, lorsque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que sur les hauteurs nos sentiments s'épurent: la passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la jolie colline où les deux amants s'étaient assis, causaient peut-être le calme délicieux dans lequel ils s'avouèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des paroles insignifiantes en apparence.
A ce moment, une brise caressante agita la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air; quelques nuages couvrirent le soleil et des ombres molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Arthur resta auprès d'elle jusqu'aux dernières heures du soir, presque silencieusement, disant de vagues paroles, douces comme le murmure de la Loire, mais qui remuaient l'âme. Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparaître, image mélancolique de leur fatal amour.
- 2 -
SACHÉ ET LA VALLÉE DU LYS
LE CHÂTEAU DE SACHÉ
Balzac a fait surtout des séjours fréquents au château de Saché chez l'ami de ses parents, Jean de Margonne.
Chez M. et Mme de Margonne
Jean Butet, propriétaire de Saché, a deux filles : | |
||
| |
| |
|
sa première fille épouse en 1780 Henri-Joseph de Savary, ancien capitaine de cavalerie, chef de la garde nationale de Tours; ils ont une fille : |
sa seconde fille |
|
| |
| |
|
Mlle de Savary (elle deviendra "l'intolérante, dévote et jaune Mme de Margonne") |
<— s'épousent en 1803 —> |
Jean de Margonne, propriétaire de Saché, lieutenant dans la Cohorte urbaine de Tours |
Le père de Balzac, adjoint au maire, connaît bien Henri-Joseph de Savary, chef de la garde nationale de Tours. La mère de Balzac entre en amitié avec le ménage de Margonne. Elle aura même, en 1807, un enfant, Henry, de Jean de Margonne et elle choisira pour parrain Henri-Joseph de Savary.
Les Margonne avaient à leur service un valet de chambre, une femme de chambre, un cocher, un cuisinier et son aide, un régisseur et un jardinier. Le domaine faisait 800 hectares, moitié en terres labourables et prés, moitié en bois et taillis; plus une vigne de 11 arpents et une métairie. Et le seigneur de Saché avait droit à une chapelle privée dans l'église.
M. de Margonne fut toujours très bienveillant pour le jeune Honoré, qui vint passer à Saché les étés 1813 et 1814. Plus tard, Balzac vint à Saché pratiquement tous les ans entre 1829 et 1837, cela pour plusieurs raisons:
–
quand, sur les prescriptions du docteur Nacquart, il devait se refaire une santé,
–
quand il voulait se libérer des tracas de Paris,
– quand il voulait
fuir les huissiers au moment des lourdes échéances,
–
quand il ne voulait pas répondre à la loi sur la garde nationale (car rien ne l'horrifiait plus que la perspective d'être de faction avec le ceinturon et le flingot),
–
quand il était un peu démuni d'argent (il arrivait alors avec une centaine de francs en poche pour passer plusieurs semaines au bout desquelles il empruntait quelquefois un peu d'argent à son hôte, qui accédait de bonne grâce à ses demandes réitérées plus ou moins discrètes).
M. de Margonne paraît avoir été un excellent homme qui aimait beaucoup Balzac et le considérait comme son fils : "Honoré trouva de tout temps chez M. de Margonne, ami de notre famille, la plus noble hospitalité unie à la plus constante affection" (Laure de Surville). Balzac a donc eu tort de se plaindre un jour de "la sèche hospitalité de M. de Margonne".
Balzac écrit à Mme Hanska : "Saché est un débris de château sur l'Indre, dans une des plus délicieuses vallées de Touraine. Le propriétaire, homme de cinquante-cinq ans, m'a fait jadis sauter sur ses genoux. II a une femme intolérante et dévote, bossue, peu spirituelle. Je vais là pour lui, et puis j'y suis libre. On m'accepte dans le pays comme un enfant; je n'y ai aucune valeur et je suis heureux d'être là comme un moine dans un monastère. Je vais toujours méditer là quelques ouvrages sérieux. Le ciel est si pur, les chênes si beaux, le calme si vaste."
De Paris à Saché
Pour venir de Paris à Saché, Balzac partait de la rue Notre-Dame-des-Victoires, à six heures du soir, par la diligence qui allait jusqu'à Bordeaux. On roulait la nuit jusqu'à un arrêt à Beaugency à neuf heures du matin et on arrivait à Tours à cinq heures du soir. C'était un voyage de vingt-trois heures, qui coûtait 98 francs. Quand M. de Margonne l'attendait, il allait le prendre en voiture à l'arrivée de la diligence, sur le quai du Pont-Neuf à Tours. De là, il fallait deux heures pour atteindre Saché.
Quand il n'était pas attendu, Balzac, par souci d'économie, pouvait faire à pied les vingt kilomètres séparant Tours de Saché:
–
Ce fut le cas le 25 juillet 1830 alors que Mme de Berny venait de quitter La Grenadière pour rentrer à Paris. Balzac traversa la Loire par le bac de Saint-Cyr, sortit de Tours par Pont-Cher, monta la côte de Joué-les-Tours et, au lieu de prendre la route d'Azay, il coupa par "les landes de Charlemagne" (ce nom est une allusion à l'affrontement entre Charles Martel et les avants-gardes sarrasines) pour arriver à la vallée de l'Indre. On reconnaît l'itinéraire qu'il fera prendre à Félix de Vandenesse.
–
Une autre fois, il raconte : "J'avais entrepris d'aller à pied de Tours à Saché. La chaleur était si forte, le soleil si brûlant que, malgré ma volonté de faire le chemin d'une seule traite par gageure avec moi-même, je fus forcé de m'arrêter à Pont-de-Ruan". Là, précisément à l'Alouette, une "femme Martin" l'accueillit et lui offrit un bol de lait. Ce trajet sera reprit par Félix de Vandenesse. Et, au début du Médecin de campagne, le commandant Genestas, fatigué par une longue marche, s'arrêtera se reposer dans une ferme et y boire un bol de lait.
Saché lieu d'écriture pour Balzac
Quand il arrive à Saché, Balzac respire d'abord l'air du pays natal, il prend du repos, il se donne des vacances, il vit comme un mollusque, "comme l'huître en sa coquille, bâillant au soleil couchant". Puis il se met au travail, dans sa petite cellule.
II y avait bien de plus grandes chambres que la sienne, dans le château ; mais Balzac avait voulu celle-là, parce qu'elle était comme une cellule de moine. Il disait : "Plus une âme est resserrée physiquement et plus elle jaillit vers les cieux. C'est là un des secrets de la cellule et de la solitude". C'est dans cette chambre qu'il a écrit en partie ses plus beaux chefs-d'œuvre : Louis Lambert, la Recherche de l'absolu, les Illusions perdues, Séraphita, le Père Goriot, le Lys dans la Vallée, César Birotteau. C'est là qu'il a commencé Eugénie Grandet, c'est là qu'il a travaillé à une œuvre qu'il considérait comme une de ses plus belles conceptions et qui devait se placer en tête des scènes de la vie militaire, mais qui ne fut jamais achevée, la Bataille.
Avec une épouse dévote, revêche, d'esprit étroit et laide par surcroît, M. de Margonne devait sentir peser sur lui un mortel ennui, et il était sans doute heureux quand Balzac arrivait. Mais il avait le plus grand respect pour son travail et jamais on ne le dérangeait.
Balzac écrivait sans discontinuer de cinq heures du matin à cinq heures du soir, mangeant seulement quelques tartines de pain accompagnées de café, qu'il faisait lui-même à l'aide d'une lampe à "esprit-de-vin". La cloche du repas interrompait brutalement son travail. "Ici, il faut s'habiller à heure fixe et cela semblerait étrange à des gens de province de rester sans dîner pour suivre une idée. Il m'en ont déjà bien étranglé avec leur cloche", écrit-il à Mme Carraud. Encore ne descendait-il pas toujours.
Balzac a écrit un jour à Mme Hanska : "Je suis en ce moment dans cette petite chambre de Saché où j'ai tant travaillé. J'ai ici, depuis quelques jours, contemplé l'étendue de mon œuvre et ce qui me reste à faire. C'est énorme, Aussi, en voyant cette immense fresque, ai-je une grande envie de me retirer dans un cottage de Touraine et d'y accomplir paisiblement, sans souci, cette œuvre qui m'aidera à passer ma vie." Mais les soucis financiers l'obligent à chaque fois à revenir à Paris pour s'occuper de ses affaires. A la fin de 1836, il écrit encore à Mme Hanska, toujours depuis Saché : "Les moments où mon énergie m'abandonne deviennent plus fréquents. Ah! mon Dieu, quand aurai-je en Touraine une petite terre, un petit château, un petit parc, une belle bibliothèque; et pourrai-je habiter cela sans ennui en y logeant l'amour de ma vie ?"
Les soirées de Saché
Quand il y avait des invités, il restait au salon jusqu'à dix heures, quelquefois gai, exubérant, quelquefois sombre et silencieux, suivant les idées qu'il avait en tête. C'est que Balzac n'était pas dans son milieu et ne réussissait pas toujours à dérider les commensaux habituels de la maison. II avait bien essayé de leur raconter des histoires drôles empruntées à Rabelais. Mais il se heurtait à la pruderie de Mme de Margonne. Et d'ailleurs dans ce pays de Rabelais on ignorait Rabelais, ou du moins on ne le comprenait pas.
Quand M. de Margonne obtenait de lui qu'il voulût bien leur parler de ses œuvres, de ses projets, Balzac ne demandait que cela. Une fois, il avait lu le commencement d'Eugénie Grandet : on avait écouté avec beaucoup d'attention et de curiosité. Un autre soir, il y avait une assistance de choix. Il y avait le marquis de Biencourt, du château d'Azay-le-Rideau; M. Goüin, le riche banquier de Tours, qui habitait le château de Miré, près de Ballan; M. et Mme de Vonne et Mme de Landryève. Il y avait aussi la baronne Caroline Deurbroucq, jeune et riche veuve que Balzac avait eu le projet d'épouser, projet que Mme de Berny approuvait. Ce soir-là, Balzac remporta sur ses auditeurs un succès complet. Il leur parla de leur pays, de leur rivière, de leurs châteaux : il leur lut des passages du Lys dans la Vallée.
Quand Balzac lisait, il était extraordinaire; il plantait les décors, il figurait les personnages, sa voix s'étendait, se modulait, s'adoucissait, et l'émotion qui s'emparait de lui gagnait toute l'assistance. Il ne pouvait pas parler sans se déplacer. Comme le salon avait dix mètres de long sur dix mètres de large, il n'était pas gêné dans ses évolutions. Parfois il lisait le manuscrit, d'autres fois il racontait, il enchaînait. Mais, quand il voulait reprendre le texte, il ne se trouvait plus sous la lampe ; il était parti à l'autre bout du salon, dans une demi-obscurité. Alors on allumait des candélabres en différents points de la pièce. II put ainsi aller d'un foyer de lumière à l'autre. C'était un admirable comédien. Et il ne pouvait s'empêcher de dire, gagné lui-même par son enthousiasme : "Comme c'est beau! C'est beau tout de même! — Oui! oui! oui!", disait l'auditoire, entièrement conquis. Seule Mme de Margonne faisait dans son coin une mine renfrognée.
Balzac montait dans sa chambre tous les soirs à dix heures. Une nuit d'été, un magnifique clair de lune éclairait le parc et, plus loin, l'église avec sa forte tour et le petit cimetière. Il décida que c'est dans cette chambre qu'il amènerait Félix de Vandenesse après la mort de la comtesse : "Je demeurai quelques jours dans une chambre dont la fenêtre donnait sur ce vallon tranquille et solitaire. C'est un vaste pli de terrain bordé par des chênes deux fois centenaires et où, par les grandes pluies, coule un torrent. Cet aspect convenait à la méditation sévère et solennelle à laquelle je voulais me livrer. Hélas! tel était donc le dénouement du plus vif amour qui ait jamais atteint le cœur d 'un homme !"
Saché cara patria
Quand, en 1833, il connut l'identité de la mystérieuse "Étrangère", il lui fit, dans une de ses premières lettres, une longue description de Saché et de ses hôtes. Trois ans après, il était encore à Saché lorsqu'il reçut une lettre de rupture de Mme Hanska (qui avait appris qu'il avait au moins deux maîtresses à Paris). Il tombe alors, foudroyé par un "coup de sang". Mais, se reprenant vite, il écrivit à Mme Hanska : "La Touraine est bien belle en ce moment ; il fait une chaleur excessive qui fait fleurir les vignes. Ah! mon Dieu, quand aurais-je une petite terre, un petit château, un petit parc, une belle bibliothèque, et pourrai-je habiter cela sans ennui, en y logeant l'amour de ma vie ? Plus je vis, plus ces souhaits dorés prennent les teintes de mes rêves; et cependant y renoncer ce serait pour moi la mort !"
Chaque année, il éprouvait le besoin de "revenir dans la cara patria, [se] reposer comme un enfant sur le sein de sa mère". En 1837, bien qu'atteint d'une "inflammation de la poitrine", il y écrivit pourtant César Birotteau.
Visite de Saché

Saché est une construction de la fin du XVIe siècle, élevée sur des vestiges d'une ancienne place-forte. De la Renaissance ne subsistent plus que la porte d'entrée à bossages et l'escalier en vis qui flanque le milieu du corps de logis principal. Il a été agrandi d'une aile au XVIIe siècle puis d'une seconde au XVIIIe siècle.
Déjà à l'époque de M. de Margonne les meneaux des fenêtres avaient disparu et des plafonds de plâtre avaient dissimulé les poutres. Des boiseries Directoire ornaient les pièces de réception, qui décoraient de riches papiers peints, sur le thème, en particulier de Télémaque dans l'île de Calypso (on retrouvera ce papier dans la salle à manger de la pension Vauquer).

wiki-Mandred Heyde
— "Je vis dans un fond les masses romantiques du château de Saché, mélancolique séjour plein d'harmonies, trop graves pour les gens superficiels, chères aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimai-je le silence, les grands arbres chenus et ce je ne sais quoi de mystérieux épandu dans son vallon solitaire." (Le Lys dans la vallée)
— "Je suis heureux d'être là comme un moine dans un monastère. Je vais toujours y méditer quelque ouvrage sérieux." (Correspondance)
— "Plus une âme est resserrée physiquement, plus elle jaillit vers les cieux : c'est là le secret de la cellule et de la solitude." (Correspondance).
La salle à manger
Le grand salon est la seule pièce parquetée. Le papier peint date de la fin du XVIIIe siècle ; il figure une frise de fleurons stylisés flanqués de gros cabochons verts à tête de lion entre lesquels se déploie une draperie à l'antique, le tout d'une tonalité vieil or un peu passée.

"Le papier aux lions qui décore le salon de M. de Margonne à Saché..." (Correspondance)
wiki-Mandred Heyde
La chambre de Balzac, au premier étage, a conservé son lit dans l'alcôve, le crucifix d'ivoire, le bureau, le fauteuil. Mais le papier peint à petits losanges a été remplacé. Sur le bureau, un massicot pour couper le papier, une lampe à réservoir et une cafetière.

wiki-Lograsset
De la fenêtre on ne voit que la forêt ("Ma chambre, que les curieux viennent déjà voir par curiosité, donne sur des bois deux ou trois fois centenaires"). Il faut aller dans une autre pièce pour voir l'église, le village de Saché et, tout en face, au loin, le château de "Clochegourde".

wiki-Agota
Des intérieurs fictifs tels qu'ils sont décrits dans quatre romans :
– la salle à manger et le salon
du château de Clochegourde du Lys dans la Vallée (table de trictrac, métier à tisser de Mme de Morsauf, rideaux de percale blanche bordés d'un simple galon, housses de siège, cabinet Boulle, chaises Louis XIV en bois sculpté, vases en porcelaine blanche à filets d'or et argenterie de famille).
–
la chambre du Curé de Tours,
–
le boudoir de Foedora dans La Peau de Chagrin,
–
le cabinet de l'avoué Derville dans Le Colonel Chabert.
En 1926 le domaine de Saché a été acheté par la famille Métadier qui, en 1951, y a créé un musée dont Paul Métadier est resté conservateur jusqu'au début des années 2000. En 1958, la famille Métadier a donné le château et ses collections au Conseil général d'Indre-et-Loire.
Entre Valesne et Saché, on rencontre "un vaste pli de terrain où, par les grandes pluies, coule un torrent (Le Lys dans la vallée). En suivant ce "ravin", on arrive à la "Grotte de Balzac", dite avant lui "grotte de la Bienheureuse".
Il s'agit, au début du XVIIe siècle, de Marguerite, fille de René de Rousselet, seigneur de Saché et de Pont-de-Ruan. Contre la volonté de ses parents, qui refusèrent de la laisser entrer aux Carmélites, la jeune fille s'imposa une vie d'une extrême rigueur et mourut de privations à vingt ans. Sa tombe, à droite de la sacristie de Saché, a été l'objet d'un culte populaire. On dit qu'elle venait prier dans cette grotte, qui était reliée à l'église par un souterrain.
LA VALLÉE DU LYS
Balzac, par ses fréquents séjours chez M. de Margonne, connaissait bien la portion de la vallée de l'Indre en amont de Saché, jusqu'à Artannes.
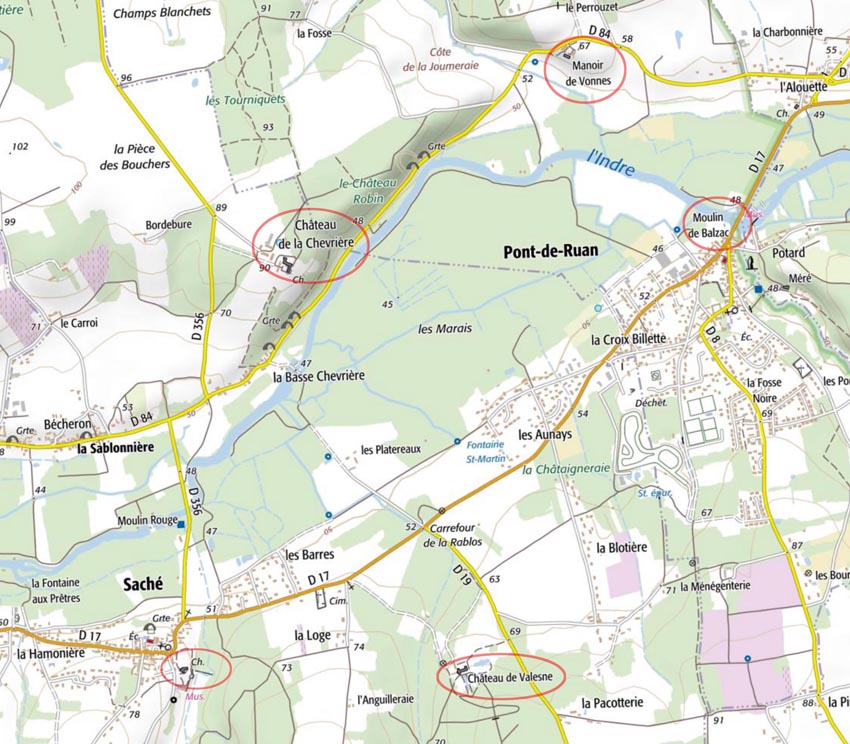
Il fit de cette vallée et de ses petits châteaux (Saché, Vonne, Valesne, La Chevrière) le cadre d'un roman où Mme de Berny prit le nom de Mme de Mortsauf et où les châteaux changèrent de nom :
— Valesne, en hommage à Zulma Carraud, devint Frapesle (la demeure de M. de Chessel),
— Clochegourde (la demeure de M. de Mortsauf) se trouva à l'emplacement de La Chevrière, mais emprunta son architecture au petit manoir de Vonne.
Le château de VALESNE appartenait à M. de Margonne, mais il le laissait à son régisseur. Balzac, dans les manuscrits de son roman, lui avait d'abord laissé son nom ; puis il l'avait transformé en "Frapesle", nom de la propriété de Mme Carraud, son amie d'Issoudun. Dans le château de Valesne, on montre un "oratoire de Balzac" avec un balcon d'où l'on voit le château de la Chevrière sur le haut de la colline opposée. C'est de là que Félix de Vandenesse contemplait Clochegourde…
"Pendant le retour de la paroisse à Frapesle, trajet qui se faisait à travers le bois de Saché où la lumière filtrée dans les feuillages produisait, sur le sable des allées, ces jolis jours qui ressemblent à des soieries peintes." (Le Lys dans la vallée)

JN 1977
Le château de LA CHEVRIÈRE, emplacement de Clochegourde dans le roman, est en rapport avec Clochegourde par sa longue allée d'acacias et de vernis du Japon et par les pentes qui continuent le parc du château pour rejoindre la prairie de l'Indre. La demeure est une habitation en longueur à un étage, flanquée d'un pavillon carré de style Renaissance, mais récent. En bas des pentes, le petit moulin de la Chevrière est sur l'itinéraire que Félix suivait pour aller de Frapesle à Clochegourde.

JN 1977
Le manoir de VONNE est un petit château du XVIe siècle devenu une simple ferme (dans son roman, Balzac l'appelle la ferme de Baude). C'est à lui que pense Balzac quand il décrit Clochegourde: "Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage, a cinq fenêtres de face. Chacune de celles qui terminent la façade exposée au midi s'avance d'environ deux toises, artifice d'architecture qui simule deux pavillons et donne de la grâce au logis. Celle du milieu sert de porte, et on descend par un double perron dans des jardins étagés qui atteigent à une étroite prairie située le long de l'Indre."

JN 1977
LE LYS DANS LA VALLÉE
Nous sommes à l'époque de la première Restauration. Parti de Bordeaux pour rejoindre Louis XVIII à Paris, le duc d'Angoulême recevait à son passage dans chaque ville un accueil enthousiaste. A Tours, la fête devait se terminer par un grand bal officiel, le premier bal auquel allait assister le jeune Félix de Vandenesse, frais émoulu du collège des Oratoriens.. Trop timide pour inviter une danseuse, il se réfugie dans le coin d'un petit salon isolé, au bout d'une banquette. Une jeune femme s'assied près de lui sans le remarquer. Le jeune homme est vivement impressionné par cette femme, son parfum, ses blanches épaules, "des épaules légèrement rosées, qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois", sur lesquelles il ne peut s'empêcher de poser un baiser. La jeune femme pousse un cri de surprise et s'éloigne. Désormais, Félix n'aura plus qu'une idée: retrouver sa belle inconnue.
En pensant que mon élue vivait en Touraine, j'aspirai l'air avec délices; je trouvai au bleu du temps une couleur que je ne lui ai vue nulle part. Si j'étais ravi mentalement, je parus sérieusement malade et ma mère eut des craintes mêlées de remords. Quant à moi, j'allai me réfugier dans un coin du jardin pour y rêver au baiser que j'avais volé.
La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine ne connaît rien, fut regardée comme le meilleur moyen de me sortir de mon apathie. Ma mère décida que j'irais passer quelques jours à Frapesle, château situé sur l'Indre, entre Montbazon et Azay-le-Rideau, chez l'un de ses amis.
Le jour où j'eus ainsi la clef des champs, j'étais comme plongé dans l'océan de l'amour. J'ignorais le nom de mon inconnue. Comment la désigner? Où la trouver? D'ailleurs, à qui pouvais-je parler d'elle? Mon caractère timide augmentait encore les craintes inexpliquées qui s'emparent des jeunes cœurs au début de l'amour et me faisait commencer par la mélancolie qui termine les passions sans espoir. Je ne demandais pas mieux que d'aller, venir, courir à travers champs. Avec ce courage d'enfant qui ne doute de rien et comporte je ne sais quoi de chevaleresque, je me proposais de fouiller les châteaux de la Touraine, en y voyageant à pied, en me disant à chaque jolie tourelle: «C'est là!»
Donc, un jeudi matin, je sortis de Tours par la barrière Saint-Eloi, je traversai les ponts Saint-Sauveur, j'arrivai dans Pont-Cher en levant le nez à chaque maison et gagnai la route de Chinon. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'arrêter sous un arbre, marcher lentement ou vite à mon gré sans être questionné par personne.
Pour aller au château de Frapesle, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes dites de Charlemagne, terres en friches, plates et sablonneuses, situées au sommet du plateau qui sépare le bassin du Cher et celui de l'Indre, et où mène un chemin de traverse que l'on prend à Champy jusqu'au petit pays d'Artannes.
Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines, une magnifique coupe d' émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent. A cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux, que l'ennui des landes ou la fatigue du chemin avait préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici.
A cette pensée, je m'appuyai contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée.
Elle demeurait là, mon cœur ne me trompait point: le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation.
Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquai dans ses vignes, sous un albergier. Elle était, comme vous le savez déjà sans rien savoir encore, le Lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel en la remplissant du parfum de ses vertus.
L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui parent de leurs dentelles mobiles ce val d'amour, par les bois de chênes qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant...
Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là-bas par un jour de printemps; si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne; au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel; en automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur, la vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leurs paisibles douceurs.
En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante, les peupliers se balançaient en riant, pas un nuage au ciel, les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine; je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert; je l'aime comme un artiste aime l'art! Sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus!
Pour aller à Frapesle, Félix traverse l'Indre aux moulins de Pont-de-Ruan :

Je descendis, l'âme émue, au fond de cette corbeille et vis bientôt un village que la poésie qui surabondait en moi me fit trouver sans pareil. Figurez-vous trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnées de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau; quel autre nom donner à ces végétations aquatiques, si vivaces, si bien colorées, qui tapissent la rivière, surgissent au-dessus, ondulent avec elle, se laissent aller à ses caprices et se plient aux tempêtes de la rivière fouettée par la roue des moulins? Çà et là s'élèvent des masses de gravier sur lesquelles l'eau se brise en y formant des franges où reluit le soleil.
Les amaryllis, le nénufar, le lys d'eau, les joncs, les phlox, décorent les rives de leurs magnifiques tapisseries. Un pont tremblant, composé de poutrelles pourries, dont les piles sont couvertes de fleurs, dont les garde-fous plantés d'herbes vivaces et de mousses veloutées, se penchent sur la rivière et ne tombent point; des barques usées, des filets de pêcheur, le chant monotone d'un berger, les canards qui voguaient entre les îles ou s'épluchaient sur le jard, nom du gros sable que charrie la Loire; des garçons meuniers, le bonnet sur l'oreille, occupés à charger leurs mulets: chacun de ces détails rendait cette scène d'une naïveté surprenante.
Imaginez, au delà du pont, deux ou trois fermes, un colombier, des tourterelles, une trentaine de masures séparées par des jardins, par des haies de chèvrefeuilles, de jasmins et de clématites; puis du fumier fleuri devant toutes les portes, des poules et des coqs par les chemins: voilà le village de Pont-de-Ruan, joli village surmonté d'une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. Encadrez le tout de noyers antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d'or pâle, mettez de gracieuses fabriques au milieu des longues prairies où l'œil se perd sous un ciel chaud et vaporeux, Vous aurez une idée d'un des mille points de vue de ce beau pays.
Enfin Félix arrive à Frapesle. Il traverse le parc à l'heure où la cloche annonce le déjeuner. Après le repas, M. de Chessel fait admirer la vallée à Félix. Et Balzac ne craint pas d'élargir l'horizon au-delà du vraisemblable:
« De toutes parts, je vis la vallée sous toutes ses formes; ici par une échappée, là tout entière; souvent mes yeux furent attirés à l'horizon par la belle lame d'or de la Loire où, parmi les coulées blondes, les voiles dessinaient de fantasques figures qui fuyaient emportées par le vent. En gravissant une crête, j'admirai pour la première fois le château d'Azay, diamant taillé en facettes, serti par l'Indre, monté sur pilotis masqués de fleurs. Puis, je vis dans un fond les masses romantiques du château de Saché, mélancolique séjour plein d'harmonies, trop graves pour les gens superficiels, chères aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimai-je le silence, les grands arbres chenus et ce je ne sais quoi de mystérieux épandu dans son vallon solitaire. »
Félix remplit de son rêve ce vallon mystérieux. M. de Chessel, qui le suit d'un œil paternel, voit qu'il regarde d'instinct un joli castel qui, sur la côte opposée de l'Indre, fait une tache blanche dans la verdure: c'est Clochegourde.
- Ceci est Clochegourde, lui dit M. de Chessel, une élégante maison appartenant au comte de Mortsauf. Mme de Mortsauf est une femme qui pourrait occuper partout la première place.
- Vient-elle souvent à Tours?
- Elle y est allée au passage du duc d'Angoulême.
Félix tressaille. C'est elle, pense-t-il. Il allait donc la revoir!
Peu après, en visite de voisinage, M. de Chessel le conduit à Clochegourde. Malgré l'appréhension de Félix de se trouver en présence de cette femme, son cœur palpitait à l'approche des événements qui devaient profondément modifier sa vie. Il lui semblait que "la nature en fête s'était parée comme une femme allant à la rencontre du bien-aimé". L'accueil fut froid et contenu de la part de la comtesse. Mais M. de Mortsauf découvrit en Félix un compagnon de jeu. Heureux d'apprendre qu'il connaissait le tric-trac, il l'invita à Clochegourde en lui demandant d'être son partenaire.
M. de Mortsauf était un homme vieilli avant l'âge, souffrant, aigri et d'un égoïsme féroce. Sa femme était réellement sa victime. Il lui avait donné deux enfants, Jacques et Madeleine, d'une santé chancelante, sur lesquels elle veillait avec la volonté de leur redonner une seconde fois la vie.
Une douce intimité devait fatalement se créer entre Félix et Henriette de Mortsauf: elle discrète, pure, irréprochable; lui n'ayant d'autre désir que d'être tout pour elle. Souvent, la nuit, il passait l'Indre dans la toue et il restait sous ses fenêtres au milieu du murmure des eaux filtrant à travers les vannes des moulins et entrecoupé par la voix des heures sonnées au clocher de Saché.
Un jour, Félix apprend que la maladie du comte s'est soudainement aggravée et a déterminé une véritable crise de démence. La comtesse se confie à Félix; elle accepte le rôle de femme à qui la souffrance appartient. Il lui demande une place dans son cœur : "Vous l'avez, dit-elle, n'êtes-vous pas mon enfant?" Et les semaines s'écoulent dans cet échange d'émotions toujours renouvelées, dans cette vie de l'âme au milieu d'une nature enchanteresse.
Enfin, on arrive à l'époque des vendanges qui sont de véritables fêtes en Touraine:
Vers la fin du mois de septembre, le soleil, moins chaud que durant la moisson, permet de demeurer aux champs sans avoir à craindre ni le hâle, ni la fatigue. Il est plus facile de cueillir les grappes que de scier les blés. Les fruits sont tous mûrs. La moisson est faite, le pain devient moins cher et cette abondance rend la vie heureuse. Enfin les craintes qu'inspirait le résultat des travaux champêtres, où s'enfouit autant d'argent que de sueurs, ont disparu devant la grange pleine et les celliers prêts à s'emplir.
Les vendanges sont alors comme le joyeux dessert du festin récolté, le ciel y sourit toujours en Touraine, où les automnes sont magnifiques. Dans ce pays hospitalier, les vendangeurs sont nourris au logis. Ces repas étant les seuls où ces pauvres gens aient chaque année des aliments substantiels et bien préparés, ils y tiennent comme dans les familles patriarcales les enfants tiennent aux galas des anniversaires. Aussi courent-ils en foule dans les maisons où les maîtres les traitent sans lésinerie. La maison est donc pleine de monde et de provisions. Les pressoirs sont constamment ouverts. Il semble que tout soit animé par ce mouvement d'ouvriers tonneliers, de charrettes chargées de filles rieuses, de gens qui, touchant des salaires meilleurs que pendant le reste de l'année, chantent à tout propos. D'ailleurs, autre cause de plaisir, les rangs sont confondus: femmes, enfants, maîtres et gens, tout le monde participe à la dive cueillette...
Ces diverses circonstances peuvent expliquer l'hilarité transmise d'âge en âge qui se développe en ces derniers beaux jours de l'année et dont le souvenir inspira jadis à Rabelais la forme bachique de son grand ouvrage.
Jamais les enfants, Jacques et Madeleine, n'avaient été en vendange. Félix était comme eux; ils eurent je ne sais quelle joie enfantine de voir leurs émotions partagées; leur mère avait promis de les y accompagner. On était allé à Villaines, où se fabriquent les paniers du pays. Il était question de vendanger à eux quatre quelques chaînées réservées à leurs ciseaux, mais il était convenu qu'on ne mangerait pas trop de raisin. Manger dans les vignes le gros "cot" de Touraine paraissait chose si délicieuse que l'on dédaignait les plus beaux raisins sur la table.
Jamais ces deux petits êtres ne furent plus frais, ni plus roses, ni aussi agissants et remuants que durant cette matinée. Ils babillaient pour babiller, allaient, trottaient, revenaient sans raison apparente; mais, comme les autres enfants, ils semblaient avoir trop de vie à secouer; M. et Mme de Mortsauf ne les avaient jamais vus ainsi. Félix redevint enfant avec eux, plus enfant qu' eux peut-être, car il espérait aussi sa récolte.
Ils allèrent par le plus beau temps vers les vignes et y restèrent une demi-journée, se disputant à qui trouverait les plus belles grappes, à qui remplirait plus vite son panier! C'étaient des allées et venues des ceps à la mère, il ne se cueillait pas une grappe qu'on ne la lui montrât. Elle se mit à rire du bon rire plein de sa jeunesse quand Félix, arrivant après sa fille avec son panier, lui dit comme Madeleine :
- Et les miens, maman ?
- Cher enfant, répondit-elle, ne t'échauffe pas trop !
Puis, lui passant la main tour à tour sur le cou et dans les cheveux, elle lui donna un petit coup sur la joue en ajoutant: - Tu es en nage !
Ce fut la seule fois qu'il entendit cette caresse de la voix, le tu des amants. Il regarda les jolies haies couvertes de fruits rouges, de sinelles et de mûrons. Il écouta les cris des enfants. Il contempla la troupe des vendangeuses, la charrette pleine de tonneaux et les hommes chargés de hottes ! ... Ah! il grava tout dans sa mémoire, tout, jusqu'au jeune amandier sous lequel elle se tenait, fraîche, colorée, rieuse sous son ombrelle dépliée.
Une autre fois, Félix propose une promenade sur l'Indre avec la comtesse et Madeleine. C'était une diversion voulue après une crise de colère de M. de Mortsauf.
Nous gagnons la toue, nous y sautons et nous voilà remontant l'Indre avec lenteur. Comme trois enfants amusés de riens, nous regardions les herbes des bords, les demoiselles bleues ou vertes. La comtesse s'étonnait de pouvoir goûter de si tranquilles plaisirs au milieu de ses poignants chagrins. Mais le calme de la nature, insouciante de nos luttes, n'exerce-t-il pas sur nous un charme consolateur? L'agitation d'un amour plein de désirs contenus s'harmonise avec celle de l'eau. Les fleurs expriment les rêves les plus secrets, le voluptueux balancement d'une barque imite vaguement les pensées qui flottent dans l'âme. Nous éprouvâmes l'engourdissante influence de cette poésie.
Pour vous peindre cette heure, non dans ses détails indescriptibles, mais dans son ensemble, je vous dirai que nous nous aimions en tous les êtres, en toutes les choses qui nous entouraient. Nous sentions hors de nous le bonheur que chacun de nous souhaitait. Il nous pénétrait si vivement que la comtesse ôta ses gants et laissa tomber ses belles mains dans l'eau, comme pour rafraîchir une secrète ardeur. Ses yeux parlaient, mais sa bouche, qui s'entr'ouvrait comme une rose à l'air, se serait fermée à un désir.

Félix de Vandenesse devait repartir de nouveau à Paris, où l'attendait une belle situation au cabinet du roi. Henriette de Mortsauf, malgré ses sentiments pour Félix, veut rester fidèle à ses devoirs d'épouse et de mère. Alors Félix quitte la Vallée par une triste journée d'automne:
Je m'en allai d'un pas lent en me retournant sans cesse. Quand, au sommet du plateau, je contemplai la vallée une dernière fois, je fus saisi du contraste qu'elle m'offrit en la comparant à ce qu'elle était quand j'y vins. Ne verdoyait-elle pas, ne flambait-elle pas alors comme flambaient, comme verdoyaient mes désirs et mes espérances? Initié maintenant aux sombres et mélancoliques mystères d'une famille, je trouvais en ce moment la vallée au ton de mes idées. En ce moment, les champs étaient dépouillés, les. feuilles des peupliers tombaient, et celles qui restaient avaient la couleur de la rouille. Les pampres étaient brûlés. La cime des bois offrait des teintes grasses de cette couleur tannée que jadis les rois adoptaient pour leur costume et qui cachait la pourpre du pouvoir sous le brun des chagrins. Toujours en harmonie avec mes pensées, la vallée où se mouraient les rayons jaunes d'un soleil tiède me présentait encore une vivante image de mon âme.
Quand Felix revint dans sa vallée, ce fut pour revoir une dernière fois Henriette mourante.
En ce moment, l'Angélus sonna au clocher du bourg. Les flots de l'air adouci jetèrent par ondées les tintements qui nous annonçaient qu'à cette heure la chrétienté tout entière répétait les paroles dites par l'ange à la femme qui racheta les fautes de son sexe. Ce soir, l'Ave Maria nous parut une salutation du ciel. La prophétie était si claire et l'événement si proche, que nous fondîmes en larmes. Les murmures du soir, brise mélodieuse dans le feuillage, les derniers gazouillements d'oiseaux, refrains et bourdonnements d'insectes, voix des eaux, cri plaintif de la rainette, toute la campagne disait adieu au plus beau lys de la vallée.
Le surlendemain, par une fraîche matinée d'automne, nous accompagnâmes la comtesse à sa dernière demeure. Nous descendîmes par le chemin que j'avais si joyeusement monté le jour où je la retrouvai. Nous traversions la vallée de l'Indre pour arriver au petit cimetière de Saché, pauvre cimetière de village situé au revers de l'église, sur la croupe d'une colline et où, par humilité chrétienne, elle voulut être enterrée avec une simple croix de, bois noir, comme une pauvre femme des champs. Au moment où le cortège quitta la chaussée des moulins, il y eut un gémissement unanime qui semblait faire croire que cette vallée pleurait son âme.
Dans le conte Les Deux Amis, Balzac se livre à une étude comparée des vins et de la qualité des viandes consommés dans la région de Tours. Et il y évoque deux petits châteaux, l'Alouette à Pont-de-Ruan et le Châtelet à Thilouze.
— Le manoir de l'Alouette, près de Pont-de-Ruan : "Un château mignon que l'on quitte à regret et qu'on voudrait emporter dans sa poche…" (Les Deux Amis)
— Le Châtelet à Thilouze : "A une demie lieue se trouvait un petit fief dont vous aurez l'idée en vous figurant un corps de logis à trois fenêtres sur monté dun toit énorme et terminé à chaque bout par un colombier…" (Les Deux Amis)
- 3 -
AUTRES LIEUX BALZACIENS
VENDÔME, LE COLLÈGE DES ORATORIENS

Le 22 juin 1807, le jeune Balzac fut inscrit chez les Oratoriens de Vendôme sous le numéro 460 avec les précisions suivantes: "Honoré Balzac, âgé de huit ans cinq mois; caractère sanguin s'échauffant facilement et sujet à quelques fièvres de chaleurs".
Il devait y rester six ans, retranché du monde, sans vacances. Son indiscipline faisait qu’il allait souvent au cachot. Trois endroits du collège pouvaient servir de cachot :
— les alcôves des dortoirs, cellules de six pieds carrés dont les cloisons de bois étaient garnies de barreaux par le haut et dont les portes étaient à claire-voie ; les élèves les appelaient les «culottes de bois»;
— la salle haute de la tourelle qui flanque l’hôtel du Saillant, dans le parc
— la loge qui était "sous l’escalier de la division des Minimes", c’est-à-dire en bas de cette même tourelle du Saillant.
Dans une lettre de 1808, il écrit :
Ma chère maman, Je pense que mon papa a été désolé que j’ai été à l’alcôve. Je te prie de le consoler en lui disant que j’ai eu un accessit*. Je n’oublie pas de me frotter les dents avec mon mouchoir. J’ai fait un chayer [cahier] où je recopie nettement, et j’ai des bons points, et c’est de cette manière que je compte te faire plaisir. Je t’embrasse de tout mon cœur et toute la famille. Voici les noms de ceux qui ont eu des prix et qui sont de Tours ; Boislecompte… Je ne me rappelle que de lui. Balzac Honoré, ton fils soumis et affectionné.
* Un accessit de discours latin, le seul qu’il ait eu dans les six années de sa scolarité à Vendôme.
Il sortit de Vendôme épuisé et il fallut le ramener à Tours sans attendre la fin de l’année scolaire.
On a conservé plusieurs documents sur son séjour : le registre des inscriptions où figure son nom, des appréciations précisant que, si ses résultats en mathématiques n'étaient pas brillants, on lui accordait toutefois un caractère doux et des dispositions heureuses.
Note : Dans la petite ville, Balzac put remarquer "un des plus beaux hôtels de Vendôme", au 5 rue Guesnault, dont la fenêtre de droite du premier étage est murée. Ce détail lui aurait donné l'idée de situer dans ce décor l'histoire d'amant emmuré de La Grande Bretèche.
Balzac a utilisé ses souvenirs du collège de Vendôme dans son roman Louis Lambert (dont le titre est emprunté au nom d'un de ses condisciples, Louis-Lambert Tinant).
Histoire du collège :
Avant la Révolution, l'Ordre des Oratoriens, voué, comme celui de Jésus, à l'éducation publique, et qui en eut la succession dans quelques maisons, possédait plusieurs établissements provinciaux, dont les plus célèbres étaient les collèges de Vendôme, de Tournon, de La Flèche, de Pont-le-Voy, de Sorrèze et de Juilly. Celui de Vendôme, aussi bien que les autres, élevait, je crois, un certain nombre de cadets destinés à servir dans l'armée. L'abolition des Corps enseignants, décrétée par la Convention, influa très peu sur l'Institution de Vendôme. La première crise passée, le collège recouvra ses bâtiments; quelques Oratoriens disséminés aux environs y revinrent, et le rétablirent en y conservant l'ancienne règle, les habitudes, les usages et les mœurs, qui donnaient à ce collège une physionomie à laquelle je n'ai rien pu comparer dans aucun des lycées où je suis allé après ma sortie de Vendôme. Nous avions pour Régents deux hommes auxquels nous donnions par tradition le nom de Pères, quoiqu'ils fussent séculiers. De mon temps, il n'existait plus à Vendôme que trois véritables Oratoriens auxquels ce titre appartînt légitimement; en 1814, ils quittèrent le collège, qui s'était insensiblement sécularisé, pour se réfugier auprès des autels dans quelques presbytères de campagne.
Une discipline conventuelle :
Situé au milieu de la ville, sur la petite rivière du Loir qui en baigne les bâtiments, le collège forme une vaste enceinte soigneusement close où sont enfermés les établissements nécessaires à une Institution de ce genre: une chapelle, un théâtre, une infirmerie, une boulangerie, des jardins, des cours d'eau. Ce collège, le plus célèbre foyer d’instruction que possèdent les provinces du centre, est alimenté par elles et par nos colonies. L'éloignement ne permet donc pas aux parents d'y venir souvent voir leurs enfants. La règle interdisait d'ailleurs les vacances externes. Une fois entrés, les élèves ne sortaient du collège qu'à la fin de leurs études. A l'exception des promenades faites extérieurement sous la conduite des Pères, tout avait été calculé pour donner à cette maison les avantages de la discipline conventuelle. De mon temps, le Correcteur était encore un vivant souvenir, et la classique férule de cuir y jouait avec honneur son terrible rôle. Les punitions jadis inventées par la Compagnie de Jésus, et qui avaient un caractère aussi effrayant pour le moral que pour le physique, étaient demeurées dans l'intégrité de l'ancien programme. Les lettres aux parents étaient obligatoires à certains jours, aussi bien que la confession. Ainsi nos péchés et nos sentiments se trouvaient en coupe réglée. Tout portait l'empreinte de l'uniforme monastique. Je me rappelle, entre autres vestiges de l'ancien Institut, l'inspection que nous subissions tous les dimanches. Nous étions en grande tenue, rangés comme des soldats, attendant les deux directeurs qui, suivis des fournisseurs et des maîtres, nous examinaient sous les triples rapports du costume, de l'hygiène et du moral. Les deux ou trois cents élèves que pouvait loger le collège étaient divisés, suivant l'ancienne coutume, en quatre sections, nommées les Minimes, les Petits, les Moyens et les Grands. La division des Minimes embrassait les classes désignées sous le nom de huitième et septième; celle des Petits, la sixième, la cinquième et la quatrième; celle des Moyens, la troisième et la seconde; enfin celle des Grands, la rhétorique, la philosophie, les mathématiques spéciales, la physique et la chimie. Chacun de ces collèges particuliers possédait son bâtiment, ses classes et sa cour dans un grand terrain commun sur lequel les salles d'études avaient leur sortie, et qui aboutissaient au réfectoire.
Le réfectoire :
Ce réfectoire, digne d'un ancien Ordre religieux, contenait tous les écoliers. Contrairement à la règle des autres corps enseignants, nous pouvions y parler en mangeant, tolérance oratorienne qui nous permettait de faire des échanges de plats selon nos goûts. Ce commerce gastronomique est constamment resté l'un des plus vifs plaisirs de notre vie collégiale. Si quelque Moyen, placé en tête de sa table, préférait une portion de pois rouges à son dessert, car nous avions du dessert, la proposition suivante passait de bouche en bouche: — Un dessert pour des pois ! jusqu'à ce qu'un gourmand l'eût accepté; alors celui-ci d'envoyer sa portion de pois, qui allait de main en main jusqu'au demandeur dont le dessert arrivait par la même voie. Jamais il n'y avait d'erreur. Si plusieurs demandes étaient semblables, chacune portait son numéro, et l'on disait: Premiers pois pour premier dessert. Les tables étaient longues, notre trafic perpétuel y mettait tout en mouvement; et nous parlions, nous mangions, nous agissions avec une vivacité sans exemple. Aussi le bavardage de trois cents jeunes gens, les allées et venues des domestiques occupés à changer les assiettes, à servir les plats, à donner le pain, l'inspection des directeurs faisaient-ils du réfectoire de Vendôme un spectacle unique en son genre, et qui étonnait toujours les visiteurs.
L’hygiène :
Il se trouvait dans nos salles d'étude des baraques où chacun mettait son butin, les pigeons tués pour les jours de fête, ou les mets dérobés au réfectoire. Enfin, nos salles contenaient encore une pierre immense où restaient en tout temps deux seaux pleins d'eau, espèce d'abreuvoir où nous allions chaque matin nous débarbouiller le visage et nous laver les mains à tour de rôle en présence du maître. De là, nous passions à une table où des femmes nous peignaient et nous poudraient. Nettoyé une seule fois par jour, avant notre réveil, notre local demeurait toujours malpropre. Puis, malgré le nombre des fenêtres et la hauteur de la porte, l'air y était incessamment vicié par les émanations du lavoir, par la peignerie, par la baraque, par les mille industries de chaque écolier, sans compter nos quatre-vingts corps entassés. Cette espèce d'humus collégial, mêlé sans cesse à la boue que nous rapportions des cours, formait un fumier d'une insupportable puanteur.
Les châtiments corporels :
Excepté les grandes malices pour lesquelles il existait d'autres châtiments, la férule était, à Vendôme, l'ultima ratio Patrum. Aux devoirs oubliés, aux leçons mal sues, aux incartades vulgaires, le pensum suffisait; mais l'amour-propre offensé parlait chez le maître par sa férule. Parmi les souffrances physiques auxquelles nous étions soumis, la plus vive était certes celle que nous causait cette palette de cuir, épaisse d'environ deux doigts, appliquée sur nos faibles mains de toute la force, de toute la colère du Régent. Pour recevoir cette correction classique, le coupable se mettait à genoux au milieu de la salle. Il fallait se lever de son banc, aller s'agenouiller près de la chaire, et subir les regards curieux, souvent moqueurs de nos camarades. Aux âmes tendres, ces préparatifs étaient donc un double supplice, semblable au trajet du Palais à la Grève que faisait jadis un condamné vers son échafaud. Selon les caractères, les uns criaient en pleurant à chaudes larmes, avant ou après la férule; les autres en acceptaient la douleur d'un air stoïque; mais, en l'attendant, les plus forts pouvaient à peine réprimer la convulsion de leur visage.
La prison :
En prison, plus libres que partout ailleurs, nous pouvions parler pendant des journées entières, dans le silence des dortoirs où chaque élève possédait une niche de six pieds carrés, dont les cloisons étaient garnies de barreaux par le haut, dont la porte à claire-voie se fermait tous les soirs, et s'ouvrait tous les matins sous les yeux du Père chargé d'assister à notre lever et à notre coucher. Le cric-crac de ces portes, manœuvrées avec une singulière promptitude par les garçons de dortoir, était encore une des particularités de ce collège. Ces alcôves ainsi bâties nous servaient de prison, et nous y restions quelquefois enfermés pendant des mois entiers. Les écoliers mis en cage tombaient sous l'œil sévère du préfet, espèce de censeur qui venait, à ses heures ou à l'improviste, d'un pas léger, pour savoir si nous causions au lieu de faire nos pensums. Mais les coquilles de noix semées dans les escaliers, ou la délicatesse de notre ouïe nous permettaient presque toujours de prévoir son arrivée, et nous pouvions nous livrer sans trouble à nos études chéries.
Souffrances des élèves :
Petits et Minimes, étaient dévorés d'engelures et de crevasses si douloureuses que ces maux nécessitaient pendant le déjeuner un pansement particulier, mais très imparfait à cause du grand nombre de mains, de pieds, de talons endoloris. Beaucoup d'enfants étaient d'ailleurs obligés de préférer le mal au remède: ne leur fallait-il pas souvent choisir entre leurs devoirs à terminer, les plaisirs de la glissoire, et le lever d'un appareil insouciamment mis, plus insouciamment gardé? Puis les mœurs du collège avaient amené la mode de se moquer des pauvres chétifs qui allaient au pansement, et c'était à qui ferait sauter les guenilles que l'infirmière leur avait mises aux mains. Donc, en hiver, plusieurs d'entre nous, les doigts et les pieds demi-morts, tout rongés de douleurs, étaient peu disposés à travailler parce qu'ils souffraient, et punis parce qu'ils ne travaillaient point. Trop souvent la dupe de nos maladies postiches, le Père ne tenait aucun compte des maux réels. Moyennant le prix de la pension, les élèves étaient entretenus aux frais du collège. L'administration avait coutume de passer un marché pour la chaussure et l'habillement ; de là cette inspection hebdomadaire de laquelle j'ai déjà parlé. Excellent pour l'administrateur, ce mode a toujours de tristes résultats pour l'administré. Malheur au Petit qui contractait la mauvaise habitude d'éculer, de déchirer ses souliers, ou d'user prématurément leurs semelles, soit par un vice de marche, soit en les déchiquetant pendant les heures d'étude pour obéir au besoin d'action qu'éprouvent les enfants. Durant tout l'hiver, celui-là n'allait pas en promenade sans de vives souffrances: d'abord la douleur de ses engelures se réveillait atroce autant qu'un accès de goutte; puis les agrafes et les ficelles destinées à retenir le soulier partaient, ou les talons éculés empêchaient la maudite chaussure d'adhérer aux pieds de l'enfant; il était alors forcé de la traîner péniblement en des chemins glacés où parfois il lui fallait la disputer aux terres argileuses du Vendômois ; enfin l'eau, la neige y entraient souvent par une décousure inaperçue, par un béquet mal mis, et le pied de se gonfler. Sur soixante enfants, il ne s'en rencontrait pas dix qui cheminassent sans quelque torture particulière.
Plaisirs des élèves :
Pour adoucir notre vie, privée de toute communication avec le dehors et sevrée des caresses de la famille, les Pères nous permettaient encore d'avoir des pigeons et des jardins. Nos deux ou trois cents cabanes, un millier de pigeons nichés autour de notre mur d'enceinte et une trentaine de jardins formaient un coup d'œil encore plus curieux que ne l'était celui de nos repas. Mais il serait trop fastidieux de raconter les particularités qui font du collège de Vendôme un établissement à part, et fertile en souvenirs pour ceux dont l'enfances s’y est écoulée. Qui de nous ne se rappelle encore avec délices, malgré les amertumes de la science, les bizarreries de cette vie claustrale? C'était les friandises achetées en fraude durant nos promenades, la permission de jouer aux cartes et celle d'établir des représentations théâtrales pendant les vacances, maraude et libertés nécessitées par notre solitude; puis encore notre musique militaire, dernier vestige des Cadets; notre académie, notre chapelain, nos Pères professeurs; enfin, les jeux particuliers défendus ou permis: la cavalerie de nos échasses, les longues glissoires, faites en hiver, le tapage de nos galoches gauloises, et surtout le commerce introduit par la boutique établie dans l'intérieur de nos cours. Cette boutique était tenue par une espèce de maître Jacques auquel grands et petits pouvaient demander, suivant le prospectus : boîtes, échasses, outils, pigeons cravatés, pattus, livres de messe (article rarement vendu), canifs, papiers, plumes, crayons, encre de toutes les couleurs, balles, billes; enfin le monde entier des fascinantes fantaisies de l'enfance, et qui comprenait tout, depuis la sauce des pigeons que nous avions à tuer jusqu'aux poteries où nous conservions le riz de notre souper pour le déjeuner du lendemain. Qui de nous est assez malheureux pour avoir oublié ses battements de cœur à l'aspect de ce magasin périodiquement ouvert pendant les récréations du dimanche, et où nous allions à tour de rôle dépenser la somme qui nous était attribuée; mais où la modicité de la pension accordée par nos parents à nos menus plaisirs nous obligeait de faire un choix entre tous les objets qui exerçaient de si vives séductions sur nos âmes?
Promenades du jeudi :
Selon la jurisprudence des collèges, le dimanche et le jeudi étaient nos jours de congé ; mais les offices, auxquels nous assistions très exactement, employaient si bien le dimanche que nous considérions le jeudi comme notre seul jour de fête. La messe une fois entendue, nous avions assez de loisir pour rester longtemps en promenade dans les campagnes situées aux environs de Vendôme. Le manoir de Rochambeau était l'objet de la plus célèbre de nos excursions, peut-être à cause de son éloignement. Rarement les petits faisaient une course si fatigante; néanmoins, une fois ou deux par an, les Régents leur proposaient la partie de Rochambeau comme une récompense. En 1812, vers la fin du printemps, nous dûmes y aller pour la première fois. Le désir de voir le fameux château de Rochambeau, dont le propriétaire donnait quelquefois du laitage aux élèves, nous rendit tous sages. Rien n'empêcha donc la partie. Ni moi ni Lambert, nous ne connaissions la jolie vallée du Loir où cette habitation a été construite. Aussi son imagination et la mienne furent-elles très préoccupées la veille de cette promenade, qui causait dans le collège une joie traditionnelle. Nous en parlâmes pendant toute la soirée, en nous promettant d'employer en fruits ou en laitage l'argent que nous possédions contrairement aux lois vendômoises. Le lendemain, après le dîner, nous partîmes à midi et demi tous munis d'un cubique morceau de pain que l'on nous distribuait d'avance pour notre goûter, Puis, alertes comme des hirondelles, nous marchâmes en troupe vers le célèbre castel, avec une ardeur qui ne nous permettait pas de sentir tout d'abord la fatigue. Quand nous étions arrivés sur la colline, nous pouvions contempler et le château assis à mi-côte et la vallée tortueuse où brille la rivière en serpentant dans une prairie gracieusement échancrée, admirable paysage, un de ceux auxquels les vives sensations du jeune âge, ou celles de l'amour, ont imprimé tant de charmes, que plus tard il ne faut jamais les aller revoir.
Lectures en cachette :
J'étais alors moi-même passionné pour la lecture. Grâce à l'envie que mon père avait de me voir à l’École Polytechnique, il payait pour moi des leçons particulières de mathématiques. Mon répétiteur, bibliothécaire du collège, me laissait prendre des livres sans trop regarder ceux que j'emportais de la bibliothèque, lieu tranquille où, pendant les récréations, il me faisait venir pour me donner ses leçons. Je crois qu'il était ou peu habile ou fort occupé de quelque grave entreprise, car il me permettait très volontiers de lire pendant le temps des répétitions, et travaillait je ne sais à quoi. Donc, en vertu d'un pacte tacitement convenu entre nous deux, je ne me plaignais point de ne rien apprendre, et lui se taisait sur mes emprunts de livres. Entraîné par cette intempestive passion, je négligeais mes études ; je devins l'écolier le moins agissant, le plus paresseux, le plus contemplatif de la Division des Petits, et partant le plus souvent puni.
Les Académiciens de Vendôme :
Aux académiciens étaient octroyés de brillants privilèges; ils dînaient souvent à la table du Directeur, et tenaient par an deux séances littéraires auxquelles nous assistions pour entendre leurs œuvres. Un académicien était un petit grand homme. Si chaque Vendômien veut être franc, il avouera que, plus tard, un véritable académicien de la véritable Académie française lui a paru bien moins étonnant que ne l'était l'enfant gigantesque illustré par la croix et par le prestigieux ruban rouge, insignes de notre académie. Il était bien difficile d'appartenir à ce corps glorieux avant d'être parvenu en seconde, car les académiciens devaient tenir tous les jeudis, pendant les vacances, des séances publiques, et nous dire des contes en vers ou en prose, des épîtres, des traités, des tragédies, des comédies, compositions interdites à l'intelligence des classes secondaires. J'ai longtemps gardé le souvenir d'un conte, intitulé 1'Ane vert, qui, je crois, est l'œuvre la plus saillante de cette académie inconnue.
GREZ-SUR-LOING, LA BOULEAUNIÈRE
La propriété de la Bouleaunière (à Grez-sur-Loing, au nord de Nemours) appartenait à la famille de Berny. Mme de Berny, la "Dilecta" de Balzac, y résida de 1829 jusqu'à sa mort en 1836. Elle a été reconstruite sous le Second Empire. Le romancier y vint souvent pour se reposer, et surtout pour y travailler à l'abri de ses éditeurs et de ses créanciers.

C'est en 1822 que le jeune Balzac avait fait la connaissance de Mme de Berny. Celle-ci avait une maison dans le village de Villeparisis, en Seine-et-Marne, où s'était installée la famille Balzac. Elle habitait avec ses filles au bout du village, d'où le nom qu'on leur donnait : "les dames du bout". Balzac sut bientôt qu'elle s'appelait Laure, qu'elle était la fille d'un harpiste d'origine allemande et d'une femme de chambre de Marie-Antoinette, qu'elle avait eu Louis XVI pour parrain et la reine pour marraine (et qu'elle s'appelait pour cette raison Louise-Antoinette-Laure Hinner). A seize ans, elle avait été mariée au comte de Berny, qui lui fit neuf enfants. Mais le ménage n'était pas heureux: le mari était un homme acariâtre qui n'avait jamais pardonné à sa femme une liaison qu'elle avait eue entre 1800 et 1805 avec un Corse, et une autre avec son beau-frère.

C'est sous le prétexte de donner des leçons aux enfants que Balzac commença à fréquenter la maison de la "dame du bout". Il avait alors 22 ans; Mme de Berny en avait 45 et s'avouait grand-mère. Pourtant Balzac fut très vite fasciné par cette filleule de la reine, qui lui racontait les intrigues de l'ancienne Cour. Et Mme de Berny sentait sa curiosoté s'éveiller pour ce jeune homme qu'elle pressentait peu ordinaire.
Au printemps de 1822, Balzac va risquer une déclaration enflammée: Laure de Berny le repousse en souriant et s'abrite derrière ses enfants. Balzac insiste, essaie de chasser ses scrupules. Il lui écrit: "Nous mourons tout entiers... Il n'y a ni vices, ni vertus, ni enfer, ni paradis; la seule chose qui doive nous diriger, c'est cet axiome: prends le plus de plaisir que tu pourras... Vous m'estimez bien peu en pensant qu'en vous donnant à moi vous seriez avilie, tandis que, dans mon idée, je crois que nous en serions honorés l'un et l'autre."
Mme de Berny se laissa facilement convaincre. Un soir, sur un banc du jardin de Villeparisis, elle permit un premier baiser. Peu de temps après, ce sera le don total et la découverte de la volupté par le jeune homme sans expérience et par l'épouse insatisfaite.
Très vite, cette liaison est connue de tous. Les filles de Mme de Berny (l'aînée a 25 ans, la plus jeune 9 ans) se font méprisantes. La mère d'Honoré s'inquiète, mais tout en restant liée avec sa voisine qui s'est faite ainsi l'éducatrice de son fils.
Les deux amants, bientôt, cherchèrent à se voir plus librement en allant s'installer à Paris, logeant tout près l'un de l'autre et se voyant tous les jours. Et Mme de Berny, qui est devenue la Dilecta, lui apportera tout: le plaisir, l'affection, les conseils, sa connaissance du monde... et aussi de l'argent pour financer certaines entreprises hasardeuses sur lesquelles Honoré comptait pour faire sa fortune.
C'est que Mme de Berny est de plus en plus amoureuse. On le voit par quelques formules glanées çà et là dans sa correspondance : "Tu es pour moi plus que l'air pour l'oiseau, plus que l'eau pour le poisson, plus que le soleil pour la terre, plus que la nature pour l'âme... Tes dons sont immenses, mais ta gentille sait tous les sentir, les saisir...". Ou bien : "Bonsoir Minet cher… chéri adoré, reçois ta Minette sur tes genoux, laisse-lui passer son bras derrière ton cou, penche ta tête chérie sur son épaule. Ne t'y endors pas, ah ! non et, pour que cette fantaisie ne te prenne pas, je te donne un de ces baisers que nous connaissons si bien."
Bientôt, pourtant, Mme de Berny doit convenir que son "Minet chéri" rue dans les brancards de la fidélité et elle apprend qu'il est devenu à son insu l'amant de la duchesse d'Abrantes. Elle veut l'obliger à rompre, mais elle devra en fait se résigner à partager avec une rivale.
André Maurois analyse avec finesse les sentiments de Balzac à cette époque de leur liaison : "Son amour pour Laure de Berny, c'est un mélange de sensualité et de sentiment, instable quant à la sensualité, fidèle quant au sentiment. Au-delà de ce bel amour terrestre, Balzac essaie de concevoir un angélisme pur, la femme qui, sans exiger les caresses, se ferait sublime sœur de charité pour veiller sur le génie. Mais la femme, elle non plus, n'est ni ange ni bête. Le corps, chez elle aussi, exige sa part et l'admirable dévouement de la "Dilecta" ne peut étouffer ni l'antagonisme, inhérent à la nature humaine, entre l'amour charnel et l'amour spirituel, ni celui, propre à l'artiste créateur, entre la femme et l'œuvre. Toute femme qui aime un artiste se condamne, tôt ou tard, à la souffrance."
Mme de Berny va désormais aider son "génie" de toutes ses forces, l'aidant à développer son grand projet romanesque, corrigeant des masses d'épreuves. En mai-juin 1830, elle a sa récompense: Balzac l'emmène avec lui en voyage jusqu'en Bretagne, puis il la présente à sa chère Touraine, avant d'aller passer quelque temps avec elle à Tours, à la Grenadière.
C'est en 1829, donc peu avant ce voyage, que Mme de Berny s'est installée dans la propriété de la Bouleaunière, qui appartenait à sa famille. Désormais, Balzac viendra s'y réfugier souvent pour y trouver le calme et pour y travailler à ses romans. On l'y verra en 1829, en avril 1831 (alors qu'il travaille à sa Peau de Chagrin). En 1832, il ira d'abord travailler à Saché, chez M. de Margonne, puis à Angoulême, chez Zulma Carraud, avant de venir passer trois semaines à la Bouleaunière. Mme de Berny a alors 55 ans. Séparée de son mari, déchirée entre ses enfants, elle se raccroche à son amant dont elle est de plus en plus amoureuse, comme le montrent quelques phrases prises dans la correspondance de cette époque : "Je m'enfouis dans ton cœur comme sur ton gentil corps quand...tu sais...". Ou bien: "Je te fais toutes nos caresses accoutumées, je te baise partout. Je suis toute à toi, toute ton Eve". Ou encore : "Oh! mon Didi à moi! mon chéri! mon adoré maître! viens donc encore recevoir le tribut d'une volupté créée par toi, les caresses d'une chérie façonnée à ton usage."
Parfois Balzac, ce "galérien de plume et d'encre" comme il se désigne lui-même, s'agace du temps que ces amours envahissantes de la Dilecta lui font perdre. Pour s'en libérer un peu, il songe même à se marier. Mais surtout, il a un jour la lucidité cruelle d'écrire que Mme de Berny a perdu toute "beauté sensuelle" et il éprouve le besoin d'aller essayer ailleurs son pouvoir de séduction. Mais Zulma Carraud lui résiste et la marquise de Castries, au cours d'un voyage en Suisse, se refuse à lui. Seule la discrète Maria du Fresnay est accueillante au grand homme: il lui fera un enfant et lui dédiera Eugénie Grandet.
C'est alors qu'entra dans sa vie l'Etrangère, Mme Hanska. Mais celle-ci est jalouse de la Dilecta, et Balzac doit tourner des phrases propres à la convaincre, du style de celle-ci: "Tu seras la Dilecta jeune... Ne murmure pas de cette alliance de deux sentiments. Je voudrais croire que je t'aimais en elle..." (comme le dit André Maurois, qui cite ces phrases un peu contournées, "la casuistique sentimentale a des ressources infinies").
Ce nouvel amour le fit beaucoup voyager: Neuchâtel, Genève, Vienne. Chaque fois qu'il revient à Paris, il vient à la Bouleaunière, où il trouve une Mme de Berny de plus en plus marquée par la maladie. Au début de 1835, il écrit: "Elle a soixante ans. Ses chagrins l'ont changée, flétrie. Mon affection a redoublé. Je le dis sans orgueil, parce que je ne trouve nul mérite à ceci. C'est ma nature, que Dieu a faite oublieuse du mal, sans cesse en présence du bienfait. Un être qui m'aime me fait toujours tressaillir."
Le dernier cadeau que lui fera Balzac, ce sera Le Lys dans la Vallée, un ouvrage tout plein de ses sentiments pour la Dilecta. Quand elle lut ce roman, elle considéra qu'avec lui un sommet avait été atteint: "Je puis mourir, dit-elle. Je suis sûre que vous avez sur le front la couronne que je voulais y voir. Le Lys est un sublime ouvrage, sans tache ni faute."
Alors, curieusement, elle demanda à Balzac de ne plus venir à la Bouleaunière. Sa maladie progressait, aggravée par la douleur de la mort de son fils Armand. Elle ne voulait plus que Balzac vît son corps et son visage ravagés...
Balzac, certes, se désespérait; mais cela ne l'empêchait pas de poursuivre ses aventures amoureuses, de faire un enfant à la comtesse Guidoboni-Visconti, de voyager à Turin avec Mme Marbouty travestie en garçon...
C'est au retour de ce voyage que Balzac apprit que Mme de Berny venait de mourir à la Bouleaunière, le 27 juillet 1836, n'ayant pas tout à fait atteint cet âge de 60 ans qu'elle redoutait.
Balzac apprit qu'au moment suprême elle avait souhaité le voir et qu'elle avait envoyé son fils Alexandre à sa recherche. Elle aurait dit à son médecin : "Je veux vivre jusqu'à demain" et, en attendant son amant, elle aurait arrangé elle-même ses cheveux. Quand elle sut que Balzac était en Italie, elle fit venir le curé de Gretz, l'abbé Grasset, elle demanda à son fils de brûler toutes les lettres qu'elle avait conservées et elle se laissa mourir. Près de son chevet, on trouva un livre, Le Lys dans la Vallée, dont elle avait relu les pages ultimes qui faisaient mourir Mme de Mortsauf de la mort qui était maintenant la sienne. Et, dans bien des pages, elle lisait clairement l'hommage que son amant fidèle et infidèle à la fois avait voulu lui rendre :
"Elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus aimée; elle ne fut pas dans mon cœur comme une femme qui veut une place, qui s'y grave par le dévouement ou par l'excès du plaisir; non, elle eut tout le cœur, et devint ce qu'était la Béatrix du poète florentin, la Laure sans tache du poète vénitien, la mère des grandes pensées, la cause inconnue des résolutions qui sauvent, le soutien de l'avenir, la lumière qui brille dans l'obscurité comme le lys dans les feuillages sombres... Elle m'a donné cette constance à la Coligny pour vaincre les vainqueurs, pour renaître de la défaite, pour lasser les plus forts lutteurs... La plupart de mes idées sont nées là, comme les parfums émanent des fleurs..."
Un autre texte d'hommage :
"La personne que j'ai perdue était plus qu'une mère, plus que toute autre créature peut être pour une autre. Elle ne s'explique que par la divinité. Elle m'avait soutenu de parole, d'action, de dévouement, pendant les grands orages. Si je vis, c'est par elle, elle était tout pour moi ; quoique, depuis deux ans, la maladie, le temps nous eussent séparés, nous étions visibles à distance l'un pour l'autre ; elle réagissait sur moi, elle était un soleil moral. Mme de Mortsauf, du Lys, est une pâle expression des moindres qualités de cette personne ; il y a un lointain reflet d'elle, car j'ai horreur de prostituer mes propres émotions au public et jamais rien de ce qui m'arrive ne sera connu. Eh bien, au milieu des nouveaux revers qui m'accablaient, la mort de cette femme est venue…"
Depuis que Mme de Berny s'était installée à la Bouleaunière, Balzac avait donc fait souvent le voyage de Paris à Nemours. La connaissance qu'il avait acquise de ce coin du Gâtinais, il devait l'utiliser cinq ans plus tard dans son roman Ursule Mirouet, dont Alain a dit qu'il était "un roman de plein air". Balzac y évoque les différents visages de la petite ville de Nemours, telle qu'on la voit en venant de la Bourgogne, du Gâtinais ou, enfin, de Paris :
En traversant la France, où l'œil est si promptement lassé par la monotonie des plaines, qui n'a pas eu la charmante sensation d'apercevoir en haut d'une côte, à sa descente ou à son tournant, alors qu'elle promettait un paysage aride, une fraîche vallée arrosée par une rivière et une petite ville abritée sous le rocher comme une ruche dans le creux d'un vieux saule ? En entendant le hue ! du postillon qui marche le long de ses chevaux, on secoue le sommeil, on admire comme un rêve dans le rêve quelque beau paysage qui devient pour le voyageur ce qu'est pour un lecteur le passage remarquable d'un livre, une brillante pensée de la nature. Telle est la sensation que cause la vue soudaine de Nemours en y venant de la Bourgogne. On la voit de là cerclée par des roches pelées, grises, blanches, noires, de formes bizarres, comme il s'en trouve tant dans la forêt de Fontainebelau, et d'où s'élancent des arbres épars qui se détachent nettement sur le ciel et donnent à cette espèce de muraille écroulée une physionomie agreste. Là se termine la longue colline forestière qui rampe de Nemours à Bouron en côtoyant la route. Au bas de ce cirque informe s'étale une prairie où court le Loing en formant des nappes à cascades. Ce délicieux paysage, que longe la route de Montargis, ressemble à une décoration d'opéra, tant les effets y sont étudiés. […]
En entrant à Nemours du côté de Paris, on passe sur le canal du Loing, dont les berges forment à la fois de champêtres remparts et de pittoresques promenades à cette jolie petite ville. Depuis 1830, on a malheureusement bâti plusieurs maisons en deçà du pont. Si cette espèce de faubourg s'augmente, la physionomie de la ville y perdra sa gracieuse originalité. […]
Du côté du Gâtinais. Nemours est dominé par une colline le long de laquelle s'étendent la route de Montargis et le Loing. L'église, sur les pierres de laquelle le temps a jeté son riche manteau noir - car elle a sans doute été rebâtie au XIVe siècle par les Guise, pour lesquels Nemours fut érigé en duché-pairie - se dresse au bout de la petite ville, au bas d'une grande arche qui l'encadre. Pour les monuments comme pour les hommes, la position fait tout. Ombragée par quelques arbres, et mise en relief par une place proprette, cette église solitaire produit un effet grandiose. […]
Le Loing traverse onduleusement la ville, bordé de jardins à terrasses et de maisons proprettes dont l'aspect fait croire que le bonheur doit habiter là plutôt qu'ailleurs. […]
Qui connaît Nemours sait que la nature y est aussi belle que l'art, dont la mission est de la spiritualiser; là le paysage a des idées et fait penser.
À la fin de la deuxième partie de Splendeurs et misères des Courtisanes, Lucien de Rubempré va attendre la voiture de Clotilde de Grandlieu à Bouron. Ayant pris un passeport pour Fontainebleau, il a passé la nuit "dans la dernière auberge du côté de Nemours" et, vers six heures du matin, "il s'en alla seul, à pied, dans la forêt où il marcha jusqu'à Bouron", où il s'assit sur un rocher dominant la petite cité. Quand la voiture arriva dans la descente de Bouron, elle s'arrêta. Clotilde descendit et marcha avec Lucien jusqu'au petit village de Grez. C'est sur cette route, tout près de la Bouleaunière, que Clotilde jura à Lucien qu'elle n'épouserait que lui…
SAUMUR DANS EUGÉNIE GRANDET
C'est M. de Margonne qui avait mis Balzac sur la piste de Nivelleau. Ce Jean Nivelleau était, disait-on, un ancien tonnelier de Saumur qui s'était enrichi en se lançant dans le négoce. Il avait acheté le château de Velors dans le Véron, puis la tour de Ninive à Saint-Hilaire-Saint-Florent, enfin le magnifique et somptueux château de Montreuil-Bellay, et cela l'avait amené à marier sa fille avec le fils du baron Milin de Grandmaison. Sa maison de Saumur n'existe plus: elle se trouvait dans la rue du Petit-Maure, sur l'emplacement de laquelle a été construit le marché couvert.
Le modèle du Père Grandet pouvait être surtout M. Savary, propriétaire viticulteur à Vouvray et beau-père de M. de Margonne... Savary avait 70 ans quand Balzac séjourna chez lui en 1833: c'est l'âge du père Grandet au début du roman. Mais le roman emprunte bien des traits à des Tourangeaux enrichis, à M. de Margonne lui-même; et Mme Grandet ressemble par bien des points à Mme de Margonne…
Le domaine de Noyers, c'est l'abbaye de Noyers, près de Sainte-Maure-de-Touraine, achetée comme bien national par les Sonolet, relation des Balzac. Froidfond, orgueil du père Grandet, c'est évidemment Saché avec son parc, son château, ses fermes, sa rivière et son étang.
A Saumur, si l'on cherche la maison du père Grandet, il faut partir de la place de l'église Saint-Pierre et prendre la montée du Fort qui va au château. On voit sur la gauche, au n°7, une vieille maison surmontée d'une tourelle à poivrière et dont la porte se trouve "placée dans un renfoncement assez sombre". Nul autre logis ne pouvait mieux convenir pour abriter Grandet et Nanon, Mme Grandet et Eugénie.
wiki-LlannWé2
Il se trouve dans certaines provinces des maisons dont la vie inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres. La vie et le mouvement y sont si tranquilles, qu'un étranger les croirait inhabitées s'il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d'une personne immobile dont la figure à demi monastique dépasse l'appui de la croisée au bruit d'un pas inconnu.
Ces principes de mélancolie existent dans la physionomie d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, par le haut de la ville. Cette rue, maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques endroits, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux toujours propre et sec, par l'étroitesse de sa voie tortueuse, par la paix de ses maisons qui appartiennent à la vieille ville et que dominent les remparts. Des habitations trois fois séculaires y sont encore solides, quoique construites en bois, et leurs divers aspects contribuent à l'originalité qui recommande cette partie de Saumur à l'attention des antiquaires et des artistes. […]
Dans cette rue, les rez-de-chaussée commerçants ne sont ni des boutiques, ni des magasins; les amis du moyen âge y retrouveraient l'ouvrouère de nos pères en toute sa naïve simplicité. […]
Dans ce pays, comme en Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie commerciale. Vignerons, propriétaires, marchands de bois, tonneliers, aubergistes, mariniers, sont tous à l'affût d'un rayon de soleil; ils tremblent en se couchant le soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a gelé pendant la nuit; ils redoutent la pluie, le vent, la sécheresse, et veulent de l'eau, du chaud, des nuages, à leur fantaisie. Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts terrestres. Le baromètre attriste, déride, égaie tour à tour Ies physionomies. D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne Grand'Rue de Saumur, ces mots: «Voilà un temps d'or!» se chiffrent de porte en porte. Aussi chacun répond-il au voisin: «Il pleut des louis!» en sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune lui apportent. […]
Les anciens hôtels de la vieille ville sont situés en haut de cette rue jadis habitée par les gentilshommes du pays. La maison pleine de mélancolie où se sont accomplis les événements de cette histoire était précisément un de ces logis, restes vénérables d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour.
Après avoir suivi les détours de ce chemin pittoresque dont les moindres accidents réveillent des souvenirs et dont l'effet général tend à plonger dans une sorte de rêverie machinale, vous apercevez un renfoncement assez sombre, au centre duquel est cachée la porte de la maison à M. Grandet. » […]
II est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot: la maison à M. Grandet, cette maison pâle, froide, silencieuse, abritée par les ruines des remparts. […] La porte en chêne massif, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par un système de six boulons qui figuraient des dessins symétriques. Une grille carrée, petite, mais à barreaux serrés et rouges de rouille, occupait le milieu de la porte bâtarde et servait, pour ainsi dire, de motif à un marteau qui s'y rattachait par un anneau et frappait sur la tête grimaçante d'un maître clou. […] Par la petite grille destinée à reconnaître les amis, au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. […]
Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissent l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper deux fois l'an les cheveux de M. Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier. Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchéiée. Des panneaux gris à moulures antiques la boisaient de haut en bas. Son plafond se composait de poutres apparentes également peintes en gris. […]
Dans cette salle va se passer le drame central du roman, entre le père qui défend son or et la fille qui défend son amour. Eugénie, innocente et pure, ignorait tout de la vie. Un jour, dans la vieille demeure, l'amour surgit devant elle sous l'apparence de son cousin Charles Grandet. Ce dernier est sans ressources et Eugénie fait cette chose inouïe d'offrir à son cousin toutes les pièces d'or que son père lui avait données. Alors le Père Grandet va séquestrer sa fille. Sans en connaître les raisons, la petite ville provinciale saura qu'Eugénie est enfermée puisqu'on ne la verra plus sortir que le dimanche.
La ville entière mit Grandet pour ainsi dire hors la loi, se souvint de ses trahisons, de ses duretés, et l'excommunia. Quand il passait, chacun se le montrait en chuchotant. Lorsque sa fille descendait la rue tortueuse pour aller à la messe ou à vêpres, accompagnée de Nanon, tous les habitants se mettaient aux fenêtres pour examiner avec curiosité la contenance de la riche héritière et son visage où se peignaient une mélancolie et une douceur angéliques. Sa réclusion, la disgrâce de son père, n'étaient rien pour elle. Ne voyait-elle pas la mappemonde, le petit banc, le jardin, le pan de mur, et ne reprenait-elle pas sur ses lèvres le miel qu'y avaient laissé les baisers de l'amour ?
SÈVRES, LES JARDIES
Au début de juillet 1837, Balzac, harcelé par ses créanciers, s'était réfugié chez la comtesse Guidoboni Visconti. Un garde du commerce l'y ayant découvert, la comtesse paya, pour éviter à !'écrivain la prison de Clichy. Menacé en outre d'être enrôlé dans la garde nationale parisienne, il lui fallait quitter le département de la Seine.
En septembre 1837, les Guidoboni Visconti lui donnèrent les 4500 francs qui lui permirent d'acheter la maison d'un tisserand à Sèvres en Seine-et-Oise, au lieu-dit "les Jardies" (actuellement 14 rue Gambetta). Puis il agrandit le terrain par l'achat d'autres pièces de terre et d'une petite maison et, oubliant sa situation financière, il entreprit de faire construire, au milieu de son jardin, une nouvelle demeure.
Ce fut une sorte de chalet suisse haut et étroit, auquel Balzac n'avait voulu d'autre escalier qu'une sorte d'échelle extérieure. Son ami Gozlan raconta que Balzac le fit aini monter dans les combles "pour respirer à pleins poumons la campagne, les bois, l'horizon, la rivière et l'immensité, ascension que nous exécutions d'ordinaire quand Balzac, dans un accès de mauvaise humeur, avait dit Venez! Allons cracher sur Paris!" Il rêva pour cette maison d'une décoration d'un faste prodigieux, et il écrivit au charbon sur les murs : "Revêtement en marbre de Paros, stylobate en bois de cèdre, plafond peint par Eugène Delacroix, tapisserie d'Aubusson, cheminée en marbre cipolin, portes façon de Trianon, parquet en mosaïque formé de tous les bois rares des îles..."
C'est vers la mi-juillet 1838, à son retour d'Italie, que Balzac s'y installa. Le 6 août il écrivit à Zulma Carraud :
M de Balzac, aux ]ardies, par Sèvres (S.-et-O.) Voilà mon adresse pour bien longtemps, trois fois chère, car ma maison est presque achevée, et j'y demeure. Trois chambres au-dessus l'une de l'autre : le rez-de-chaussée faisant salon, le premier chambre à coucher et le second mon cabinet de travail; ce tout, mis en communication par une échelle à laquelle on donne le nom d'escalier, compose l'habitation de votre ami. Tout autour, une allée qui serpente, dans un petit arpent de Paris, et entourée de murs, mais où l'on ne plantera des fleurs, des arbres et des arbustes qu'au mois de novembre prochain. Puis, à soixante pieds de là, un corps de logis où sont les écuries, remises, cuisines, etc., un grand appartement et des chambres de domestiques; voilà les ]ardies. La bâton de perroquet sur lequel je suis perché, le jardinet, le bâtiment des communs, le tout est situé au milieu de la vallée de Ville-d'Avray, mais sur la commune de Sèvres, côte à côte avec l'embarcadère du chemin de fer de Versailles, sur le revers du parc de Saint-Cloud, à mi-côte, au midi, la plus belle vue du monde, une pompe que doivent envelopper des clématites et autres plantes grimpantes, une jolie source, le futur monde de nos fleurs, le silence et quarante-cinq mille francs de dettes de plus ! Vous comprenez! Oui, la folie est faite et complète! Ne m'en parlez pas, il faut la payer, et maintenant je passe les nuits!
Il n'habita jamais la maison primitive. En 1839, il la loua à la comtesse Guidoboni Visconti, qui vint y passer l'été avec son fils Lionel-Richard, dont certaines mauvaises langues accusaient Balzac d'être le père.
Le jardin, sur une pente abrupte, n'était qu'une succession de planches glissant les unes sur les autres à chaque averse et que Balzac rêvait de soutenir par des pilotis en bois d'aloès, semblables à ceux qui portaient les palais vénitiens. La déclivité décourageait toute culture, et Frédérick Lemaitre, venu voir Balzac, dut se servir de deux pierres pour caler ses pieds à chaque arrêt dans la visite. De plus, à plusieurs reprises, le mur mitoyen s'écroula chez le voisin, qu'il fallut chaque fois indemniser; alors Balzac finit par acheter le terrain de ce voisin, "pour, disait-il, que mon mur tombe chez moi".
Tout cela n'empêcha par Balzac de faire le projet de planter cinq mille pieds d'ananas. En vendant les fruits 5 francs, en en déduisant 100.000 francs pour les frais, il ferait une recette annuelle de 400.000 francs. Un jour, accompagné de Théophile Gautier, il cherchamême sur le boulevard Montmartre une boutique pour la vente de ses fruits : le magasin serait peint en noir, rechampi de filets d'or et porterait sur son enseigne, en lettres d'or, "Ananas des Jardies". Bien sûr ce projet ne vit même pas un commencement de réalisation
C'est dans les deux années qu'il passa aux Jardies que Balzac écrivit le Cabinet des antiques et une partie de ses Illusions perdues.
En 1838, Balzac a été saisi deux fois, toujours lourdement endetté (222 francs au blanchisseur, 750 francs au boucher, 600 francs au garde-champêtre...). De plus, en janvier 1839, il fut emprisonné à Sèvres pour avoir manqué la garde nationale rurale. En septembre 1840, une nouvelle saisie ayant été ordonnée, Balzac put déménager quelques meubles à la hâte et se réfugier à Passy. En juillet 1841, les Jardies ont été mises en vente et achetées par un architecte de ses amis
L'aspect des lieux a bien changé depuis, et la description que Balzac en donne dans ses Mémoires de deux jeunes mariés est plus évocatrice que ce qu'il en subsiste.
La maison primitive a été achetée en 1878 par Gambetta, qui l'agrandit d'un salon. La maison construite par Balzac, tombée en ruines, a disparu. Le jardin a été loti dans sa presque totalité.
Aujourd'hui, la maison est consacrée au souvenir du seul Gambetta, avec, à côté, un monument en mémoire du grand homme.

ISSOUDUN, FRAPESLE
Le château de Frapesle appartenait au père de Zulma Touragin, une amie d’enfance de Laure, la sœur de Balzac. Zulma épousa un officier d’artillerie, François-Michel Carraud.
[L’arrière-petit-fils de Zulma Carraud, Raymond Payelle (1898-1971), écrivit, sous le pseudonyme de Philippe Hériat, des romans comme La Famille Boussardel, Les Enfants gâtés (Goncourt de 1939) et des pièces de théâtre.]
Balzac fit connaissance des Carraud à Versailles. Il alla leur rendre visite à Angoulême en 183, 1832, 1833. C’est la raison pour laquelle le roman Les Illusions perdues, paru en 1837, commence dans la ville d’Angoulême.
En 1833, les Carraud sont venus s’installer au château de Frapesle. Balzac leur fit une courte visite et décida “de ne passer jamais une année sans aller habiter [sa] chambre de Frapesle”.
Il revint tout le mois de février 1838. Zulma Carraud l’aida à découvrir Issoudun, ville qui tiendra une grande place dans son roman La Rabouilleuse (1841). En remerciement, Balzac lui dédia La Maison Nucingen (1838): “A vous, madame, dont la haute et probe intelligence est comme un trésor pour vos amis, vous qui êtes à la fois pour moi tout un public et la plus indulgente des sœurs”.

La Rabouilleuse contient un véritable “dossier” historique, archéologique et sociologique sur Issoudun. Alors que le nom de la ville vient du celtique Uxeldunum, Balzac explique le toponyme en Is-sous-dun, dun(um) désignant le donjon du château et is étant l’abréviation d’Isis; d’où sa théorie selon laquelle le donjon s’élèverait sur un ancien temple d’Isis…
L’auberge de la Cognette (ainsi appelée du nom de l’épouse du père Cognet) existe toujours ; dans La Rabouilleuse elle sert de lieu de réunions aux “Chevaliers de la Désœuvrance”, ces adolescents qui, sous la Restauration, n’ayant rien d‘autre à faire qu’attendre leur mariage ou la succession de leurs parents, se livraient contre les artisans et les bourgeois à de farces de mauvais goût :
— ils se déguisent en démons et terrorisent, la nuit, un relieur superstitieux ;
— ils modifient la cheminée du Receveur des Contributions de telle sorte qu’elle enfume tout l’appartement ;
— ils annoncent la mort d’une veille dame riche et avare, de telle sorte qu’elle voit un jour tous ses héritiers arriver certes en grand deuil, mais plutôt joyeux ;
— ils remplacent chaque matin par des œufs durs les œufs frais pondus par les poules du sous-préfet ;
— ils démontent la charrette d’un vieil espagnol, le père Fario, et ils la remontent sur le sommet, inaccessible à une voiture, de la butte de la Tour Blanche.
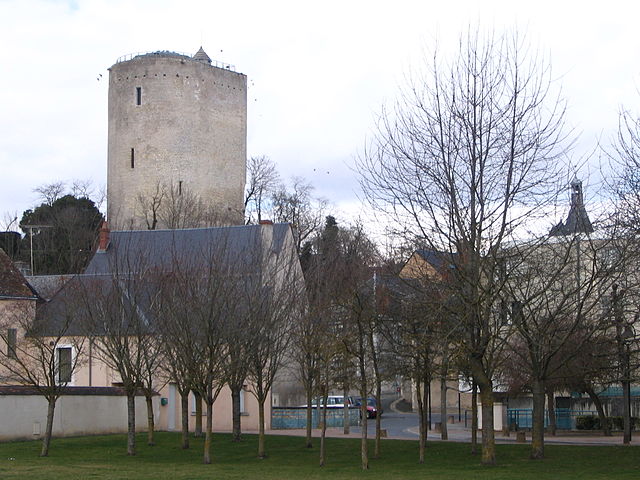
wiki-Benjism89
Balzac était toujours à court d’argent (il demandait en juin 1838 à son amie Zulma Carraud de lui trouver une femme de trente ans qui acceptât de l’épouser et de payer ses dettes). Il essayait de monter des “affaires” qui auraient dû être lucratives (papeteries d’Angoulême, mines d’argent de Sardaigne…). C’est ainsi qu’en découvrant les “massepains d’Issoudun”, une spécialité de la pâtisserie locale à base d’amandes pilées et de sucre, il eut l’idée de les faire commercialiser à Paris, par un pâtissier de la rue Vivienne. Il rédigea lui-même le prospectus publicitaire, dans lequel il glissa une citation de son propre roman La Rabouilleuse:
Je viens d’ouvrir rue Vivienne, 38 bis, un magasin pour l’exploitation de ce produit dont la réputation, dans le Berry, a près d’un siècle d’existence et dont le plus remarquable romancier de notre époque parle ainsi dans un des ses ouvrages : “Cette digne femme avait eu la recette de ces si célèbres religieuses auxquelles on doit le massepain d’Issoudun, l’une des plus grandes créations de la confiturerie française et qu’aucun chef d’office, cuisinier, pâtissier et confiturier n’a pu contrefaire. M. de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en demandait tous les ans de grandes quantités pour le sérail du sultan Mahmoud.” (H. de Balzac). Cette pâtisserie unique, qui, jusqu’à ce jour, n’avait été faite que pour la table des riches, va être popularisée au moyen de la division adoptée pour la vente; on offrira au public parisien des massepains d’Issoudun depuis soixante francs jusqu’à cinq francs. Dans le but de faire apprécier les qualités hors lignes de cette pâtisserie, on en débitera des tranches de cinquante centimes au magasin.
Ce fut un succès… qui ne dura guère plus de quinze jours !