MARCEL PROUST À ILLIERS-COMBRAY
INTRODUCTION À LA DÉCOUVERTE
Marcel Proust n’approuvait pas les pèlerinages sur la tombe des grands artistes. Mais il encourageait les “promenades esthétiques” dans les lieux qui les avaient inspirés. C’est ce qui apparaît dans la préface à sa traduction de la Bible d’Amiens de John Ruskin.
Je voudrais donner au lecteur le désir et le moyen d’aller passer une journée à Amiens en une sorte de pèlerinage ruskinien […]. Il me semble que c’est ainsi que doit être célébré le “culte des héros”, je veux dire en esprit et en vérité. Nous visitons le lieu où un grand homme est né et le lieu où il est mort; mais les lieux qu’il admirait entre tous, dont c’est la beauté même que vous aimons dans ses livres, ne les habitait-il pas davantage ? Nous honorons d’un fétichisme qui n’est qu’illusion une tombe où reste seulement de Ruskin ce qui n’était pas lui-même et nous n’irions pas nous agenouiller devant ces pierres d’Amiens à qui il venait demander sa pensée, qui la gardent encore. Sans doute le snobisme qui fait paraître raisonnable tout ce qu’il touche n’a pas encore atteint (pour les Français du moins) et par là préservé du ridicule ces promenades esthétiques. Dites que vous allez à Bayreuth entendre un opéra de Wagner, à Amsterdam visiter une exposition, on regrettera de ne pouvoir vous accompagner. Mais si vous avouez que vous allez voir, à la Pointe du Raz une tempête, en Normandie les pommiers en fleurs, à Amiens une statue aimée de Ruskin, on ne pourra s’empêcher de sourire. Je n’en espère pas moins que vous irez à Amiens après m’avoir lu. […] Les indications que les écrivains nous donnent dans leurs oeuvres sur les lieux qu’ils ont aimés sont souvent si vagues que les pèlerinages que nous y essayons en gardent quelque chose d’incertain et d’hésitant et comme la peur d’avoir été illusoires (…). Nous en sommes réduits à faire nos dévotions “au petit bonheur”. Voilà un genre de déboires que vous n’aurez pas à redouter avec Ruskin, à Amiens surtout…
Proust avait perçu un autre plaisir des pèlerinages littéraires, celui de découvrir, sur le terrain, les lieux dont les noms chantent dans notre mémoire; il analyse ce “trouble délicieux” à propos de Nerval et du Valois :
Si, quand [on] nous parle des cantons de Chantilly, de Compiègne et d’Ermenonville, quand [on] nous parle d’aborder aux îles du Valois ou d’aller dans les bois de Châalis ou de Pontarmé, nous éprouvons ce trouble délicieux, c’est que ces noms nous les avons lus dans Sylvie. […] Le génie de Gérard en a imprégné ces noms, ces lieux. […] Ce sont les mots Chââlis, Pontarmé, îles de l’Ile-de-France qui exaltent jusqu’à l’ivresse la pensée que nous pouvons par un beau matin d’hiver partir voir ces pays de rêve où se promena Gérard. (“Gérard de Nerval”, dans Contre Sainte-Beuve, IX)
Le promeneur qui parcourt les environs d’Illiers connaît cette émotion de découvrir, sur les plaques indicatrices, les toponymes que le roman nous a rendus familiers : Méréglise, Vieuxvicq, Tansonville, Montjouvin, Roussainville, Mirougrain…
Et pourtant, le “Combray” que connaît le lecteur de la Recherche du temps perdu est bien une création littéraire. Au moins est-ce “l’amalgame des deux lieux où le petit Marcel Proust passa les plus belles heures de son enfance”, la maison de son grand-oncle maternel Louis Weil à Auteuil et la maison de l’oncle Jules Amiot à Illiers — où il alla en vacances régulièrement jusqu’à l’âge de dix ans et où ne revint qu’une seule fois, à quinze ans, après la mort de sa tante.
C’est aux souvenirs d’Auteuil que Proust emprunte l’image du jardin dans lequel, les soirs d’été, on se réunit pour de “longs bavardages dans l’obscurité”, ainsi que le drame du coucher sans le baiser de sa mère retenue en bas par quelque invité. Pour le reste, Combray ressemble beaucoup à Illiers, avec les ruines de son château, son avenue de la Gare, sa place du Calvaire, son viaduc, sa passerelle sur la rivière, sa rue du Saint-Esprit, son Mail, son parc et la barrière blanche qui donne, sur le haut, vers la plaine et les champs… Le visiteur d’Illiers est étonné de constater que la mémoire de l’enfant avait effectivement tout conservé de cette petite ville dans laquelle, adulte, il ne retourna plus.
Cependant Proust, en artiste véritable, n’a pas voulu enfermer dans les pages de son livre une image exacte d’Illiers et de sa région. S’il compare ce petit terroir de Beauce à “une Délos fleurie”, à cette île qui, disait-on, flottait sur la mer, c’est sans doute par allusion à certains “flottements” géographiques dont le pèlerin littéraire prendra vite conscience : le domaine de Tansonville, dans l’oeuvre, a remonté vers le nord jusqu’au Pré-Catelan, Montjouvin est passé du côté de Méséglise, Roussainville s’est approché d’Illiers pour donner son nom au château…
Mais là n’est pas l’essentiel : Du Côté de chez Swann n’est pas un guide d’Illiers et de sa région. C’est un seulement un guide pour celui qui veut voir les choses avec d’autres yeux, ceux d’un grand artiste. Et c’est pourquoi on voit à Illiers — ou autour d’Illiers — d’étranges visiteurs qui restent de longues minutes devant un nénuphar de la rivière, qui connaissent un instant de vrai bonheur à cause d’un reflet sur un meuble dans le salon de tante Léonie ou qui s’émeuvent des bulles qui montent du lavoir de Saint-Eman…
LA FAMILLE DE MARCEL PROUST
En 1827, Louis Proust, qui appartient à une vieille famille du pays, épouse à Illiers Virginie Torcheux; il tient, sur la place du Marché, en face de l’église Saint-Jacques, une boutique où l’on vend un peu de tout. L’année suivante, il a une fille, Elisabeth, et, en 1834, un fils, Adrien.
Cet Adrien, bon élève, alla comme boursier au collège de Chartres, et, le premier de la famille, il quitta Illiers pour faire sa médecine à Paris. Il eut l’agrégation et il voyagea comme médecin jusqu’à Téhéran et Constantinople pour étudier les voies de pénétration du choléra en Europe (une épidémie de choléra se développa en 1867).
Le 3 septembre 1870, le docteur Adrien Proust épousa Jeanne Weil, une jeune et belle juive, fille d’un riche agent de change parisien. Quand vint le siège de Paris et la Commune, le ménage, qui habitait à Paris 9 boulevard Malesherbes, alla s’abriter à Auteuil (96 rue Jean de La Fontaine) chez un oncle, Louis Weil : c’est là que naquit Marcel Proust le 10 juillet 1871 (plaque sur la maison).
Et, pendant de nombreuses années, au printemps et en été, la famille conserva l’habitude de venir s’installer dans la propriété d’Auteuil. C’est là que le petit Marcel vécut le drame du baiser du soir; c’est dans l’escalier de la maison d’Auteuil qu’il guettait en tremblant le reflet de la bougie paternelle; c’est à Auteuil que sa mère lui lut François le Champi, un jour qu’il était nerveux et malade.
A Illiers, Marcel Proust ne connut jamais son grand-père, ni l’épicerie familiale. En effet, Virginie Proust (née Torcheux) s’était retirée, fortune faite, en 1866, dans un appartement sur la place du Marché (au n° 6). Sa fille Elisabeth, la soeur aînée d’Adrien, avait épousé en 1847 un riche marchand drapier d’Illiers, Jules Amiot. Leur magasin se trouvait lui aussi place du Marché et le couple habitait au 4 de la rue du Saint-Esprit; leur servante s’appelait Ernestine Gallou.
C’est dans cette maison, chez l’oncle Jules Amiot et la tante Elisabeth Proust, que, entre 1877 et 1880, Marcel et ses parents vinrent plusieurs fois en vacances, surtout à Pâques. A chaque séjour, il retrouvait sa tante Elisabeth, mais celle-ci vivait de plus en plus en recluse : d’abord elle avait refusé de quitter Illiers, puis sa maison, puis sa chambre, puis son lit; elle ne nourrissait d’eau de Vichy, de tisanes et de petites madeleines achetées dans la pâtisserie proche de l’église Saint-Jacques.

Marcel Proust en 1877 (avec son frère cadet Robert)
HISTOIRE DU MUSEE MARCEL-PROUST (“MAISON DE TANTE LEONIE”)
1935 - Le professeur Robert Proust organise la première journée des Aubépines.
1946 - Le Pré-Catelan est classé site littéraire.
1954 - Mlle Germaine Amiot (cousine de Proust) rachète la maison et la restaure.
1961 - La maison est classée monument historique; M. Philibert-Louis Larcher (1881-1972), inspecteur de l’enseignement technique, la met en valeur.
1971 - Par décision du ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin, Illiers devient "Illiers-Combray" pour le Centenaire de la naissance de Marcel Proust.
1972 - On inaugure le Musée Marcel-Proust.
1974 - Un américain, Paul Elicker, président de S.C.M. Corporation à New-York, finance la restauration de l’Orangerie (qui abrite une exposition de 85 photographies de Paul Nadar, le fils de Félix Nadar).
1976 - Peu avant de mourir, Germaine Amiot donne la propriété à la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray.
1986 - Le Conseil régional décide de financer l’entretien de la maison.
2024 - En mai, après plus de deux années de travaux conduits par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir, la Maison de Tante Léonie est ouverte à nouveau au public. On y trouve, rénovées, les pièces historiques de la maison que Proust a connue et des espaces muséographiques agrandis.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES DE MARCEL PROUST
— Jean Santeuil, pp. 277 à 353 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “A Illiers”.
— A la Recherche du Temps perdu, Du Côté de chez Swann, t. I, pp. 3 à 187 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “Combray”.
— Pastiches et Mélanges, Mélanges, pp. 160 à 171 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “Journées de lecture”.
— Contre Sainte-Beuve, passim.
ETUDES
— André FERRE, Géographie de Marcel Proust, Sagittaire, 1939 : chapitre III, Localisation des pays de A la Recherche du Temps perdu, “Le pays de Combray”; pp. 90 à 102.
— Pierre CLARAC et André FERRE, Album Proust , Bibliothèque de la Pléiade, 1965; pp. 1 à 55.
— George D. PAINTER, Marcel Proust, Les années de jeunesse, Mercure de France, 1966; chap. I : Le jardin d’Auteuil - chap. II : Le jardin d’Illiers - chap. III : Les deux côtés d’Illiers; pp. 31 à 75.
— Philibert-Louis LARCHER, Le parfum de Combray, pèlerinage proustien à Illiers, 1971.
— Georges POISSON, Guide des maisons d’hommes célèbres, 1986, p. 176.
— Ghislain de DIESBACH, Proust, Perrin, 1991.
— Claude THISSE : Illiers-Combray au temps de Marcel Proust, Éditions Alan Sutton, 2009.
VISITER LE PAYS DE PROUST
ILLIERS : à pied, de la place de l'Eglise jusqu'au Loir
La Maison de tante Léonie
La place du Marché et l'Eglise Saint-Jacques
La tour du château (rue des Lavoirs)
Le Pont-Vieux sur le Loir
A pied : LE CÔTÉ DE MÉSÉGLISE
Le Pré-Catelan
Le raidillon des aubépines
La barrière blanche
Les champs vers Méréglise
En voiture : LE CÔTÉ DE GUERMANTES
Mirougrain (château)
Saint-Eman (la "source du Loir")
Saint-Eman (le
château des Pâtis)


De la gare à la maison
Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n’était qu’une église résumant la ville, la représentant, parlant d’elle et pour elle aux lointains, et, quand on approchait, tenant serrés autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu’un reste de remparts du moyen âge cernait çà et là d’un trait aussi parfaitement circulaire qu’une petite ville dans un tableau de primitif.
A l’habiter, Combray était un peu triste, comme ses rues dont les maisons construites en pierres noirâtres du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l’ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu’il fallût, dès que le jour commençait à tomber, relever les rideaux dans les “salles”; des rues aux graves noms de saints (desquels plusieurs se rattachaient à l’histoire des premiers seigneurs de Combray) : rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques, où était la maison de ma tante, rue Sainte-Hildegarde, où donnait la grille, et rue du Saint-Esprit sur laquelle s’ouvrait la petite porte latérale de son jardin.
La cousine de mon grand-père — ma grand’tante — chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n’avait plus voulu quitter, d’abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit et ne “descendait” plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d’idée fixe et de dévotion.
Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand-Pré (par opposition au Petit-Pré, verdoyant au milieu de la ville, entre trois rues), et qui, unie, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d’images gothiques à même la pierre où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. (Du Côté de chez Swann)
La maison, façade côté rue.
cl. wiki-Tristram5
LE JARDIN
Le jardin tel qu’il est décrit emprunte beaucoup de ses traits au jardin de la maison de Louis Weil à Auteuil. La façade de la maison d’Illiers, comme le montrent les photographies de l’époque, avait conservé son crépi; les fenêtres étaient entourées de faïences.
LE GRELOT DE LA PORTE
[Le grelot évoqué dans l’oeuvre est bien celui de la maison d’Illiers. En revanche l’image de la grand’mère dans le jardin est un souvenir d’Auteuil.]

cl. wiki-F. Bluszez
Le monde se bornait habituellement à M. Swann qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vînt chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin […], quelquefois après le dîner, à l’improviste. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant “sans sonner”, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait : “Une visite, qui cela peut-il être?” mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann. Ma grand’tante parlant à haute voix, pour prêcher d’exemple, sur un ton qu’elle s’efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi; que rien n’est plus désobligeant pour une personne qui arrive et à qui cela fait croire qu’on est en train de dire des choses qu’elle ne doit pas entendre; et on envoyait en éclaireur ma grand’mère, toujours heureuse d’avoir un prétexte pour faire un tour de jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop aplatis. (Du Côté de chez Swann)
LE JARDIN
 |
 |
La maison en 1980
wiki-EricHoudas La maison restaurée en 2019 |
LE CABINET DE L’ONCLE ADOLPHE
[“L’oncle Adolphe” est une subtile synthèse de l’oncle Amiot, d’Illiers et du grand-oncle Weil, d’Auteuil. Le “cabinet” se trouve dans la maison d’Illiers, derrière la cuisine.]
Quand tout le monde était couché, il allait se retirer dans un petit cabinet meublé “à l’orientale” de mille choses qu’il avait rapportées d’Algérie, avec beaucoup de nattes sur la pierre, de cocos sculptés et de photographies représentant des mosquées ou des palmiers, petit corps de bâtiment à part ne supportant aucun étage, donnant directement sur le jardin par des fenêtres en petits carreaux de couleur, et qui faisait à Jean l’effet singulier d’appartenir à son oncle en vertu d’un droit spécial, signe de sa situation ou de sa fortune, si différent pour lui, du reste, d’une maison, couvert de souvenirs comme une tombe, frais comme une oasis et décoré à la façon d’un établissement de bains, sombre comme une église.
Il se retirait là où personne ne devait venir le déranger, car il était censé s’y livrer à d’importants travaux ou peut-être s’y réfugier dans de mystérieux souvenirs, et Jean, quand il en sortait, le voyait souvent se frotter les yeux, ayant répondu d’ailleurs d’une voix effrayée, et pas toujours dès la première fois, à son appel du dehors, venant le chercher pour la promenade, toutes choses lui donnant à penser que, peut-être pour le punir d’en avoir médit, le sommeil était venu le prendre au moment où il allait travailler ou ranger ses photographies sur la chaise longue en natte, près du narguilé. (Jean Santeuil)
Avant de monter lire, j’entrais dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frère de mon grand-père, ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-chaussée, et qui — même quand les fenêtres ouvertes laissaient entrer la chaleur, sinon les rayons du soleil qui atteignaient rarement jusque là — dégageait inépuisablement cette odeur obscure et fraîche, à la fois forestière et ancien régime, qui fait rêver longuement les narines quand on pénètre dans certains pavillons de chasse abandonnés. (Du Côté de chez Swann)
L’ARRIERE-CUISINE
[C’était le domaine de “Françoise”, personnage qui emprunte des traits à Ernestine Gallou (qui, jusqu’en 1889, soigna la grand-mère Proust dans son petit logis de la place de l’église), à Félicie Fitau (la cuisinière de Paris), à Céline Cottin, à Céleste Albaret.]
J’allais m’asseoir près de la pompe et de son auge, sur le banc sans dossier ombragé d’un lilas, dans ce petit coin du jardin, de la terre peu soignée duquel s’élevait par deux degrés, en saillie de la maison, et comme une construction indépendante, l’arrière-cuisine. On apercevait son dallage rouge et luisant comme du porphyre. Elle avait moins l’air de l’antre de Françoise que d’un petit temple de Vénus. Elle regorgeait des offrandes du crémier, du fruitier, de la marchande de légumes, venus parfois de hameaux assez lointains pour lui dédier les prémices de leurs champs. Et son faîte était toujours couronné du roucoulement d’une colombe. (Du Côté de chez Swann)
LA CUISINE
[Ce fut le domaine d’Ernestine Gallou, qui resta 33 ans au service des Amiot.]
La nuit venait. Souvent, à ce moment-là, en ouvrant à tâtons au bout du couloir obscur la porte de la cuisine, Jean était réjoui en apercevant comme une vision dans la nuit, levé au fond de la cuisine obscure et comme mystérieusement soutenu en l’air par l’obscurité, le dallage illuminé et pourpre du corps du fourneau, rouge illumination imprévue, comme à l’angle d’une rue déjà obscure un balcon incendié par un invisible soleil couchant. Un nuage de fumée rose soutenu sans doute au-dessus d’une bouillotte par une fumée invisible flottait auprès, et comme ces petites vagues de la mer qui, en passant dans les rayons du couchant, se diamantisent, un flot qui jaillissait rythmiquement hors de la casserole bouillonnante semblait de flamme. La bouillotte portait sur sa large poitrine brillante la tableau ardent des régions de feu qu’elle voyait, mais qui restaient invisibles à Jean. L’oeil fixé, dans la nuit qui avait tout à fait envahi sa cuisine, sur ces rouges constellations, Catherine restait debout à son bord, gouvernant le feu avec sagesse de la pointe de sa tringle de fer, rapprochant, éloignant la casserole, ramant un instant avec sa cuillère de bois, remettant le couvercle du fourneau, laissant tout aller, changeant les couleurs de l’illumination qui se portait maintenant sur une petite casserole où s’accomplissait avec un bruit régulier et doux la cuisson d’un poulet livré au beurre bouillant et à la graisse fondue qui lui tiraient son jus, qu’on entendait tinter, puis sur une vaste cuve si tempêtueusement bouillonnante que par-dessus les larges feuilles d’épinards d’énormes lames rondes s’élançaient toutes blanches, donnant l’idée d’une puissance magique, éteignant en tirant le fourneau cette rouge clarté du mur qui en entrant avait si vivement saisi Jean, dressée ainsi sans support réel et fantastique au milieu du vide obscur, comme les machinistes attentifs à régler, à varier, à terminer à temps les jeux de la lumière colorante sur les décors d’une féerie. (Jean Santeuil)
Jean, avant d’aller à l’église, était descendu au sous-sol dans la cuisine où Félicie, comme Vulcain dans ses forges, attisait le feu en frappant d’une tringle de fer les charbons rouges, dans un flamboiement, une chaleur, un crépitement, un grondement d’enfer. Mais, rangés sur le fourneau comme dans l’atelier d’un céramiste, exhalant déjà une blanche vapeur, de petits pots, de rondes casseroles, une vaste cuve, chacun laissant chanter une pâte d’une couleur ici brune, ici rose, ici violette, d’une odeur aussi particulière, semblaient témoigner déjà la délicatesse des chefs-d’oeuvre dus à cet art violent. Ce jour-là, le nombre des casseroles était innombrable, tant le dimanche il devait y avoir de plats. Sur la table, des petits pois déjà écossés étaient amoncelés comme de petites billes vertes.
Quoique en retard pour la messe, Jean était venu là pour savoir ce qu’il y aurait à déjeuner comme aux nouvelles, nouvelles qui n’avaient rien de platonique, qui satisfaisaient sa curiosité, mais pour la faire renaître aussitôt de ses cendres, plus sensuelle et plus impatiente, car un menu, s’il renseigne comme une gazette, excite aussi comme un programme. Puis il était parti, heureux de penser que pendant qu’il serait à la messe, travailleraient avec ardeur pour lui le feu, géant dont l’homme s’est fait un cuisinier, et Félicie dont les mains grossières comme celles de certains sculpteurs et de certains pianistes composaient pour lui, avec des retouches si délicates, un ouvrage d’un fini merveilleux. (Jean Santeuil)
Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les fééries où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu les chefs-d’oeuvre culinaires d’abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie et petits pots de crème, en passant par une collection complète de casseroles de toutes dimensions. Je m’arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu; mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d’outre-mer et de rose et dont l’épi, finement pignoché de mauve et d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied — encore souillé pourtant du sol de leur plant — par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers les déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum.
La pauvre charité de Giotto, comme l’appelait Swann, chargée par Françoise de les “plumer”, les avait près d’elle dans une corbeille; son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre; et les légères couronnes d’azur qui ceignaient les asperges au-dessus de leurs tuniques de rose étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la Vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à la broche un de ces poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avaient porté loin dans Combray l’odeur de ses mérites, et qui, pendant qu’elle nous les servait à table, faisaient prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l’arôme de cette chair qu’elle savait rendre si onctueuse et si tendre n’étant pour moi que le propre parfum d’une de ses vertus.
Mais [un jour] où je descendis à la cuisine, Françoise était en train, dans l’arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors d’elle, tandis qu’elle cherchait à lui fendre le cou sous l’oreille, les cris de “sale bête! sale bête!”, mettait la sainte douceur et l’onction de notre servante un peu moins en lumière qu’il n’eût fait, au dîner du lendemain, par sa peau brodée d’or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d’un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang, qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère et, regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois : “Sale bête!” Je remontai tout tremblant; j’aurais voulu qu’on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m’eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même… ces poulets?… (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
LA CAFETIÈRE :
[La cafetière présentée dans la cuisine n’est pas celle que connut Marcel Proust, qui n’a pas été conservée.]
C’est parmi ces attributs antiques et innocent de la souveraineté rurale qu’on pourrait faire rentrer l’appareil extrêmement compliqué, parce qu’il était très primitif, que la bonne apportait alors à M. Abert et où il faisait le café, en vertu d’une prérogative qu’il n’aurait cédée à aucun autre. Cet appareil était en verre, de sorte que l’on voyait l’eau former les bouillons, la vapeur mêlée à l’essence du café mettre sur les parois une vapeur noirâtre, et l’eau s’élevant traverser un filtre et retomber dans l’autre tube d’où elle était recueillie. M. Abert entendait l’eau bouillir, et cette musique, moins savante que telle chevauchée qui stimule des digestions plus distinguées, mais exprimant parfaitement le bien-être qu’éprouvait M. Abert, et annonçant très clairement le moment prochain où le café fumant allait accroître ce bien-être d’une sensation exquise de chaleur, de goût sucré et vif et de parfum délicat, lui suffisait absolument. (Jean Santeuil)
[…] l’appareil en verre où l’oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c’était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l’ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. (Du Côté de chez Swann)
LA SALLE À MANGER
Cette pièce est évoquée par Proust à divers moments de la journée : le matin où il s’y réfugie pour lire, le midi pour le déjeuner, l’après-midi pour le goûter et enfin pour le dîner du soir.

cl. jn-1980
LES LECTURES du matin
Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu’on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile.
Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu’à l’heure encore lointaine du déjeuner, personne n’entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse, et où je n’avais pour compagnons, très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu’on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer un différent à celui des mots que vous lisez. Je m’installais sur une chaise, près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l’oncle matinal et jardinier dirait : “Il ne fait pas de mal! On supporte très bien un peu de feu; je vous assure qu’à six heures il faisait joliment froid dans le potager. Et dire que c’est dans huit jours Pâques!” Avant le déjeuner qui, hélas! mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d’où l’eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l’unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lunes ses plates-bandes de pensées. (Journées de lecture)
LE DEJEUNER à midi
La cuisinière venait longtemps d’avance mettre le couvert. L’heure passait; souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient “pris par Méséglise”, ou ceux qui n’étaient pas sortis ce matin-là, ayant “à écrire”. Ils commençaient aussitôt à s’approcher du feu, à consulter l’heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d’une particulière déférence celui ou celle qui était “restée à écrire” et on lui disait : “Vous avez fait votre petite correspondance” avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et les ménagements, comme si cette “petite correspondance” avait été à la fois un secret d’Etat, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s’asseyaient d’avance à table, à leurs places.
Tout était prêt, le couvert entièrement mis sur la nappe où manquait seulement ce qu’on n’apportait qu’à la fin du repas, l’appareil en verre où l’oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c’était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l’ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune; et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s’arrêtant juste au rose qu’il fallait, avec l’expérience d’un coloriste et la divination d’un gourmand. (Journées de lecture)
LES MENUS
Au fond permanent d’oeufs, de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu’elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait — selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces quatre-feuilles qu’on sculptait au XIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et des épisodes de la vie — : une barbue parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde parce qu’elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin, des cardons à la moelle parce qu’elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu’il avait bien le temps de descendre d’ici sept heures, des épinards pour changer, des abricots parce que c’était encore une rareté, des groseilles parce que dans quinze jours il n’y en aurait plus, des framboises que M. Swann avait apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin après deux ans qu’il n’en donnait plus, du fromage à la crème que j’aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu’elle l’avait commandé la veille, une brioche parce que c’était notre tour de l’offrir. Quand tout cela était fini, composée expressément pour nous, mais dédiée plus spécialement à mon père qui était amateur, une crème au chocolat, inspiration, attention personnelle de Françoise, nous était offerte, fugitive et légère comme une oeuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui eût refusé d’en goûter en disant : “J’ai fini, je n’ai plus faim”, se serait immédiatement ravalé au rang de ces goujats qui, même dans le présent qu’un artiste leur fait d’une de ses oeuvres, regardent au poids et à la matière alors que n’y valent que l’intention et la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat eût témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur. (Du Côté de chez Swann)
LE GOÛTER
Jean, quand sonnait quatre heures et demie, l’esprit fatigué de lire et le corps réveillé, fermait son livre et descendait goûter. Il entrait dans la salle à manger, dont la douce perspective n’avait pas été sans se présenter deux ou trois fois devant ses yeux, pendant même qu’il lisait les aventures du capitaine Fracasse. Dans la salle à manger aux murs couverts d’assiettes toutes modernes avec des devises, comme celles dont on se servait à table, et dont chacun s’amusait à comparer les devises, son oncle, ses cousins, sa mère étaient souvent déjà installés. Et avec l’habileté d’un savant et le désintéressement d’un père de famille, son oncle surveillait la cafetière en verre où l’eau bouillait déjà. Après avoir mangé un biscuit rose, Jean écrasait des fraises dans un fromage à la crème jusqu’à ce que la couleur lui fît toutes les promesses que traduirait dans un instant le goût rêvé et obtenu. En attendant, il remettait des fraises et de temps en temps un peu de crème, dans des proportions définies, avec des regards mêlés d’attention et de plaisir, toute l’expérience d’un coloriste et la divination d’un gourmand. Du marronnier rose du curé qu’on ne voyait pas avaient tombé tant de fleurs que la marche du seuil par la fenêtre semblait avoir été jonchée de pétales de roses. On entendait les oiseaux du jardin du curé. Et l’on allait partir pour une belle promenade. (Jean Santeuil)
LE DÎNER
Dès qu’on sonnait le dîner, j’avais hâte de courir à la salle à manger où la grosse lampe de la suspension, qui connaissait mes parents et le boeuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs. (Du Côté de chez Swann)
L'ESCALIER
C’est là qu’on peut évoquer le “drame du coucher”, même si Marcel avait surtout vécu la scène à Auteuil.
Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite que le moment où je l’entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux.
Je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que, quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l’embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ç’avait été dans ma chambre. Mais voici qu’avant que le dîner fût sonné mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire : “Le petit a l’air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir.” Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand’mère et que ma mère la foi des traités, dit : “Oui, allons, va te coucher.” Je voulus embrasser maman; à cet instant on entendit la cloche du dîner. “Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela; ces manifestations sont ridicules. Allons, monte!” Et il me fallut partir sans viatique; il me fallut monter chaque marche de l’escalier, comme dit l’expression populaire, à “contre-coeur”, montant contre mon coeur qui voulait retourner près de ma mère parce qu’elle ne lui avait pas, en m’embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté, où je m’engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir, et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n’en pouvait plus prendre sa part. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m’ensevelir dans le lit de fer qu’on avait ajouté dans la chambre parce que j’avais trop chaud l’été sous les courtines de reps du grand lit, j’eus un mouvement de révolte. J’allais sans bruit dans le couloir; mon coeur battait si fort que j’avais de la peine à avancer, mais du moins il ne battait plus d’anxiété, mais d’épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l’escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même, je m’élançai. A la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et, pour éviter la scène qu’il me ferait, elle me dit d’une voix entrecoupée par la colère : “Sauve-toi, sauve-toi, qu’au moins ton père ne t’ait vu ainsi attendant comme un fou!” Mais je lui répétais : “Viens me dire bonsoir”, terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s’élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d’un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire : “Rentre dans ta chambre, je vais venir.” Il était trop tard, mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n’entendit : “Je suis perdu!” (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
LA CHAMBRE DE TANTE LEONIE

cl. jn-1980
LES ODEURS
C’était de ces chambres de province qui nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l’atmosphère y tient en suspens. L’air y était saturé de la fine fleur d’un silence si nourricier, si succulent que je ne m’y avançais qu’avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d’arriver à Combray. Le soleil, d’hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les deux briques et qui badigeonnait toute la chambre d’une odeur de suie. Je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours revêtus d’un appui-tête au crochet; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et “lever” les fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense “chausson” où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs. (Du Côté de chez Swann)
LES MEUBLES
D’un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l’officine et du maître-autel, où, au-dessous d’une statuette de la Vierge et d’une bouteille de Vichy-Célestins, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu’il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne pas manquer l’heure ni de la pepsine, ni des vêpres. (Du Côté de chez Swann)
LA FENÊTRE & LE THÉÂTRE DE LA RUE
De l’autre côté, son lit longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu’elle commentait ensuite avec Françoise. […]
— Françoise, imaginez-vous que Mme Goupil est passée plus d’un quart d’heure en retard pour aller chercher sa soeur; pour peu qu’elle s’attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu’elle arrive après l’élévation.
— Hé! il n’y aurait rien d’étonnant, répondait Françoise.
— Françoise, vous seriez venue cinq minutes plus tôt, vous auriez vu passer Mme Imbert qui tenait des asperges deux fois grosses comme celles de la mère Callot; tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. […]
— Il n’y aurait rien d’étonnant qu’elle viennent de chez M. le Curé, disait Françoise.
— Ah! je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules, chez M. de Curé! Vous savez bien qu’il ne fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celles-là étaient grosses comme le bras. […]
Ainsi Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu’elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait, et quatre coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison.
— Croyez-vous pas que je viens de voir comme je vous vois Mme Goupil avec une fillette que je ne connais point ? Allez donc chercher deux sous de sel chez Camus. C’est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c’est.
— Mais ça sera la fille à M. Pupin, disait Françoise, qui préférait s’en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà deux fois depuis le matin chez Camus.
— La fille à M. Pupin! Oh! je vous crois bien, ma pauvre Françoise! Avec cela que je ne l’aurais pas reconnue!
— Mais je ne veux pas dire la grande, madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l’avoir déjà vue ce matin.
— Ah! à moins de ça, disait ma tante. Il faudrait qu’elle soit venue pour les fêtes. C’est cela! Il n’y a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fêtes. Mais alors nous pourrions bien voir tout à l’heure Mme Sazerat venir sonner chez sa soeur pour le déjeuner. Ce sera ça! J’ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte! Vous verrez que la tarte allait chez Mme Goupil.
— Je serais bien allée chez Camus…, disait Françoise en voyant que ma tante ne l’y enverrait plus.
— Mais non, ce n’est plus la peine, c’est sûrement Mlle Pupin. Ma pauvre Françoise, je regrette de vous avoir fait monter pour rien.
Mais ma tante savait bien que ce n’était pas pour rien qu’elle avait sonné Françoise, car, à Combray, une personne “qu’on ne connaissait point” était un être aussi peu croyable qu’un dieu de la mythologie. On connaissait tellement bien tout le monde, à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien “qu’elle ne connaissait point”, elle ne cessait d’y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d’induction et ses heures de liberté.
— Ce sera le chien de Mme Sazerat, disait Françoise, sans grande conviction, mais dans un but d’apaisement et pour que ma tante ne se “fende pas la tête”.
— Comme si je ne connaissais pas le chien de Mme Sazerat! répondait ma tante dont l’esprit critique n’admettait pas facilement un fait.
— Ah! ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapporté de Lisieux.
— Ah! à moins de ça.
— Il paraît que c’est une bête bien affable, ajoutait Françoise qui tenait le renseignement de Théodore, spirituelle comme une personne, toujours de bonne humeur, toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. C’est rare qu’une bête qui n’a que cet âge-là soit déjà si galante. Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je n’ai pas le temps de m’amuser, voilà bientôt dix heures, mon fourneau n’est seulement pas éclairé, et j’ai encore à plumer mes asperges.
— Comment, Françoise, encore des asperges! mais c’est une vraie maladie d’asperges que vous avez cette année; vous allez en fatiguer nos Parisiens!
— Mais non, madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l’église avec de l’appétit et vous verrez qu’ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuillère. […]
L’année où nous mangeâmes tant d’asperges, la fille de cuisine habituellement chargée de les “plumer” était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s’étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besogne. […] Bien des années plus tard, nous apprîmes que si cet été-là nous avions mangé presque tous les jours des asperges, c’était parce que leur odeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d’asthme d’une telle violence qu’elle fut obligée de finir par s’en aller. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
LE TILLEUL
Françoise faisait infuser son thé; ou, si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane, et c’était moi qui étais chargé de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu’il fallait mettre ensuite dans l’eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage dans les entrelacs duquel s’ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale.
Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l’air des choses les plus disparates, d’une aile transparente de mouche, de l’envers blanc d’une étiquette, d’un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d’un nid. C’était bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiées, justement parce que c’étaient non des doubles, mais elles-mêmes et qu’elles avaient vieilli. Mais surtout l’éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d’or me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui avant de fleurir le sac de pharmacie avaient embaumé les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, c’était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu’était la leur maintenant et qui est comme le crépuscule des fleurs. Bientôt ma tante pouvait tremper dans l’infusion bouillante, dont elle savourait le goût de feuille porte ou de fleur fanée, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. (Du Côté de chez Swann)
LA MADELEINE
Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher n’existait plus pour moi, quand, un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines, qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. […] Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait, après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents; peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé; les formes — et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot — s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. […] Mais dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque là); et avec la maison la ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et maintenant toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l’église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. (Du Côté de chez Swann)
LA CHAMBRE DE MARCEL

cl. jn-1980
Après le déjeuner, surtout si la journée était un peu chaude, chacun montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l’unique étage si bas que, des fenêtres enjambées, on n’aurait eu qu’un saut d’enfant à faire pour se trouver dans la rue.
Ma chambre était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu’à en rendre l’usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. C’est de ces choses qui n’étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient aux regards le lit placé comme au fond d’un sanctuaire; la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes-pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de taies d’oreiller en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j’allais poser avec précaution sur un fauteuil où ils consentaient à passer la nuit; à côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe (toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée, sur l’ordre de ma tante qui craignait de me la voir “répandre”), sortes d’instruments du culte — presque aussi saints que la précieuse liqueur de fleur d’oranger placée près d’eux dans une ampoule de verre — que je n’aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d’utiliser pour mon usage personnel que si ç’avaient été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement; ces petites étoles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de roses blanches qui ne devaient pas être sans épines puisque, chaque fois que j’avais fini de lire et que je voulais me lever, je m’apercevais que j’y étais resté accroché; cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l’intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s’arrêtait, personne, excepté l’horloger, n’aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter; cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d’autel sur la commode ornée de deux vases, d’une image du Sauveur et d’un buis bénit, la faisait ressembler à la Sainte Table (dont un prie-Dieu, rangé là tous les jours quand on avait “fini la chambre”, achevait d’évoquer l’idée), mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d’un seul coup image du Sauveur, vases sacrés, buis bénit, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie-Dieu; cette triple superposition enfin de petits rideaux d’étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriants dans leur blancheur d’aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l’ouvrir ou la fermer, un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu’elles l’eussent été par un buisson d’aubépines réelles ou par des nids d’hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s’installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple, d’ouvrir ou de fermer ma croisée, je n’en venais jamais à bout sans le secours de quelqu’un de la maison; toutes ces choses faisaient de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil —quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres — piquait sur les murs, après avoir rosé l’aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux; et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l’église, à laquelle d’ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu’elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre d’où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpres ou l’enfant de choeur qui nous portait du pain bénit. (Journées de lecture)
LA GRAVURE DU PRINCE EUGENE
[Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de Joséphine et d’Alexandre, accompagna son beau-père Bonaparte en Italie et en Egypte; il fut fait prince d’Empire et vice-roi d’Italie; il fit la retraite de Russie.]

Dans ma chambre [se trouvait] une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonné d’apercevoir une nuit, dans un grand fracas de locomotives et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d’un buffet de gare, où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd’hui mon grand-père de l’avoir autrefois reçu, comme prime, de la munificence d’un fabricant, avant de l’installer à jamais dans ma chambre. Mais alors je ne me souciais pas de son origine, qui me paraissait historique et mystérieuse, et je ne m’imaginais pas qu’il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. (Journées de lecture)
FRANCOIS LE CHAMPI
“Voyons, puisque tu n’as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose, prenons un de tes livres.” Mais je n’en avais pas là. “Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand’mère doit te donner pour ta fête? Pense bien : tu ne sera pas déçu de ne rien avoir après-demain?” J’étais au contraire enchanté et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner, à travers le papier qui les enveloppait, que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect, pourtant sommaire et voilé, éclipsaient déjà la boîte à couleurs de Jour de l’An et les vers à soie de l’an dernier. C’était la Mare au Diable, François le Champi, la Petite Fadette et les Maîtres Sonneurs. Ma grand’mère, ai-je su depuis, avait d’abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana; car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l’esprit même d’un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père l’ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu’elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à Jouy-le-Vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau; et elle s’était rabattue sur les quatre romans champêtres de George Sand. “Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit.”
Maman s’assit à côté de mon lit; elle avait pris François le Champi, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n’avais jamais lu encore de vrais romans. J’avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champi quelque chose d’indéfinissable et de délicieux. L’action s’engagea; elle me parut d’autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent pendant des pages entières à tout autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s’ajoutait, quand c’était maman qui le lisait à haute voix, qu’elle passait toutes les scènes d’amour. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
LECTURE EN ÉTÉ
Je m’étais étendu sur mon lit, un livre à la main, dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur transparente et fragile contre le soleil de l’après-midi derrière ses volets presque clos où un reflet de jour avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes, et restait immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon posé. Il faisait à peine assez clair pour lire, et la sensation de la splendeur de la lumière ne m’était donnée que par les coups frappés dans la rue de la Cure par Camus (averti par Françoise que ma tante ne “reposait pas” et qu’on pouvait faire du bruit) contre des caisses poussiéreuses, mais qui, retentissant dans l’atmosphère sonore, spéciale aux temps chauds, semblaient faire voler au loin des astres écarlates; et aussi par les mouches qui exécutaient devant moi, dans leur petit concert, comme la musique de chambre de l’été.
Cette obscure fraîcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue ce que l’ombre est au rayon, c’est-à-dire aussi lumineuse que lui et offrait à mon imagination le spectacle total de l’été dont mes sens, si j’avais été en promenade, n’auraient pu jouir que par morceaux; et ainsi elle s’accordait bien à mon repos qui (grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient l’émouvoir) supportait, pareil au repos d’une main immobile au milieu d’une eau courante, le choc et l’animation d’un torrent d’activité.
Mais ma grand’mère, même si le temps trop chaud s’était gâté, si un orage ou seulement un grain était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j’allais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile de fond de la quelle j’étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à mes parents. (Du Côté de chez Swann)
LA LANTERNE MAGIQUE
Quelquefois, le soir avant dîner, on jouait dans la chambre de Jean à la lanterne magique. On repoussait contre la porte le bureau encombré de livres, on fermait bien les rideaux et, ayant ôté de la vieille lampe de travail son abat-jour de carton vert, on appliquait à son verre un réflecteur : et déjà, la lumière, tout à l’heure paisiblement étalée sur la table, dans la chambre soudain obscurcie éclairait mystérieusement une place du mur. Et voici tout d’un coup sur ce simple mur tendu de papier à dessins gris, au-dessus du vieux canapé noir, comme si un vitrail surnaturel, non pas en verre bleu, rouge, violet, mais comme une apparition de vitrail en apparence de verre, en clarté rouge, bleue et violette, s’avançait en tremblant, en avançant et reculant, à la manière des fantômes et des reflets. Etait-ce à ces belles couleurs comme Jean en avait souvent admiré sur les piliers des églises, quand les vitraux y rabattaient un jour multicolore et précieux, que les personnages de Barbe-Bleue, de Geneviève de Brabant, du traître Golo, de la soeur Anne, de la plaine verte qui s’étendait devant sa tour devaient la poésie fantastique qu’ils gardèrent dans son imagination ? Ou est-ce parce qu’elle était portée par Barbe-Bleue que cette barbe d’azur, que cette robe de sang revêtirent le prestige qu’elles empruntaient à une telle légende ? Mais ce qui avait peut-être encore le charme le plus mystérieux pour Jean, c’était ce moment singulier où, étant toujours dans sa chambre entre son lavabo, son bureau et son lit, sur ce mur tendu de papier à dessins gris passaient tout à coup ces apparitions merveilleuses. C’était ce moment où, les rideaux, soigneusement fermés, la bonne lampe ayant tout d’un coup sa lumière retenue, gardée et envoyée obliquement sur le mur pour une destination inconnue, sa chambre n’était plus sa chambre comme sa lampe n’était plus sa lampe, quoique, sur ce mur où jusque là, dans la plus grande débauche de couleur passagère (c’était quand un morceau de bois se mettait à flamber la nuit) une grande lueur palpitait un moment, et où maintenant les reflets merveilleux des églises et les personnages des légendes passaient, Jean pût reconnaître, un peu au-dessous de la bande mystérieuse où se manifestaient les apparitions (après cela elles cessaient d’être visibles), l’éclaboussure qu’il avait envoyée au papier dans sa toilette du matin et quoique dans le réflecteur derrière lequel on glissait des petites planches de verre de couleurs si mystiques, ce qui envoyait de la lumière sur le mur, ce dont le verre vous avait brûlé les doigts quand vous y aviez adapté le réflecteur, ce fût la bonne lampe habituelle qui, tout à l’heure, bureau remis à sa place, chaises emportées, réflecteur ôté et abat-jour remis, allait, comme après le gai réveil d’un rêve évidemment plus fantastique, éclairer son livre d’une franche lumière douce et ronde, en laissant le mur dans un demi-jour où la place mystérieuse, la trappe invisible par où les fantômes étaient apparus était confondue dans le reste du mur, demi-jour naturel qui allait bien avec la pleine lumière sur la table, jour habituel auquel on sentait que les fantômes, apparitions et glissements de vitraux impalpables étaient absolument réfractaires et dans lequel ils ne se montreraient certainement pas. (Jean Santeuil)

cl. jn-1980
A Combray, tous les jours dès la fin de l’après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester, sans dormir, loin de ma mère et de ma grand’mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l’air trop malheureux, de me donner une lanterne magique dont, en attendant l’heure du dîner, on coiffait ma lampe; et, à l’instar des premiers architectes et maîtres verriers de l’âge gothique, elle substituait à l’opacité des murs d’impalpables irrisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n’en était qu’accrue, parce que rien que le changement d’éclairage détruisait l’habitude que j’avais de ma chambre et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m’était devenue supportable. Maintenant je ne la reconnaissais plus et j’y étais inquiet, comme dans une chambre d’hôtel ou de “chalet” où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer.
[L’une des séries de plaques à projeter représentait l’histoire de Geneviève de Brabant. Il s’agit d’un conte populaire qui apparaît dans La Légende dorée. La fille du duc de Brabant a épousé Siegfried, le comte de Trèves. Comme elle a repoussé les avances du sénéchal Golo, celui-ci l’a accusée d’adultère. Son mari la condamne à mort, puis l’abandonne avec son enfant dans une forêt. Mais la vérité sera rétablie et le traître Golo châtié. Jacques Offenbach en a fait une opérette en 1859; puis on en a tiré un opéra en 1875.]
Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d’un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d’un vert sombre la pente d’une colline, et s’avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n’était autre que la limite d’un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu’on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n’était qu’un pan de château, et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève, qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes, et je n’avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur, car, avant les verres du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l’avait montrée avec évidence. Golo s’arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand’tante, et qu’il avait l’air de comprendre parfaitement, conformant son attitude, avec une docilité qui n’excluait pas une certaine majesté, aux indications du texte; puis il s'éloignait du même pas saccadé. Et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s’avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d’une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s’arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu’il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s’adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration.
Certes je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblait émaner d’un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d’histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j’avais fini par remplir de mon moi au point de ne pas faire plus attention à elle qu’à lui-même. L’influence anesthésiante de l’habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, choses si tristes. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en ceci qu’il semblait ouvrir tout seul, sans que j’eusse besoin de le tourner, tant le maniement m’en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu’on sonnait le dîner, j’avais hâte de courir à la salle à manger où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe-Bleue, et qui connaissait mes parents et le boeuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs, et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus chère, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. (Du Côté de chez Swann)
LE CABINET SENTANT L'IRIS
Il était quelquefois obligé de quitter sa chambre sentant qu’on allait y monter, et allait dans le cabinet de son oncle en haut, où le mur était tapissé de cartes représentant le théâtre de la guerre de 1870 et d’une carte détaillée du département. Ce cabinet était à un étage au-dessus. De là il entendait les gens monter l’escalier jusqu’au premier étage, appeler, frapper successivement à toutes les portes, ouvrir, dire tout haut : “Il n’y est pas.” D’en bas la bonne disait : “Je l’ai pourtant vu rentrer.” Dans l’amusement et la sécurité de sa cachette, Jean lui eût pourtant volontiers tordu le cou. En entendant son oncle dire à Pierre, le petit cousin de Jean: “Cherche-le bien, dis-lui qu’il faut qu’il descende”, il craignait de ne plus pouvoir résister. Quand la visite était descendue, Pierre ouvrait la porte des cabinets qui donnaient, par leur fenêtre toujours ouverte, sur une autre partie énorme et embaumée du marronnier rose, dont l’odeur se mêlait à l’odeur plus faible des chapelets de grains d’iris accrochés au mur et dont Jean avait appris dernièrement qu’ils provenaient des beaux iris violets du canal aux cygnes, non loin de l’endroit où il pêchait les carpes, dans le parc. (Jean Santeuil)
Je montais tout en haut de la maison, à côté de la salle d’études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l’iris, et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors entre les pierres de la muraille et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entr’ouverte. Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, d’où l’on voyait pendant le jour jusqu’au donjon de Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu’elle était la seule qu’il me fût permis de fermer à clef, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude : la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. (Du Côté de chez Swann)
A douze ans, quand j’allais m’enfermer pour la première fois dans le cabinet qui était en haut de notre maison, à Combray, où les colliers de graines d’iris étaient suspendues, ce que je venais chercher, c’était un plaisir inconnu, original, qui n’était pas la substitution d’un autre. C’était pour un cabinet une très grande pièce. Elle fermait parfaitement à clef, mais la fenêtre en était toujours ouverte, laissant passage à un jeune lilas qui avait poussé sur le mur extérieur et avait passé par l’entrebaillement sa tête odorante. (Contre Sainte-Beuve, Sommeils)
À COMBRAY : L'ÉGLISE SAINT-JACQUES
Construite à la fin du XIe siècle (on voit encore le porche nord, en grison ou roussard), elle a été refaite entre 1449 et 1497 par Florent d’Illiers, un compagnon de Jeanne d’Arc qui fut au Siège d’Orléans. Le clocher est du XVIème siècle; l’intérieur a été habillé de boiseries au XVIIIème siècle et “modernisé” au XIXème. Proust a pu voir le vitrail du fond, qui est postérieur à 1860; il représente Jésus entre saint Jacques et saint Hilaire, Miles d’Illiers, évêque de Chartres et son frère Florent d’Illiers.
C’est une église consacrée à saint Jacques. Dans le roman, Proust lui donne le nom d’une ancienne église d’Illiers, Saint-Hilaire; et enrichit considérablement l’édifice de tapisseries, de vitraux, de multiples pierres tombales, d’une crypte mérovingienne, de la tombe de la petite fille de Sigebert, d’une croix d’or offerte par Dagobert…
Il écrivit à ce propos dans une dédicace à Jacques de Lacretelle : “Il n’y a pas de clefs pour les personnages de ce livre, ou bien il y en a huit ou dix pour un seul; de même, pour l’église de Combray, ma mémoire m’a prêté comme “modèles” beaucoup d’églises. Je ne saurais plus vous dire lesquelles. Je ne me rappelle même plus si le pavage vient de Saint-Pierre-sur-Dives ou de Lisieux. Certains vitraux sont certainement d’Evreux, les autres de la Sainte-Chapelle et de Pont-Audemer.”
LE CLOCHER

cl. wiki-oxxo-w
On reconnaissait le clocher de Saint-Hilaire de bien loin, inscrivant sa figure inoubliable à l’horizon où Combray n’apparaissait pas encore; quand du train qui, la semaine de Pâques, nous amenait de Paris, mon père l’apercevait qui filait tour à tour sur tous les sillons du ciel, faisant courir en tous sens son petit coq de fer, il nous disait : “Allons, prenez les couvertures, on est arrivé.” Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l’horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, qu’elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle qui aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d’art, cette unique indication humaine. Quand on se rapprochait et qu’on pouvait apercevoir le reste de la tour carrée et à demi détruite qui, moins haute, subsistait à côté de lui, on était frappé surtout du ton rougeâtre et sombre des pierres; et, par un matin brumeux d’automne, on aurait dit, s’élevant au-dessus du violet orageux des vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la vigne vierge.
Souvent sur la place, quand nous rentrions, ma grand’mère me faisait arrêter pour le regarder. Des fenêtres de sa tour, placées deux par deux les unes au-dessus des autres, avec cette juste et originale proportion dans les distances qui ne donne pas de la beauté et de la dignité qu’aux visages humains, il lâchait, laissait tomber à intervalles réguliers des volées de corbeaux. Ma grand’mère trouvait au clocher de Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l’air naturel et l’air distingué. Et en le regardant, en suivant des yeux la douce tension, l’inclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se rapprochaient en s’élevant comme des mains jointes qui prient, elle s’unissait si bien à l’effusion de la flèche que son regard semblait s’élancer avec elle; et en même temps elle souriait amicalement aux vieilles pierres usées dont le couchant n’éclairait plus que le faîte.
C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. Qu’on le vît à cinq heures, quand on allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soi, à gauche, surélevant brusquement d’une cime isolée la ligne de faîte des toits; que, si au contraire on voulait entrer demander des nouvelles de Mme Sazerat, on suivît des yeux cette ligne redevenue basse après la descente de son autre versant en sachant qu’il faudrait tourner à la deuxième rue après le clocher; soit qu’encore, poussant plus loin, si on allait à la gare, on le vît obliquement, montrant de profil des arêtes et des surfaces nouvelles comme un solide surpris à un moment inconnu de sa révolution; ou que, des bords de la Vivonne, l’abside, musculeusement ramassée et remontée par la perspective, semblât jaillir de l’effort que le clocher faisait pour lancer sa flèche au coeur du ciel; c’était toujours à lui qu’il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d’un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela avec elle. (Du Côté de chez Swann)
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉGLISE, côté nord

cl. jn-1980
L’abside de l’église de Combray, peut-on vraiment en parler ? Elle était si grossière, si dénuée de beauté artistique et même d’élan religieux. Du dehors, comme le croisement des rues sur lequel elle donnait était en contrebas, sa grossière muraille s’exhaussait d’un soubassement en moellons nullement polis, hérissés de cailloux, et qui n’avait rien de particulièrement ecclésiastique, les verrières semblaient percées à une hauteur excessive, et le tout avait plus l’air d’un mur de prison que d’église.
Et certes, plus tard, quand je me rappelais toutes les glorieuses absides que j’ai vues, il ne me serait jamais venu à la pensée de rapprocher d’elles l’abside de Combray. Seulement, un jour, au détour d’une petite rue provinciale, j’aperçus, en face du croisement de trois ruelles, une muraille fruste et surélevée, avec des verrières percées en haut et offrant le même aspect asymétrique que l’abside de Combray. Alors je ne me suis pas demandé comme à Chartres ou à Reims avec quelle puissance y était exprimé le sentiment religieux, mais je me suis involontairement écrié : “L’Eglise !”
L’église ! Familière; mitoyenne, rue Saint-Hilaire, où était sa porte nord, de ses deux voisines, la pharmacie de M. Rapin et la maison de Mme Loiseau, qu’elle touchait sans aucune séparation; simple citoyenne de Combray qui aurait peu avoir son numéro dans la rue si les rues de Combray avaient eu des numéros, et où il semble que le facteur aurait dû s’arrêter le matin quand il faisait sa distribution, avant d’entrer chez Mme Loiseau et en sortant de chez M. Rapin; il y avait pourtant entre elle et tout ce qui n’était pas elle une démarcation que mon esprit n’a jamais pu arriver à franchir. Mme Loiseau avait beau avoir à sa fenêtre des fuchsias, qui prenaient la mauvaise habitude de laisser leur branches courir toujours partout tête baissée, et dont les fleurs n’avaient rien de plus pressé, quand elles étaient assez grandes, que d’aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l’église, les fuchsias ne devenaient pas sacrés pour cela pour moi; entre les fleurs et la pierre noircie sur laquelle elles s’appuyaient, si mes yeux ne percevaient pas d’intervalle, mon esprit réservait un abîme. (Du Côté de chez Swan)
Pendant que ma tante devisait ainsi avec Françoise, j’accompagnais mes parents à la messe. Que je l’aimais, que je ma revois bien, notre Eglise! Son vieux porche par lequel nous entrions, noir, grêlé comme une écumoire, était dévié et profondément creusé aux angles (de même que le bénitier où il nous conduisait) comme si le doux effleurement des mantes des paysannes entrant à l’église et de leurs doigts timides prenant de l’eau bénite, pouvait, répété pendant des siècles, acquérir une force destructive, infléchir la pierre et l’entailler de sillons comme en trace la roue des carrioles dans la borne contre laquelle elle bute tous les jours. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

cl. jn-1980
Ses pierres tombales, sous lesquelles la noble poussière des abbés de Combray, enterrés là, faisait au choeur comme un pavage spirituel, n’étaient plus elles-mêmes de la matière inerte et dure, car le temps les avaient rendues douces et fait couler comme du miel hors des limites de leur propre équarrissure.
Je m’avançais dans l’église, quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée visitée des fées, où le paysan s’émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage surnaturel; tout cela faisait d’elle pour moi quelque chose d’entièrement différent du reste de la ville : un édifice occupant, si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions — la quatrième étant celle du Temps —, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d’où il sortait victorieux.
Ses vitraux ne chatoyaient jamais tant que les jours où le soleil se montrait peu, de sorte que, fît-il gris dehors, on était sûr qu’il ferait beau dans l’église. L’un était rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage pareil à un Roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut, sous un dais architectural, entre ciel et terre (et dans le reflet oblique et bleu duquel, parfois les jours de semaine, à midi, quand il n’y a pas d’office — à l’un de ces rares moments où l’église aérée, vacante, plus humaine, luxueuse, avec du soleil sur son riche mobilier, avait l’air presque habitable comme le hall, de pierre sculptée et de verre peint, d’un hôtel de style moyen âge — on voyait s’agenouiller un instant Mme Sazerat, posant sur le prie-Dieu voisin un paquet tout ficelé de petits fours qu’elle venait de prendre chez le pâtissier d’en face et qu’elle allait rapporter pour le déjeuner). Il y en avait un (autre) qui était un haut compartiment divisé en une centaine de petits vitraux rectangulaires où dominait le bleu, comme un grand jeu de cartes pareil à ceux qui devaient distraire le roi Charles VI. Il était aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les pierreries que sur le pavé de la place ou la paille du marché; et, même à nos premiers dimanches quand nous étions arrivés avant Pâques, il me consolait que la terre fût encore nue et noire, en faisant épanouir, comme en un printemps historique et qui datait des successeurs de saint Louis, ce tapis éblouissant et doré de myosotis en verre. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
UNE MATINÉE DE JEAN
Le matin vers sept heures, pendant que Jean était encore dans son lit, les jours où il faisait froid on venait allumer le feu. Dans la chaleur de son lit, il voyait peu à peu la chambre vide s’échauffer, s’éclairer, s’égayer et, la tête tournée vers le feu, il souriait à ce bien-être grandissant qui l’attendait, dont il ne profitait pas encore. Immobile, fermant à demi les yeux, il contemplait du sein de son repos les mille tours que faisait la flamme, comme une ménagère active et gaie qui, pendant que son jeune maître repose encore, commence sa tâche, prépare et fait reluire toutes choses autour de lui.
Par la fenêtre ouverte sur le petit jardin de son cabinet de toilette, il voyait son oncle et ses cousins partir, faisant sonner au passage la clochette de la porte, portant des lignes ou des bêches, quelquefois seulement des cannes pour une grande promenade. Mais, pensant aux merveilleuses aventures qu’il allait lire près du feu, qui lui donneraient sans bouger aussi faim que la promenade et vers dix heures l’envie d’aller au parc, il ne regrettait pas d’avoir décidé de ne pas les suivre et regardait avec joie le feu maintenant rayonnant qui allait ronronner silencieusement à ses pieds pendant qu’il lirait dans le bon fauteuil près de la fenêtre. (Jean Santeuil)
Vers dix heures, il allait au parc, quelquefois son livre sous le bras, comptant finir un chapitre en plein air sur un pliant près du canal. Car à cette heure-là il faisait déjà chaud et le voisinage de l’eau était délicieux. Quand il arrivait au parc, il n’était pas long à apercevoir son oncle; il allait à lui et son oncle lui souhaitait longuement le bonjour. “Ah! on avait à travailler ce matin, on a fait le paresseux. — Mais oui, mon oncle”, répondait Jean en souriant, car au sein d’une vie heureuse les événements les plus simples projettent une sorte de bonheur, comme sur le canal par ces journées tranquilles toutes les feuilles des grands peupliers, les brindilles d’osier du petit pont rustique, la canne de Jean se reflétaient dans l’eau, entièrement, sans disparaître, caressées parfois par une brise ou par le passage d’un cygne qui laissaient l’image intacte, après.
“Ce matin, nous avons à déjeuner des oeufs à la cocotte, du filet sauve béarnaise avec des pommes de terre frites. Aimes-tu le filet béarnaise? — Oh! oui, mon oncle. — Ah bien, tant mieux! Et puis il y a des goujons si le père David en a apporté, je ne sais pas. Ah! mais il est onze heures et quart, il est temps de partir, si nous ne voulons pas que la friture soit perdue”, disait l’oncle. On rentrait. La mère de Jean lisait en les attendant dans la salle à manger. Tout le monde se mettait à table et l’oncle de Jean disait en mettait sa serviette et en s’installent dans sa chaise : “Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai rudement faim”, paroles qui paraissaient délicieuses, parce qu’elles traduisaient un sentiment général qui, dans un instant, comme l’annonçait le bruit avant-coureur des assiettes froides changées contre des assiettes chaudes, allait être bientôt satisfait. Et le déjeuner commençait. (Jean Santeuil)
RETOURS DE PROMENADE EN FIN D’APRÈS-MIDI
Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades, pour pouvoir faire une visite à ma tante Léonie avant le dîner. Au commencement de la saison, où le jour finit tôt, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la maison et un bandeau de pourpre au fond des bois de Calvaire, qui se reflétait plus loin dans l’étang, rougeur qui, accompagnée souvent d’un froid assez vif, s’associait, dans mon esprit, à la rougeur du feu au-dessus duquel rôtissait le poulet qui ferait succéder pour moi au plaisir poétique donné par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du repos. Dans l’été, au contraire, quand nous rentrions le soleil ne se couchait pas encore; et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière qui s’abaissait et touchait la fenêtre étaient arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisée, ramifiée, filtrée, et, incrustant de petits morceaux d’or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu’elle prend dans les sous-bois. Mais, certains jours fort rares, quand nous rentrions, il y a avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées, il n’y avait plus, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, nul reflet de couchant étendu sur les vitres, et l’étang au pied du calvaire avait perdu sa rougeur, quelquefois il était déjà couleur d’opale, et un long rayon de lune, qui allait en s’élargissant et se fendillait de toutes les rides de l’eau, le traversait tout entier. Alors, en arrivant près de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte et maman me disait :
— Mon Dieu ! voilà Françoise qui nous guette, ta tante est inquiète; aussi nous rentrons trop tard.
Et sans avoir pris le temps d’enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie pour la rassurer et lui montrer que, contrairement à ce qu’elle imaginait déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés “du côté de Guermantes” et, dame, quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu’on ne pouvait jamais être sûr de l’heure à laquelle on serait rentré. (Du Côté de chez Swann)
PROMENADE NOCTURNE VERS LA GARE
Comme c’était le lendemain dimanche et qu’on ne se lèverait que pour la grand’messe, s’il faisait clair de lune et que l’air fût chaud, au lieu de nous faire rentrer directement, mon père, par amour de la gloire, nous faisait faire par le calvaire une longue promenade, que le peu d’aptitude de ma mère à s’orienter et à se reconnaître dans son chemin, lui faisait considérer comme la prouesse d’un génie stratégique. Parfois nous allions jusqu’au viaduc, dont les enjambées de pierre commençaient à la gare et me représentaient l’exil et la détresse hors du monde civilisé, parce que chaque année, en venant de Paris, on nous recommandait de faire bien attention, quand ce serait Combray, de ne pas laisser passer la station, d’être prêts d’avance, car le train repartait au bout de deux minutes et s’engageait sur le viaduc au delà des pays chrétiens dont Combray marquait pour moi l’extrême limite. Nous revenions par le boulevard de la gare, où étaient les plus agréables villas de la commune. Dans chaque jardin le clair de lune, comme Hubert Robert, semait ses degrés rompus de marbre blanc, ses jets d’eau, ses grilles entr’ouvertes. Sa lumière avait détruit le bureau du Télégraphe. Il n’en subsistait plus qu’une colonne à demi brisée, mais qui gardait la beauté d’une ruine immortelle. Je traînais la jambe, je tombais de sommeil, l’odeur des tilleuls qui embaumait m’apparaissait comme une récompense qu’on ne pouvait obtenir qu’au prix des plus grandes fatigues et qui n’en valait pas la peine. De grilles fort éloignées les unes des autres, des chiens réveillés par nos pas solitaires faisaient alterner des aboiements…
Tout d’un coup, mon père nous arrêtait et demandait à ma mère : “Où sommes-nous?” Epuisée par la marche mais fière de lui, elle lui avouait tendrement qu’elle n’en savait absolument rien. Il haussait les épaules et riait. Alors, comme s’il l’avait sortie de la poche de son veston avec sa clef, il nous montrait, debout devant nous, la petite porte de derrière de notre jardin, qui était venue avec le coin de la rue du Saint-Esprit nous attendre au bout de ces chemins inconnus. Ma mère lui disait avec admiration: “Tu es extraordinaire!” (Du Côté de chez Swann)
LES RESTES DU CHÂTEAU D'ILLIERS
Le château a été construit en 1019 par le cruel Geoffroy d’Illiers, vicomte de Châteaudun — “Gilbert le Mauvais”. Il en reste surtout une tour d'enceinte dont Proust a fait, dans son roman, la tour de Roussainville-le-Pin — le nom de Roussainville étant emprunté à un château au sud d’Illiers.
Au XVe siècle le seigneur Florent d'Illiers a été un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. Il a été inhumé en 1475 dans l'église d'Illiers.

cl. jn-1980
C’est cette tour que Marcel regarde pendant qu’il se livre à des plaisirs solitaires, enfermé, en haut de la maison de la tante, dans le cabinet parfumé par une guirlande de racines d’iris. Au début du Temps Retrouvé, Gilberte révèle au Narrateur ce qui se passait dans cette tour :
“J’avais l’habitude d’aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. Et vous me direz que j’étais bien mal élevée, car il y avait là dedans des filles et des garçons de tout genre qui profitaient de l’obscurité. L’enfant de choeur de l’église de Combray, Théodore, s’y amusait avec toutes les petites paysannes du voisinage. Comme on me laissait sortir seule, dès que je pouvais m’échapper, j’y courais. Je ne peux pas vous dire comme j’aurais voulu vous y voir venir…”

cl. wiki-Oxxo
C’était le parc de l’oncle Jules Amiot.
L’oncle Jules possédait un jardin rue des Lavoirs et ce parc qu’il avait appelé, en souvenir du bois de Boulogne, le Pré-Catelan. Le troubadour Catelan avait été assassiné dans le bois de Boulogne alors qu’il apportait à la reine de France Marie de Brabant, de l’Orient lointain, le chant qu’il avait composé pour elle et de précieux parfums. Marie de Brabant (1254-1321), fille d’Henri III, duc de Brabant, et d’Adélaïde de Bourgogne; épouse en 1274 Philippe III le Hardi; protectrice des poètes.
— Sur le haut, on récoltait asperges et fraises des bois
— Un système hydraulique comportait un bassin, alimenté par une pompe actionnée par un cheval qui tournait sur une sorte de cirque de pierre (on voit de même à Saint-Eman un “bélier” de 1876 alimentant le château).
— Dans la pente, l’oncle avait construit un pavillon octogonal, la Maison des Archers, dont les fondations formaient une grotte artificielle (Marcel venait y lire Le Capitaine Fracasse).
— La partie basse avait été aménagée avec palmiers nains, pièce d’eau, petits colombiers de briques (souvenir des pigeonniers arabes que l’oncle Amiot avait vus en Algérie).
LE MANÈGE DU SOLEIL
Le père de M. Santeuil avait, de l’autre côté de la ville, un immense jardin qui, s’étendant d’abord en terre-plein devant le cours du Loir, s’élevait peu à peu, ici par le lentes montées, là par des escaliers de pierres conduisant à une grotte artificielle, jusqu’au niveau des plaines élevées qui commencent la Beauce et sur lesquelles il s’ouvrait par une porte à claire-voie.
Près du mur de clôture, à un endroit où Jean n’allait presque jamais, il y avait, dans une place nue et sans arbre, un cirque de pierre avec un timon au milieu où, attelés de temps en temps, les chevaux tournaient lentement pour faire monter l’eau. Le reste du temps, l’ombre seule du timon tournait plus lentement encore sur ce cirque en pierre qu’aucun arbre ne venait protéger du soleil, si bien que son oncle avait dit à Jean, un jour qu’il passait par là, que ce timon était une sorte de cadran solaire.
De ce cirque descendait, pour rejoindre le parc, un plant de ces immenses disques jaunes qu’on nomme des soleils, et par-dessus la basse clôture on apercevait des prés voisins que Jean, avant d’être venu là, n’avait jamais vus et qui s’étendaient au soleil, servant de pâture à quelques vaches. Jean était à cet âge où la terre n’est pas devenue quelque chose de parfaitement connu et réel, où l’on ne serait pas étonné qu’un endroit nouveau, un endroit bien réel planté d’arbres et où on peut marcher, donnât accès sur un monde irréel.
Jean avait très vivement cette sensation quand par hasard on le laissait passer (mais il ne savait pas les chemins et où on arrivait là) à cette plate-forme en plein soleil dont, disait-on, des chevaux faisaient souvent le tour, où le soleil marquait lui-même l’heure, devant qui s’étendaient des soleils et surtout qui donnait sur ces prés ensoleillés qu’il ne connaissait pas (cachés que, du chemin, ils lui étaient par le parc) et qui lui semblaient un pays nouveau, qui ne semblait pas dans le pays d’Illiers. Aussi croyait-il ce cirque une sorte d’entrée dans un Royaume du Soleil où tout était consacré au soleil, où ne poussaient que les fleurs du soleil, où le soleil venait de préférence, avec ses mystérieux chevaux. Le soleil, sans doute, il savait qu’il était en haut des cieux. Mais ne pouvait-il pas aussi descendre là sur la terre ?
Plus haut que le manège du soleil, il y avait un lieu encore plus mystérieux, après qu’on avait passé près d’un bassin d’où l’eau descendait alimenter des pompes et au fond duquel les tuyaux apparents et croisés avaient déjà cessé d’être une oeuvre de l’homme; et se mirant au fond des eaux qu’elle verdissait, la délicieuse gaine verdâtre de mille invisibles mousses aquatiques les enveloppait, se mêlant, se nouant les unes aux autres parfois si fort qu’elles avaient failli les crever et à un endroit les avaient tout à fait infléchis. C’était, au sommet du parc, immense espace plat, ce qu’on appelait “le plan d’asperges”, espace assez nu habituellement comme le lieu de tous les prodiges quand ils ne sont pas encore accomplis, et qui au mois de juin, quand il venait pour l’Ascension, apparaissait aux yeux de Jean foisonnant de dix mille délicieuses asperges qui y dressaient en liberté sur leurs corps bleuâtre et rosé leur tête verte et bouclée, enracinées dans la terre qui salissait de son limon leur tronc rose, comme si elles ne seraient pas, peut-être le soir même, servies dans son assiette, à jamais déracinées, chaudes, molles et pourtant encore telles qu’il les avait vues (ou plutôt il les avait vues, vivantes, telles qu’elles lui avait été servies) hautes et minces, quelques-unes plus grasses, dures et roses, puis bleuâtres avec une molle tête verte bouclée.
Au bout du plan d’asperges était une porte solidement verrouillée qu’on ouvrait souvent pour la promenade à cinq heures. Alors c’était à l’infini les champs de luzerne, où tremblait de temps en temps au vent un coquelicot. (Jean Santeuil)

cl. jn-1980
LES BASSINS
Plus loin le courant se ralentit, il traverse une propriété dont l’accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s’y était complu à des travaux d’horticulture aquatique, faisant fleurir, dans les petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres des arbres donnaient à l’eau un fond qui était habituellement d’un vert sombre, mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d’après-midi orageux, j’ai vu d’un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d’apparence cloisonnée et de goût japonais. Çà et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au coeur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu’on croyait voir flotter à la dérive, comme après l’effeuillement mélancolique d’une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et le rose proprets de la julienne, lavés comme de la porcelaine avec un soin domestique, tandis qu’un peu plus loin, pressées les unes contre les autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues poser comme des papillons leurs ailes bleuâtres et glacées sur l’obliquité transparente de ce parterre d’eau.
Nous nous asseyions entre les iris au bord de l’eau. Dans le ciel férié flânait longuement un nuage oisif. Par moments, oppressée par l’ennui, une carpe se dressait hors de l’eau dans une aspiration anxieuse. C’était l’heure du goûter. Avant de repartir, nous restions longtemps à manger des fruits, du pain et du chocolat, sur l’herbe où parvenaient jusqu’à nous, horizontaux, affaiblis, mais denses et métalliques encore, des sons de la cloche de Saint-Hilaire qui ne s’étaient pas mélangés à l’air qu’ils traversaient depuis si longtemps et, côtelés par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores, vibraient en rasant les fleurs, à nos pieds. (Du Côté de chez Swann)

LES LECTURES DE MARCEL AU PRÉ-CATELAN
Je n’étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu’il fallait aller au parc, à un kilomètre du village. Mais après le jeu obligé, j’abrégeais la fin du goûter apporté dans des paniers et distribué au bord de la rivière, sur l’herbe où le livre avait été posé avec défense de le prendre encore. Un peu plus loin, dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc, la rivière cessait d’être une eau rectiligne et artificielle, couverte de cygnes et bordées d’allées où souriaient des statues, et, par moments sautelante de carpes, se précipitait, passait à une allure rapide la clôture du parc, devenait une rivière dans le sens géographique du mot — une rivière qui devait avoir un nom — et ne tardait pas à s’épandre (la même vraiment qu’entre les statues et sous les cygnes ?) entre des herbages où dormaient des boeufs et dont elle noyait les boutons d’or, sortes de prairies rendues par elle assez marécageuses et qui, tenant d’un côté au village par des tours informes, restes, disait-on, du moyen âge, joignaient de l’autre, par des chemins montants d’églantiers et d’aubépines, la “nature” qui s’étendait à l’infini, des villages qui avaient d’autres noms, l’inconnu. Je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc, au bord des cygnes, et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu’à telle charmille où je m’asseyais, introuvable, adossé aux noisetiers taillés, apercevant le plan d’asperges, les bordures de fraisiers, le bassin où, certains jours, les chevaux faisaient monter l’eau en tournant, la porte blanche qui était la “fin du parc” en haut, et au-delà, les champs de bleuets et de coquelicots. Dans cette charmille, le silence était profond, le risque d’être découvert presque nul, la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui, d’en bas, m’appelaient en vain, quelquefois même se rapprochaient, montaient les premiers talus, cherchant partout, puis s’en retournaient, ne m’ayant pas trouvé; alors plus aucun bruit; seul de temps en temps le son d’or des cloches qui au loin, par-delà les plaines, semblait tinter derrière le ciel bleu, aurait pu m’avertir de l’heure qui passait; mais surpris par sa douceur et troublé par le silence plus profond, vidé des derniers sons, qui le suivait, je n’étais jamais sûr du nombre des coups. Ce n’était pas les cloches tonnantes qu’on entendait en rentrant dans le village — quand on approchait de l’église qui, de près, avait repris sa taille haute et raide, dressant sur le bleu du soir son capuchon d’ardoise ponctué de corbeaux — faire voler le son en éclats sur la place “pour les biens de la terre” (*). Elles n’arrivaient au bout du parc que faibles et douces et ne s’adressant pas à moi, mais à toute la campagne, à tous les villages, aux paysans isolés dans leur champ, elles ne me forçaient nullement à lever la tête, elles passaient près de moi, portant l’heure aux pays lointains, sans me voir, sans me connaître et sans me déranger. (Journées de lecture)
(*) D’après P.-L. Larcher, la sécheresse de 1552 avait donné naissance à l’usage suivant :
du 1er mai au 31 août on sonnait chaque jour pendant une demi-heure
“la cloche des Biens” pour attirer la protection du ciel sur les récoltes.
LE CAMÉLIA DU PRÉ-CATELAN
 Il y avait dans le parc un arbre dont l’oncle de Jean était très fier : c’était un immense camélia, qui était deux fois comme un homme, mais surtout s’arrondissait presque dès le pied jusqu’au faîte en une ombelle si large, composée de tant de milliers de larges feuilles vernies qu’on eût cru que c’était la contribution de beaucoup d’arbustes qui avait réussi à la bomber ainsi plutôt qu’un seul. Et il était si élevé, en même temps qu’énorme, qu’il restait gracieux. Tout alentour s’étendait la pente d’un vaste terrain à vif, aux mottes retournées et absolument nu, où rien ne poussait, car on avait consacré à cet arbre, comme à un Dieu, tout le terrain avoisinant. Il était absolument vert, sans une fleur, et ses feuilles immobiles répondant par un sourire au soleil quand il venait se poser sur elles, répondant à la brise printanière par un léger frémissement, gardaient comme un secret toute la splendeur cachée dont le moment n’était pas encore venu d’apparaître. On la sentait latente sous le beau vernis des feuilles, sous la satisfaction orgueilleuse et calme répandue dans tout l’arbre, sous sa force tranquille, sous son silence grandiose à qui le soleil n’arrachait qu’un sourire et la brise qu’un frémissement, mais rien de ce qui ne devait pas encore apparaître.
Il y avait dans le parc un arbre dont l’oncle de Jean était très fier : c’était un immense camélia, qui était deux fois comme un homme, mais surtout s’arrondissait presque dès le pied jusqu’au faîte en une ombelle si large, composée de tant de milliers de larges feuilles vernies qu’on eût cru que c’était la contribution de beaucoup d’arbustes qui avait réussi à la bomber ainsi plutôt qu’un seul. Et il était si élevé, en même temps qu’énorme, qu’il restait gracieux. Tout alentour s’étendait la pente d’un vaste terrain à vif, aux mottes retournées et absolument nu, où rien ne poussait, car on avait consacré à cet arbre, comme à un Dieu, tout le terrain avoisinant. Il était absolument vert, sans une fleur, et ses feuilles immobiles répondant par un sourire au soleil quand il venait se poser sur elles, répondant à la brise printanière par un léger frémissement, gardaient comme un secret toute la splendeur cachée dont le moment n’était pas encore venu d’apparaître. On la sentait latente sous le beau vernis des feuilles, sous la satisfaction orgueilleuse et calme répandue dans tout l’arbre, sous sa force tranquille, sous son silence grandiose à qui le soleil n’arrachait qu’un sourire et la brise qu’un frémissement, mais rien de ce qui ne devait pas encore apparaître.
Un jour, Jean, qui venait d’être souffrant, retournait au parc pour la première fois. En montant au plan d’asperges, son oncle lui dit : “Viens voir mon camélia qui est tout en fleurs.” Ils changèrent de chemin, car par le chemin qu’il prenait toujours Jean ne passait pas devant le camélia, parce que cela retardait pour aller à la grotte où étaient serrés ses outils de jardinage, sa bêche, son râteau. Mais comme il venait d’être souffrant, on lui avait dit de se contenter de lire et de pêcher. De sorte que, n’ayant pas à aller à la grotte, ils purent aller directement voir le camélia. Et au détour du chemin, il l’aperçurent. Partout, sur l’énorme ombelle, s’étalaient de larges fleurs rouges, roses, comme si on en eût attaché là des milliers. Et l’arbre, en plein soleil à cette heure avancée de la matinée, souriait, un peu changé de toutes ses admirables fleurs qui sortaient de lui, comme une accouchée nous semble une autre en étant encore la même. Les feuilles étaient toujours aussi belles, mais à tout moment s’ouvrait au milieu une large fleur rouge ou rose. Jean n’avait jamais vu ou n’avait remarqué l’arbre avant sa floraison, et n’avait jamais vu d’arbuste de cette sorte, jamais de grand arbuste aux innombrables fleurs rouges et roses, et il restait là devant lui comme devant une dame étrangère, belle, merveilleusement vêtue à qui son oncle l’aurait présenté et qui lui sourirait.
Du reste, seul sur son terrain consacré, le camélia n’était pas le seul dieu présent dans le parc alors. Tout le long du parc, les fines chapelles dentelées que sont les haies disparaissaient, comme il convient au mois de Marie, sous les guirlandes roses des épines roses, sous les branches d’aubépine blanche, mêlées comme dans une offrande tressée avec goût avec les fleurs des églantiers. Aux parties mêmes de ces petites chapelles pourtant en plein air où étaient amassées presque avec exagération les brandes d’aubépine fleuries sur toute leur longueur d’un vrai fourré de fleurs blanches, l’odeur était si forte qu’on en était presque affolé, et, bien que ce dôme des arbres fît de l’ombre et qu’il fît un silence recueilli dans lequel on pouvait entendre le gros bourdon noir dire ses oraisons dans le tabernacle des églantines d’où on n’apercevait plus que son dos noir, les rayons du soleil entraient, comme dans une chapelle dont la fenêtre n’est pas vitraillée. (Jean Santeuil)
C’est devant l’entrée du Pré-Catelan que l’on voit s’amorcer les deux “côtés” :
– le “côté de Guermantes” en remontant le Loir; du côté nord-est, on va vers un paysage d’eau, de nymphéas, d’iris; et le Loir conduit vers Saint-Eman, vers le côté de Guermantes.
– le “côté de chez Swann” ou de Méréglise, en suivant le raidillon des aubépines qui longe le parc et monte sur le plateau; du côté sud-ouest, on monte vers un paysage de plaine, de pommiers, de champs de blés; le raidillon passe devant la propriété de Swann et conduit vers Méréglise.
Pour aller du côté de Méréglise, Marcel et ses parents sortaient par le jardin; on prenait la rue des Lavoirs, la passerelle du Pont-Vieux, le raidillon des aubépines, on tournait à droite vers Saint-Hilaire par le chemin de la Croix-Rompue pour rejoindre la route de Méréglise, que l’on n’atteignait jamais (“de Méséglise-la-Vineuse, dit le Narrateur, je n’ai jamais connu que le côté”). De là, on avait de très belles vues de plaine.
Pour aller “du côté de Guermantes” (Saint-Eman), on sortait par la porte de façade; on prenait la rue de l’Oiseau Flesché, la place du Calvaire, le viaduc et on n’avait plus qu’à remonter le Loir vers l’amont; mais on pouvait aussi, pour mieux profiter de la rivière, tourner à gauche en sortant de la maison, descendre au Pont-Vieux et suivre l’eau en passant le long du pré Catelan, du côté où l’oncle s’était livré “à des travaux d’architecture aquatique”.
Il y avait autour de Combray deux “côtés” pour les promenades, et si opposés qu’on ne sortait pas de chez nous par la même porte, quand on voulait aller d’un côté ou de l’autre : le côté de Méséglise-la-Vineuse — qu’on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu’on passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là — et le côté de Guermantes.
Pendant toute mon adolescence, si Méséglise était pour moi quelque chose d’inaccessible comme l’horizon, dérobé à la vue, si loin qu’on allât, par les plis d’un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray, Guermantes, lui, ne m’est apparu que comme le terme, plutôt idéal que réel, de son propre “côté”, une sorte d’expression géographique abstraite comme la ligne de l’équateur, comme le pôle, comme l’orient. Alors, “prendre par Guermantes” pour aller à Méséglise, ou le contraire, m’eût semblé une expression aussi dénuée de sens que prendre par l’est pour aller à l’ouest.
Comme mon père parlait toujours du côté de Méséglise comme de la plus belle vue de la plaine qu’il connût et du côté de Guermantes comme du type de paysage de rivière, je leur donnais, en les concevant ainsi comme deux entités, cette cohésion, cette unité qui n’appartiennent qu’aux créations de notre esprit. Mais surtout je mettais entre eux, bien plus que leurs distances kilométriques, la distance qu’il y avait entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux, une de ces distances dans l’esprit qui ne font pas qu’éloigner, qui séparent et mettent dans un autre plan. Et cette démarcation était rendue plus absolue encore parce que cette habitude que nous avions de n’aller jamais vers les deux côtés un même jour, dans une seule promenade, mais une fois du côté de Méséglise, une fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin l’un de l’autre, inconnaissables l’un à l’autre, dans les vases clos et sans communication entre eux d’après-midi différents. (Du Côté de chez Swann).
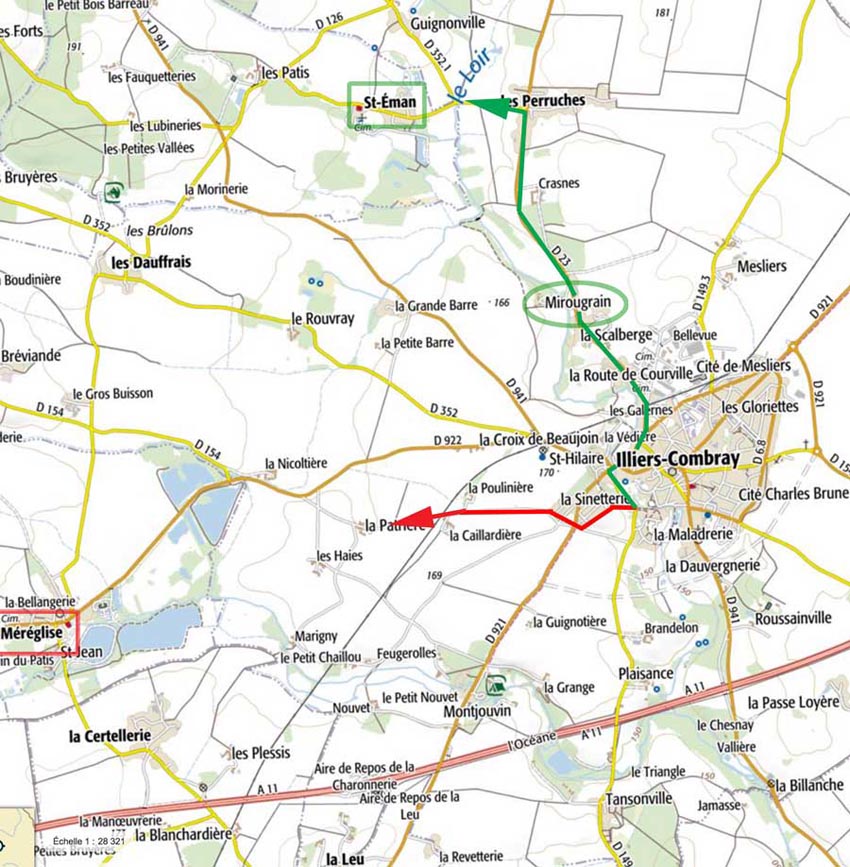
LE CÔTÉ DE CHEZ SWANN - LA PROMENADE "DES AUBÉPINES"
On part à gauche de l'entrée du Pré Catelan et on monte le raidillon en suivant le “chemin des aubépines” jusqu’à la barrière blanche; puis la vue s'ouvre sur les champs et la plaine.
LE RAIDILLON LE LONG DU PARC
Quand on voulait aller du côté de Méséglise, on sortait (pas trop tôt, et même si le ciel était couvert, parce que la promenade n’était pas bien longue et n’entraînait pas trop) comme pour aller n’importe où, par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. On était salué par l’armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore, de la part de Françoise, qu’elle n’avait plus d’huile ou de café, et l’on sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de M. Swann. Avant d’y arriver, nous rencontrions, venue au-devant des étrangers, l'odeur de ses lilas. Eux-mêmes, d’entre les petits coeurs verts et frais de leurs feuilles, levaient curieusement au-dessus de la barrière du parc leurs panaches de plumes mauves ou blanches que lustrait, même à l’ombre, le soleil où elles avaient baigné. Quelques-uns, à demi-cachés par la petite maison en tuiles appelée maison des Archers, où logeait le gardien, dépassait son pignon gothique de leur rose minaret.
Les Nymphes du printemps eussent semblé vulgaires, auprès de ces jeunes houris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. Malgré mon désir d’enlacer leur taille souple et d’attirer à moi les boucles étoilées de leur tête odorante, nous passions sans nous arrêter, mes parents n’allant plus à Tansonville depuis le mariage de Swann, et, pour ne pas avoir l’air de regarder dans le parc, au lieu de prendre le chemin qui longe sa clôture et qui monte directement aux champs, nous en prenions un autre qui y conduit aussi, mais obliquement. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980
LES AUBÉPINES
 Il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvai tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière; leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche fleur de fraisier. Combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait!
Il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvai tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière; leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche fleur de fraisier. Combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait!
Mais j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, elles m’offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu’on rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant dans leur secret. Je me détournais d’elles un moment, pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches.
Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelque coquelicot perdu, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d’une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau; rares encore, espacés comme les maisons isolées qui annoncent déjà l’approche d’un village, ils m’annonçaient l’immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d’un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le coeur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s’écrie, avant de l’avoir encore vue : “La Mer!” (Du Côté de chez Swan)
LA BARRIÈRE BLANCHE
[Dans le roman, cette barrière ouvre… sur le château de Tansonville, la propriété de Swann]

cl. jn-1980
Nous nous arrêtâmes un moment devant la barrière.
Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. A droite, au contraire, le parc s’étendait en terrain plat. La haie laissait voir à l’intérieur du parc une allée bordée de jasmins, de pensées et de verveines entre lesquelles des giroflées ouvraient leur bourse fraîche du rose odorant et passé d’un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau d’arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait, aux points où il était percé, au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l’éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores. Tout à coup je m’arrêtai. Une fillette d’un blond roux, qui avait l’air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Elle laissa ses regards filer dans ma direction, et sa main esquissait en même temps un geste indécent auquel le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu’un seul sens, celui d’une intention insolente.
— Allons, Gilberte, viens; qu’est-ce que tu fais, cria d’une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n’avais pas vue… (Du Côté de chez Swann)

Le véritable château de Tansonville (au sud d'Illiers, près de Montjouvin)
cl. jn-1980
LES CHAMPS VERS MESÉGLISE
[Dans le roman, en allant vers Méréglise, on trouve le vent sur la plaine, les pommiers, l’église de Saint-André-des-Champs, les bois des Roussainville et Montjouvain, la maison de Vinteuil.]
Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu’on faisait du côté de Méséglise. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un chemineau invisible, par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de notre arrivée, pour sentir que j’étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les sayons et me faisait courir à sa suite. On avait toujours le vent à côté de soi du côté de Méséglise, sur cette plaine bombée où, pendant des lieues, il ne rencontre aucun accident de terrain. Par les chauds après-midi, je voyais un même souffle, venu de l’extrême horizon, abaisser les blés les plus éloignés, se propager comme un flot sur toute l’immense étendue et venir se coucher, murmurant et tiède, parmi les sainfoins et les trèfles, à mes pieds.
A gauche était un village qui s’appelait Champieu (Campus Pagani, selon le curé). Sur la droite, on apercevait par-delà les blés les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs, eux-mêmes effilés, écailleux, imbriqués d’alvéoles, guillochés, jaunissants et grumeleux, comme deux épis.
A intervalles symétriques, au milieu de l’inimitable ornementation de leurs feuilles, qu’on ne peut confondre avec la feuille d’aucun autre arbre fruitier, les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc ou suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons. C’est du côté de Méséglise que j’ai remarqué pour la première fois l’ombre ronde que les pommiers font sur la terre ensoleillée, et aussi ces soies d’or impalpable que le couchant tisse obliquement sous les feuilles, et que je voyais mon père interrompre de sa canne, sans jamais les faire dévier.
C’est du côté de Méséglise, à Montjouvain, maison située au bord d’une grande mare et adossée à un talus buissonneux, que demeurait M. Vinteuil. Aussi croisait-on souvent sur la route sa fille, conduisant un buggy à toute allure. A partir d’une certaine année, on ne la rencontra plus seule, mais avec une amie plus âgée, qui avait mauvaise réputation dans le pays et qui, un jour, s’installa définitivement à Montjouvain.
Comme la promenade du côté de Méséglise était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray et qu’à cause de cela on la réservait pour les temps incertains, le climat du côté de Méséglise était assez pluvieux et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville dans l’épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert.
Souvent le soleil se cachait derrière une nuée qui déformait son ovale et dont il jaunissait la bordure. L’éclat, mais non la clarté, était enlevé à la campagne où toute vie semblait suspendue, tandis que le petit village de Roussainville sculptait sur le ciel le relief de ses arêtes blanches avec une précision et un fini accablants. Un peu de vent faisait envoler un corbeau qui retombait dans le lointain, et, contre le ciel blanchissant, le lointain des bois paraissait plus bleu, comme peint dans ces camaïeux qui décorent le trumeau des anciennes demeures.
Mais d’autres fois se mettait à tomber la pluie dont nous avait menacés le capucin que l’opticien avait à sa devanture. Nous nous refugiions dans le bois. Souvent aussi nous allions nous abriter, pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre, sous le porche de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française! Au-dessus de la porte, les saints, les rois-chevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de funérailles étaient représentés comme ils pouvaient l’être dans l’âme de Françoise. (Du Côté de chez Swann)
LE CÔTÉ DE GUERMANTES OU LA PROMENADE LE LONG DU LOIR
On est ici au début de la promenade qui va “du côté de Guermantes”, en remontant la rivière vers l’amont.
Le plus grand charme du côté de Guermantes, c’est qu’on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On la traversait une première fois, dix minutes après avoir quitté la maison, sur une passerelle dite le Pont-Vieux. Dès le lendemain de notre arrivée, le jour de Pâques après le sermon, s’il faisait beau temps, je courais jusque là, voir la rivière qui se promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d’une bande de coucous arrivés trop tôt et de primevères en avance, cependant que çà et là une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d’odeur qu’elle tenait dans son cornet. Le Pont-Vieux débouchait dans un sentier de halage qui, à cet endroit, se tapissait l’été du feuillage bleu d’un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine.
Nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant d’un talus de plusieurs pieds; de l’autre côté la rive était basse, étendue en vastes prés jusqu’au village et jusqu’à la gare qui en était distante. Ils étaient semés des restes, à demi enfouis dans l’herbe, du château des anciens comtes de Combray qui, au moyen âge, avait de ce côté le cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des abbés de Martinville.
Je m’amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre les petits poissons. Je me promettais de revenir là plus tard avec des lignes; j’obtenais qu’on tirât un peu de pain des provisions du goûter, j’en jetais dans la Vivonne des boulettes qui semblaient suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation, car l’eau se solidifiait aussitôt autour d’elles en grappes ovoïdes de têtards inanitiés qu’elle tenait sans doute jusque-là en dissolution, invisibles, tout près d’être en voie de cristallisation.
Bientôt le cours de la Vivonne s’obstrue de plantes d’eau. Il y en a d’abord d’isolées comme tel nénufar à qui le courant au travers duquel il était placé d’une façon malheureuse laissait si peu de repos que, comme un bac actionné mécaniquement, il n’abordait une rive que pour aborder celle d’où il était venu, refaisant éternellement la même traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s’allongeait, filait, atteignait l’extrême limite de sa tension jusqu’au bord où le courant le reprenait, le vert cordage se repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu’on peut d’autant mieux appeler son point de départ qu’elle n’y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manoeuvre. (Du Côté de chez Swann)

jn-1970
Le “Rocher de Mirougrain” (au nord d'Illiers) était, à la fin du XIXème siècle, la propriété d’une jeune poètesse, Juliette Joinville d’Artois. Née à Arras, elle eut une fille, Jeanne. Juliette mourut à Cannes en 1909. Elle et sa fille ont leur tombe dans le cimetière proche ("Juliette Joinville poète – Jeanne Joinville veuve Delacourt").
En 1886, Juliette Joinville avait fait ajouter sur une façade de la maison une sorte de revêtement de mégalithes prélevés dans la région, la plupart ayant été pris sur un cromlech à 7 km au sud (entre Saint-Avit-les-Guespières et Saumeray).

cl. wiki-Claurin
Dans son oeuvre poétique, on relève ce vers : "Dites-moi si l'oubli n'est pas le bien suprême". En 1887, Juliette Joinville d’Artois avait publié chez Dentu un livre (A travers le coeur) dans lequel elle parle d’elle-même :
“On vient de très loin voir mon manoir, mon rocher, mon temple, et, une fois en présence du colosse, chacun s’efforce d’en deviner l’âge, on en discute les siècles, et si j’apparaissais alors pour certifier que ce monument est moderne, que l’architecte avait vingt ans, qu’il était femme, et que cette femme c’est moi, je ne trouverais certainement que des incrédules et des rieurs. Ainsi dans cette enfant de vingt ans, blonde et frêle, allant fouiller la campagne à la recherche de vestiges de dolmens épars ensevelis pour les rendre à la lumière et en réédifier un temple, je vois certes un grand amour du passé, mais cet amour ne nous prend généralement pas si jeunes, il nous vient plus tard. Je vois aussi et surtout une âme désireuse de tuer son corps, un corps faisant de son mieux pour endormir son âme. Je vois ensuite dans cette masse colossale, imposante, défensive même, de mon Temple, l’âpre désir de me créer un abri, un refuge contre de nouveaux malheurs. J’y vois une volonté de mourir au monde”.
Cette Juliette vivait avec un domestique soit bègue, soit muet, justifiant ce choix par son amour du silence et son désir d’apprendre aux autres le langage des sourds-muets, “si utile aux malades”. Mais cela faisait beaucoup jaser à Illiers, et on disait qu’il se passait des choses bien étranges à Mirougrain.
On trouve dans Du Côté de chez Swann une première image de cette jeune femme. Au cours d’une promenade, la famille passe au lieu dit “Plaisance” (au sud d’Illiers, au confluent de la Thironne et du Loir, près de Tansonville, au bord de l’actuelle autoroute) :
“Parfois, au bord de l’eau entourée de bois, nous rencontrons une maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. Une jeune femme — dont le visage pensif et les voiles élégants n’étaient pas de ce pays, et qui était sans doute venue, suivant l’expression populaire, “s’enterrer là”, goûter le plaisir amer de sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle n’avait pu garder le coeur, y était inconnu — s’encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte. Et je la regardais, venant de quelque promenade sur un chemin où elle savait qu’il ne passerait pas, ôter de ses mains résignées de longs gants d’une grâce inutile.”
On pense que cette Juliette Joinville d’Artois a servi de modèle à Mlle Vinteuil et que Mirougrain a inspiré Montjouvain, la demeure de Vinteuil. Le toponyme de “Montjouvain” a été emprunté au château et au moulin de Montjouvin, sur la Thironne, un peu en amont de Plaisance (et ce château, au XVIIIe siècle, avait appartenu à un certain Jean-Jacques Jouvet de Mirougrain). Toutefois, alors que, dans la réalité, Mirougrain se trouve “du côté de Guermantes”, le Narrateur le situe “du côté de Méséglise”.

Montjouvin
jn-1980
Derrière le château de Mirougrain, le terrain monte légèrement devant la façade, constituant une sorte de talus du haut duquel on peut voir à l’intérieur de la maison. Cela rappelle le passage de Du côté de chez Swann où Marcel — qui était allé jusqu’à la mare de Montjouvain pour y revoir les reflets du toit de tuile de la cabane du jardinier — est caché dans les buissons du talus qui domine la maison et aperçoit Mlle Vinteuil et son amie se livrant à des jeux érotiques et crachant sur la photographie du père mort.
C’est à Montjouvain que Marcel connut pour la première fois l’enthousiasme de l’artiste :
Je me rappelle que c’est cet automne-là, près du talus broussailleux qui protège Montjouvain, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Après une heure de pluie et de vent contre lesquels j’avais lutté avec allégresse, comme j’arrivais au bord de la mare de Montjouvain, devant une petite cahute recouverte en tuiles où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître, et ses dorures lavées par l’averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuile encore mouillé, à la crête duquel se promenait une poule. Le toit de tuile faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose, à laquelle je n’avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l’eau et la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m’écriai dans tout mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé : “Zut, zut, zut, zut.” Mais en même temps je sentis que mon devoir eût été de ne pas m’en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement.
Et c’est à ce moment-là encore — grâce à un paysan qui passait, l’air déjà d’être d’assez mauvaise humeur, qui le fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie dans la figure, et qui répondit sans chaleur à mes “beau temps, n’est-ce pas, il fait bon marcher” — que j’appris que les mêmes émotions ne se produisent pas simultanément, dans un ordre préétabli, chez tous les hommes.” (Du Côté de chez Swan)
C’est à Mirougrain enfin que Proust situe une ferme appartenant à la tante Léonie. Celle-ci, dit-il, se laissait volontiers aller à rêver qu’un jour sa maison brûlerait avec toute sa famille, qu’elle aurait le temps d’échapper aux flammes et qu’elle irait passer l’été dans “sa jolie ferme de Mirougrain, où il y avait une chute d’eau”.

jn-1980
Il s’agit d’une résurgence qui est présentée comme la source du Loir (qui, jusqu'à la séchesse de 1639, prenait naissance du côté de Villebon). C’était un lieu de pèlerinage (le dimanche proche du 15 mai); on invoquait saint Aiman pour obtenir la pluie; le prêtre établissait le contact en trempant dans l’eau le “bâton d’Aiman”. L’église est des XIe-XVe s. Le bélier a été établi en 1876 par M. de Goussencourt pour monter l’eau à son château.
Marcel Proust enfant était venu voir cette source du Loir.
Je me rappelle que, tout enfant, on me mena un jour jusqu’aux sources du Loir. C’était une sorte de petit lavoir rectangulaire où mille petits poissons se concentraient comme une cristallisation frémissante et noire autour de la moindre mie de pain qu’on jetait. Autour du lavoir, la route solide et dure, et plus l’ombre d’eau ni de Loir. Pourtant c’étaient là les sources du Loir qui, invisible tout le long de la route, était rejoint deux lieues après en arrivant à Illiers, large et gracieuse rivière.
Aussi je ne comprenais pas comment ce petit lavoir, au fond duquel ou voyait se lever et s’arboriser au-dessus les unes des autres des petites gouttes d’eau, comme celles qu’on voit dans les aquariums où l’eau est sans cesse renouvelée, pouvait être les sources du Loir. Mais l’absence de tout rapport entre le Loir et ce petit lavoir au bord duquel traînaient tout le temps des linges auxquels on me défendait de toucher, ne me rendait ce lieu que plus mystérieux et lui donnait mieux ce caractère incompréhensible qui devait être attaché à l’origine d’une vie naturelle. Aussi cette eau qui sourdait en gouttes distinctes au fond du lavoir plein de têtards, c’était pour moi les Sources du Loir d’une façon aussi abstraite, presque aussi sacrée que certaine figure pouvait être pour le Romain le Fleuve. Et je me figurais vaguement que les femmes qui venaient sans cesse y laver leur linge avaient choisi cet endroit de préférence à tout autre à cause de son caractère illustre et sacré.
Dans le roman, le Narrateur rapporte que, dans sa jeunesse à Combray, il n’eut jamais l’occasion de remonter ni jusqu’à la source de la Vivonne, ni jusqu’au château de Guermantes :
Jamais dans la promenade du côté de Guermantes nous ne pûmes remonter jusqu’aux sources de la Vivonne, auxquelles jamais souvent pensé et qui avaient pour moi une existence si abstraite, si idéale, que j’avais été aussi surpris — quand on m’avait dit qu’elles se trouvaient dans le département, à une certaine distance kilométrique de Combray — que le jour où j’avais appris qu’il y avait un autre point précis de la terre où s’ouvrait, dans l’antiquité, l’entrée des Enfers.
Jamais non plus nous ne pûmes pousser jusqu’au terme que j’eusse tant souhaité d’atteindre, jusqu’à Guermantes. Je savais que là résidaient des châtelains, le duc et la duchesse de Guermantes, je savais qu’ils étaient des personnages réels et actuellement existants, mais chaque fois que je pensais à eux, je me les représentais toujours enveloppés du mystère des temps mérovingiens et baignant, comme dans un coucher de soleil, dans la lumière orangée qui émane de cette syllabe : “antes”. (Du Côté de chez Swan)
Ce château “de Guermantes” (en réalité le château des Pâtis, rue Guermantes, à Saint-Eman), qui appartenait alors à la famille de Goussencourt, est tout près, un peu mystérieux, car peu visible de la route.
VILLEBON est plus au nord, avec un château du XIVe siècle, ancienne propriété des d'Estouteville (restauré par Sully au début du XVIIe siècle). Dans d'anciens brouillons, Proust parle non pas du "côté de Guermantes", mais du "côté de Villebon".
Au début du Temps Retrouvé, le Narrateur recommence avec Gilberte ses promenades d’autrefois.
Je n’aurais d’ailleurs pas à m’arrêter sur ce séjour que je fis à côté de Combray, et qui fut peut-être le moment de ma vie où je pensai le moins à Combray, si, justement par là, il n’avait apporté une vérification au moins provisoire à certaines idées que j’avais eues d’abord du côté de Guermantes, et une vérification aussi à d’autres idées que j’avais eues du côté de Méséglise.
Je recommençais chaque soir, dans un autre sens, les promenades que nous faisions à Combray, l’après-midi, quand nous allions du côté de Méséglise. On dînait maintenant à Tansonville à une heure où jadis on dormait depuis longtemps à Combray. Et à cause de la saison chaude, et puis parce que l’après-midi, Gilberte peignait dans la chapelle du château, on n’allait se promener qu’environ deux heures avant le dîner. Au plaisir de jadis qui était de voir en rentrant le ciel de pourpre encadrer le Calvaire ou se baigner dans la Vivonne, succédait celui de partir à la nuit venue, quand on ne rencontrait plus dans le village que le triangle bleuâtre, irrégulier et mouvant des moutons qui rentraient; au-dessus de l’autre était déjà allumée la lune qui bientôt les baignait tout entiers. Il arrivait que Gilberte me laissait aller sans elle, et je m’avançais, laissant mon ombre derrière moi, comme une barque qui poursuit sa navigation à travers des étendues enchantées; le plus souvent elle m’accompagnait. Les promenades que nous faisions ainsi, c’était bien souvent celles que je faisais jadis enfant : or comment n’eussé-je pas éprouvé bien plus vivement encore que jadis du côté de Guermantes le sentiment que jamais je ne serais capable d’écrire, auquel s’ajoutait celui que mon imagination et ma sensibilité s’étaient affaiblies, quand je vis combien peu j’étais curieux de Combray ? J’étais désolé de voir combien peu je revivais mes années d’autrefois. Je trouvais la Vivonne mince et laide au bord du chemin de halage. Non pas que je relevasse d’inexactitudes matérielles bien grandes dans ce que je me rappelais. Mais, séparé des lieux qu’il m’arrivait de retraverser par toute une vie différente, il n’y avait pas entre eux et moi cette contiguïté d’où naît, avant même qu’on s’en soit aperçu, l’immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir. Ne comprenant pas bien sans doute quelle était sa nature, je m’attristais de penser que ma faculté de sentir et d’imaginer avait dû diminuer pour que je n’éprouvasse pas plus de plaisir dans ces promenades. Gilberte elle-même, qui me comprenait encore moins bien que je ne faisais moi-même, augmentait ma tristesse en partageant mon étonnement. “Comment, cela ne vous fait rien éprouver, me disait-elle, de prendre ce petit raidillon que vous montiez autrefois?” Et elle-même avait tant changé que je ne la trouvais plus belle, qu’elle ne l’était plus du tout. Tandis que nous marchions, je voyais le pays changer, il fallait gravir des coteaux, puis des pentes s’abaissaient. Nous causions très agréablement pour moi, avec Gilberte. Mais, je me rappelle que dans ces conversations que nous avions en nous promenant, plusieurs fois elle m’étonna beaucoup.
L’une, la première en me disant : “Si vous n’aviez pas trop faim et s’il n’était pas si tard, en prenant ce chemin à gauche et en tournant ensuite à droite, en moins d’un quart d’heure nous serions à Guermantes.” C’est comme si elle m’avait dit : “Tournez à gauche, prenez ensuite à votre main droite, et vous toucherez l’intangible, vous atteindrez les inattingibles lointains dont on ne connaît jamais sur terre que la direction, que — ce que j’avais cru jadis que je pourrais connaître seulement de Guermantes, et peut-être, en un sens, je ne me trompais pas — le “côté”.
Un de mes autres étonnements fut de voir la “source de la Vivonne”, que je me représentais comme quelque chose d’aussi extra-terrestre que l’Entrée des Enfers, et qui n’étaient qu’une espèce de lavoir carré où montaient des bulles.
Et la troisième fois fut quand Gilberte me dit : “Si vous voulez, nous pourrons tout de même sortir un après-midi et nous pourrons alors aller à Guermantes, en prenant par Méséglise, c’est la plus jolie façon”, phrase qui, en bouleversant toutes les idées de mon enfance, m’apprit que les deux côtés n’étaient pas aussi inconciliables que j’avais cru.
Mais ce qui me frappa le plus, ce fut combien peu, pendant ce séjour, je revécus mes années d’autrefois, désirai peu revoir Combray, trouvai mince et laide la Vivonne. Mais quand elle vérifia pour moi des imaginations que j’avais eues du côté de Méséglise, ce fut pendant une de ces promenades en somme nocturnes bien qu’elles eussent lieu avant le dîner — mais elle dînait si tard! Au moment de descendre dans le mystère d’une vallée parfaite et profonde que tapissait le clair de lune, nous nous arrêtâmes un instant, comme deux insectes qui vont s’enfoncer au coeur d’un calice bleuâtre. Epanchant brusquement sur elle la tendresse dont j’étais rempli par l’air délicieux, la brise qu’on respirait, je lui dis : “Vous parliez l’autre jour du raidillon. Comme je vous aimais alors!” Elle me répondit : “Pourquoi ne me le disiez-vous pas? je ne m’en étais pas doutée. Moi je vous aimais. Et même deux fois je me suis jetée à votre tête. — Quand donc? — La première fois à Tansonville, vous vous promeniez avec votre famille, je rentrais, je n’avais jamais connu un aussi joli petit garçon. J’avais l’habitude, ajouta-t-elle d’un air vague et pudique, d’aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. Et vous me direz que j’étais bien mal élevée, car il y avait là-dedans des filles et des garçons de tout genre qui profitaient de l’obscurité. L’enfant de chœur de l’église de Combray, Théodore qui, il faut l’avouer, était bien gentil (Dieu qu’il était bien!) et qui est devenu très laid (il est maintenant pharmacien à Méséglise), s’y amusait avec toutes les petites paysannes du voisinage. Comme on me laissait sortir seule, dès que je pouvais m’échapper, j’y courais. Je ne peux pas vous dire comme j’aurais voulu vous y voir venir; je me rappelle très bien que, n’ayant qu’une minute pour vous faire comprendre ce que je désirais, au risque d’être vue par vos parents et les miens, je vous l’ai indiqué d’une façon tellement crue que j’en ai honte maintenant. Mais vous m’avez regardée d’une façon si méchante que j’ai compris que vous ne vouliez pas.” (Le Temps retrouvé)
Quand mourut la tante Elisabeth, en 1886, la famille dut aller à Illiers pour régler la succession. Marcel, à 15 ans, retrouva pour quelques jours sa chambre, le jardin et le Pré-Catelan où il lut deux ouvrages d’Augustin Thierry, La Conquête de l’Angleterre par les Normands et les Récits des Temps mérovingiens. Mais le docteur Proust avait décidé que le climat d’Illiers était mauvais pour l’asthme de son fils, avec l’humidité du Loir, les fleurs de pommiers et d’aubépine. Désormais le jeune garçon passerait ses vacances sur la côte normande ou dans des villes d’eau.
Proust ne devait, jusqu’à la trentaine, ne revoir Illiers qu’au cours de rares et brèves visites, l’enchantement de l’enfance étant rompu, le Loir n’étant plus qu’une “rivière mince et laide”.
La mémoire n’avait plus alors qu’à prendre le relais et à opérer ses métamorphoses…
LES LIEUX AUTOUR DE COMBRAY CITÉS DANS LA RECHERCHE
| Nom dans l'oeuvre | Nature du lieu dans l'oeuvre | Origine du nom | Modèle |
| CHAMPIEU | Village imaginaire à côté de Combray | ||
| COMBRAY | Berceau de la famille; le Narrateur y vient en vacances chez sa tante Léonie; situé à l’emplacement d’Illiers; puis, après 1914, entre Reims et Laon , le raidillon aux aubépines montant vers “la fameuse cote 307”. | -
nom d’un petit village du Calvados au sud de Caen; - bourg de Combres à 14 km à l’ouest d’Illiers; - château de Cambray à 38 km d’Illiers, près d’Orgères-en-Beauce; - Combourg (?) |
Illiers |
| GUERMANTES | Château à 10 lieues de Combray (45 km); paysage de rivière et de nymphéas | château de Guermantes près de Lagny-sur-Marne (en 1909, Proust s’informa si le nom était “à prendre pour un littérateur”) | - château de Goussencourt à Saint-Eman - château de Villebon au nord d’Illiers (cour aux pavés inégaux) - château de Balleroy près de Bayeux (tapisseries de François Boucher) |
| MARTINVILLE-LE-SEC | Localité près de Combray dont les deux clochers sont décrits dans la promenade du Narrateur avec le docteur Percepied | -
Marchéville, au nord d’Illiers (?) - Nogent-le-Sec dans l’Eure |
|
| MESEGLISE-LA-VINEUSE | But de promenade du Narrateur; paysage de plaine. | -
Village de Méréglise à
l’ouest d’Illiers - La Vineuse, commune de Saône-et-Loire |
dans la direction de Méréglise |
| MIROUGRAIN | Ferme des environs de Combray appartenant à la tante Léonie (“jolie ferme où il y avait une chute d’eau”) | Lieu dit Mirougrain à 1 km au nord d’Illiers | |
| MONTJOUVAIN | Maison, près de Méséglise, habitée par Vinteuil et sa fille | Lieu dit Montjouvin avec moulin sur la Thironne, à 2 km au sud-ouest d’Illiers | Maison de campagne dite “Le Rocher de Mirougrain” où habita une mystérieuse jeune femme, Juliette Joinville d’Artois (peut-être modèle de Mlle Vinteuil) |
| ROUSSAINVILLE-LE-PIN | Petite localité qui, sous la pluie, semble “être châtiée comme un village de la Bible”, connue pour son donjon entouré de bois sur la route de Méséglise. | -
Roussainville, hameau à 1 km au sud d’Illiers
(sans ruine ni bois) - Bailleau-le-Pin, village à 10 km au nord-est d’Illiers |
|
| SAINT-ANDRÉ-DES-CHAMPS | Eglise aux environs de Combray, connue pour les sculptures de son porche | Notre-Dame-des-Champs à Châteaudun | -
Saint-Loup-de-Naud - Cathédrale de Chartres |
| SAINT-HILAIRE | Eglise de Combray avec chapelle dédiée à Gilbert le Mauvais | Eglise Saint-Hilaire d’Illiers, démolie à la Révolution | Eglise Saint-Jacques d’Illiers |
| TANSONVILLE | Propriété de Swann près de Combray, longée par le raidillon aux aubépines; les Saint-Loup s’y installent dans La Fugitive | Château
de Tansonville, à 2,5 km au sud d’Illiers Au XIVe, château des Arrachepel. En 1875, devient la propriété du comte d’Aymery (maire d’Illiers) A été ensuite la demeure du Khédive d’Egypte Abbas II Hilmi, destitué par les Anglais en 1914 (il a fait élargir la façade du château) |
Le Pré-Catelan, jardin de l’oncle Amiot, à Illiers (barrière blanche, lilas, “maison des Archers”, raidillon…) |
| THIBERZY | Lieu imaginaire aux environs de Combray où l’on va chercher une sage-femme pour la fille de cuisine | ||
| VIEUXVICQ | Clocher qui semble voisin de ceux de Martinville lors de la promenade avec le docteur Percepied | Vieuxvicq, village à 4,5 km au sud-ouest d’Illiers | |
| VIVONNE | Rivière à nymphéas arrosant Combray | La Thironne, affluent du Loir près d’Illiers | Le Loir à Illiers |
PERSONNAGES DE LA RECHERCHE LIÉS À COMBRAY
| Nom dans le roman | Personnage du roman | Modèle |
| Oncle ADOPHE | Frère du grand-père du Narrateur, chez qui on a rencontré “la dame en rose”, Odette | Louis Weil, grand-oncle de Marcel Proust |
| CAMUS | Epicier de Combray, fournisseur de Françoise | M. Légué, épicier à Illiers, fournisseur de l’Ernestine des Amiot (un autre épicier d’Illiers s’appelait Camus) |
| Tante CÉLINE | Soeur de la grand-mère du Narrateur | |
| EULALIE | Confidente et informatrice de la tante Léonie | Servante de la grand-mère de Proust à Illiers |
| Tante FLORA | Grand-tante du Narrateur, soeur de tante Céline | |
| FRANÇOISE | Cuisinière de tante Léonie à Combray; passera au service des parents du Narrateur; regrettera d’avoir quitté Combray pour Paris | Ernestine Gallou, servante des Amiot à Illiers (+ des servantes de Proust : Félicie Fitau, Céline Cottin, Céleste Albaret) |
| Monsieur GALOPIN | Pâtissier de Combray | Un médecin d’Illiers s’appelait Galopin |
| GILBERTE | Fille de Charles Swann et d’Odette de Crécy; le Narrateur voit pour la première fois cette petite fille blonde dans le parc de Tansonville | Antoinette Faure + Marie Bénardaky + Jeanne Pouquet |
| Mme GOUPIL | Fille du docteur Percepied; à son mariage le Narrateur aperçoit pour la première fois la duchesse de Guermantes | La fille du docteur Galopin |
| La GRAND'MÈRE du Narrateur | Elle se nomme Bathilde (ou “Mme Amédée”); née vers 1820; idéaliste, on la trouve “un peu piquée” | La grand-mère maternelle de Proust, Adèle Berncastel, épouse de M. Nathé Weil |
| Le GRAND-PÈRE du Narrateur | Monsieur Amédée; ami du père de Swann; antisémite | Le grand-père paternel de Proust, Nathé Weil |
| La GRAND'TANTE du Narrateur | Propriétaire de la maison de Combray; laissera sa fortune à une nièce; “un peu vulgaire”; confondue par Proust avec la tante Léonie | |
| Tante LÉONIE | Fille de la grand-tante du Narrateur; veuve de l’oncle Octave (“Madame Octave”); reçoit le Narrateur et ses parents dans sa maison de Combray; toujours alitée; rêve d’aller jusqu’à Tansonville | Mme Jules Amiot, tante de Proust, à Illiers |
| La MÈRE du Narrateur | Plus réaliste que sa mère; passe la nuit auprès de son enfant “nerveux”; lui fera goûter une madeleine trempée dans du thé; partira avec lui à Venise | Jeanne Clémence Weil, la mère de Marcel Proust |
| Le NARRATEUR | Sera nommé “Marcel” dans La Prisonnière; jeune bourgeois parisien né vers 1880; vient en vacances à Combray, où est né son père. | Marcel Proust |
| Le docteur PERCEPIED | Médecin de Combray | Le docteur Galopin d’Illiers (mais le facteur d’Illiers s’appelait Percepied) |
| L'abbé PERDREAU | Curé de Combray; a l’intention d’écrire un livre sur la paroisse; visite la tante Léonie; a une nièce à Combray | Le chanoine Joseph Marquis, auteur d’un ouvrage sur Illiers (1907); visitait la tante Amiot (au XVIIIe siècle, l’église d’Illiers eut pour curé un abbé Perdreau) |
| Le PÈRE du Narrateur | Maniaque de la météorologie, il s’intéresse sans cesse à la température; fait faire à son fils des promenades autour de Combray | Le père de Proust, Adrien Proust |
| Mme SAZERAT | Voisine de la tante Léonie à Combray; fera des séjours à Paris; rencontrera le Narrateur à Venise | |
| Charles SWANN | Fils d’un agent de change juif, possède à Combray, du côté de Méséglise, la grande propriété de Tansonville où il vit avec sa femme Odette et sa fille Gilberte | Nicolas Bénardaky, Charles Ephrussi, Paul Hervieu, Emile Strauss, Charles Haas |
| Mme Odette SWANN | Née en 1852; demi-mondaine (Odette de Crécy, “la dame en rose”); a épousé Charles Swann; habite à Tansonville avec sa fille Gilberte; passe pour être la maîtresse de Charlus | Laure Hayman (la maîtresse de l’oncle Louis Weil) + Mme Strauss, Mme de la Béraudière (maîtresse de vieux comte Greffulhe) |
| Le jeune THÉODORE | Garçon épicier chez Camus; chantre chargé de l’entretien de l’église de Combray (en fait visiter la crypte avec sa soeur); se livre à des jeux interdits dans les ruines de Roussainville; deviendra cocher d’un ami de Charlus; sa soeur sera la femme de chambre de la baronne Putbus; finira comme pharmacien à Méséglise | Victor Ménard, garçon de courses de l’épicier Légué, à Illiers, et enfant de choeur de Saint-Jacques |
| M. VINTEUIL | Ancien professeur de piano des grand-tantes du Narrateur; retiré avec sa fille à Montjouvain, près de Combray | César Franck, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Vincent d’Indy |
| Mlle VINTEUIL | Fille du musicien; a l’air d’un garçon avec sa grosse voix; a des moeurs “gomorrhéennes”; après la mort de son père, avec une amie elle crachera sur sa photographie et le Narrateur, caché près de Montjouvain, surprendra la scène | La fille du compositeur Ernest Guiraud et de Juliette Joinville d’Artois, qui résidait en solitaire à Mirougrain, près d’Illiers |
MEURTRE CHEZ TANTE LÉONIE
En 1994, Estelle Monbrun a publié un roman policier "Meurtre chez tante Léonie" dont l'intrigue se situe autour de la maison d'Illiers.
 |
La redoutable présidente d'une "Proust Association" a réuni dans la maison des professeurs du monde entier pour leur révéler une extraordinaire découverte, des carnets manuscrits inédits de Marcel Proust...
|

